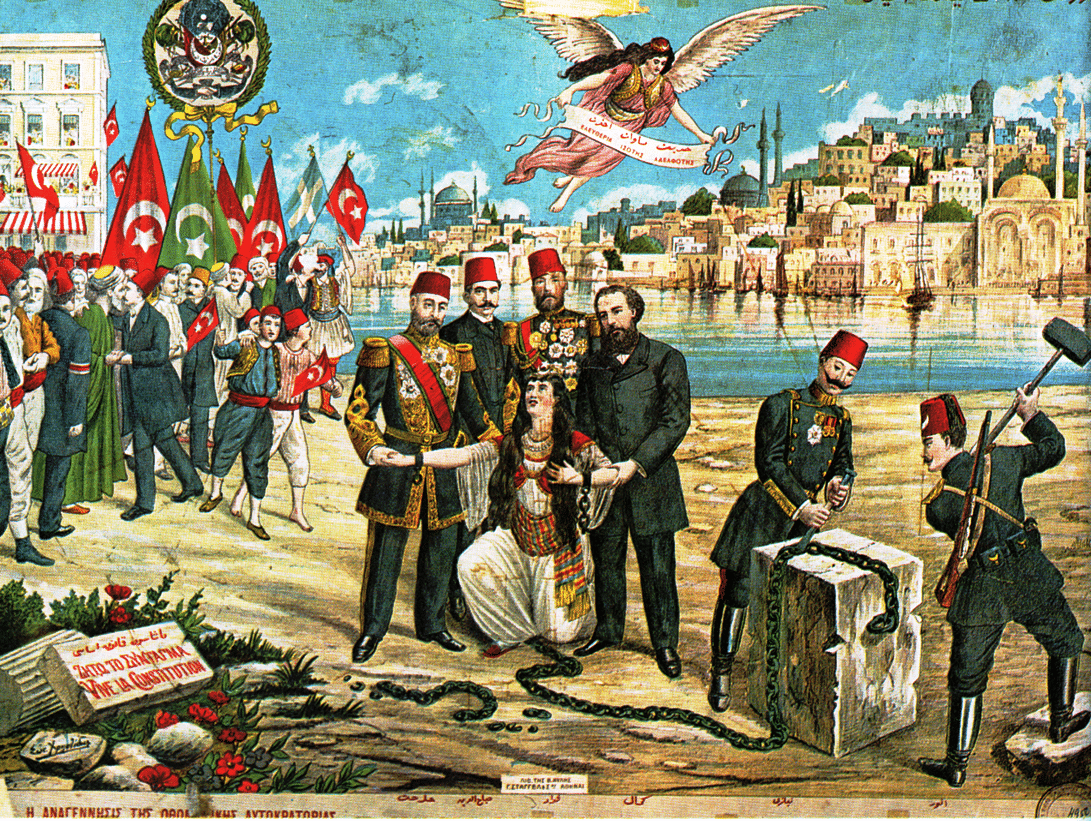Les éditions Anacharsis inaugurent une nouvelle collection avec ces petits volumes consacrés à des individus qui ont traversé l’histoire sans y laisser de marque durable. Leurs visages composent une galerie de portraits signés Marion Mousse, illustrateur, scénariste et auteur de bande dessinée.
C’est aux archives de Venise, en quête d’une brève mention des banquiers Fugger, que Philippe Braunstein a découvert les lettres d’Alvise Mocenigo dans un des cartons renfermant les dossiers de son beau-père, Michele Foscari. De ces lettres émergeait « une personnalité si riche de sens et de mystère » que l’homme devint son commensal. « Par-delà ses relations de famille ou d’ambassade, j’ai découvert une écriture et une voix : il ne manque que le portrait de cet ami du XVe siècle. » Voilà donc qui est fait.
Entretemps, le portrait s’est enrichi d’un volume de missives diplomatiques, et d’un registre témoin de sa carrière, retrouvé en 2014. Mocenigo a occupé diverses fonctions officielles de 1486 à 1541, à Anvers, en Allemagne, à la cour de France, à la fois diplomate et associé aux affaires de Foscari dont il a épousé la fille naturelle, Pelegrina. L’entreprise familiale gère un vaste réseau d’influences et une ample variété de marchandises. Le contrat passé avec « Ulrich Fugger et frères » est un échange de poivre contre un chargement de cuivre. Mocenigo prévient son beau-père que les Portugais ont construit une forteresse à l’entrée de la mer Rouge : même si les épices passent par la Syrie, les prix vont monter.
En mission pour le Sénat vénitien, il effectue aux côtés de Louis XII une itinérance de plusieurs mois « en pérégrination de l’Adriatique jusqu’à l’Océan en passant même par des forêts », rapporte le chroniqueur Marin Sanudo. Au cours d’une autre pérégrination, en plein hiver, Mocenigo doit retrouver le roi des Romains où qu’il soit, et l’accompagner où qu’il aille, alors que la peste sévit dans les régions qu’ils traversent. Ses missives diplomatiques le montrent toujours soucieux de représenter dignement sa « patrie » et d’en servir les intérêts. Son attachement à Foscari s’exprime par des expressions touchantes mais aussi des mouvements d’humeur ou des reproches, son plaisir d’être honoré par les rois, sa déception de ne pas être écouté par la Seigneurie. « Ils se figurent que je suis un surhomme, ou ils me considèrent comme un déchet. » En réponse à la grande question, se taire ou parler, il choisit une réserve prudente, ainsi quand il s’abstient de démentir Louis XII en public, et laisse se répandre la fausse nouvelle d’une défaite de Maximilien, tact dont le roi lui sut gré. Dans l’entourage du futur empereur, certains cherchent à lui nuire, « en disant au roi des Romains que je suis là à ne servir à rien ». Un sentiment de frustration que doivent souvent éprouver les ambassadeurs.

Bref, de quoi comprendre la sympathie qu’inspire Mocenigo à l’auteur, et d’être soi-même frustré d’en apprendre si peu sur les événements auxquels il participe, les personnages illustres qu’il rencontre. Ainsi cette visite nocturne de Philippe de Commynes, qui le prie d’intervenir d’urgence auprès de la reine de Hongrie pour qu’elle envoie des faucons à la cour de France, requête qu’il exécute en lui expédiant un courrier à deux heures du matin. Quel pouvait être le motif réel de cette visite, à une heure indue, on n’en saura rien. Et guère plus sur Maximilien, qui le couvre de marques de faveur et ne donne rien aux ambassadeurs espagnols, Anne de Bretagne qui le reçoit avec une grande gentillesse, ou Louise de Savoie – la mère de François Ier, Braunstein ne juge pas utile de le rappeler – que Mocenigo décrit comme « une sage personne ». La France manque parfois de civilité comparée à l’Italie, observe-t-il, mais lors d’un dîner princier il est installé en tête de table près du légat, Charles d’Amboise, qui a tenté vainement de se faire élire pape. Mocenigo rapporte ici la réaction de Louis XII, qui sort d’une grave maladie, fort irrité par cet échec : « On nous croyait morts, mais nous allons tout faire pour montrer que nous sommes vivants ». Les hommes d’affaires italiens auteurs de fausses rumeurs vont l’apprendre à leurs dépens. Le roi n’a que mépris et sarcasmes pour Maximilien mais se montre « bienveillant » envers Mocenigo, et le remercie pour la qualité de sa mission avant d’entrer en triomphe à Milan. L’ambassadeur qui fut témoin de l’opposition frontale entre les deux adversaires va se consacrer désormais à ses affaires privées. « Avec lui disparaissent, dans l’ombre, les gestes, les intonations, les accents de ceux qu’il n’a cessé d’écouter. »
Tout autre est l’itinéraire d’Alexandrine Flottes, née en 1827 à Marseille de père inconnu et de Thérésine Choux, dans une rue proche du Grand Théâtre qui vaut au quartier la réputation de repaire des grisettes. La famille Choux accède progressivement à la petite bourgeoisie, mais des difficultés financières les réduisent à transformer leur domicile en auberge. Les frères Choux ont-ils participé à la conquête de l’Algérie, c’est possible. C’est là que Thérésine choisit d’émigrer, peut-être en compagnie de son futur époux, Eugène Flottes, et exerce le métier de repasseuse dans le voisinage de deux anciennes casernes. A-t-elle emmené sa fille avec elle, peut-être, ou peut-être pas. Son frère aîné Marius est parti s’installer comme négociant au Brésil.
« En cette décennie 1830, l’écheveau des allées et venues de la fratrie Choux n’est pas facile à démêler », explique Thibault Bechini. On l’en dispenserait volontiers, car, après l’annonce prometteuse du titre, Alexandrine n’entre en scène que lors de son mariage à Alger avec Michele Barchi, après un long détour par les ramifications généalogiques de toute leur parentèle, leurs métiers et les quartiers où ils vivent. L’achat par les frères Barchi d’une maison mauresque offre l’occasion d’étudier l’évolution du tissu urbain algérois. En 1845, âgée de dix-huit ans, Alexandrine met au monde une fille, Clara. Le décès de la petite Clara, à l’âge de vingt-six mois, se signale par une anomalie sur l’acte de décès qui la présente comme italienne. Quelques mois après, appauvri par la crise économique, le couple quitte l’Algérie pour le Tessin. À Arioso, son village natal, Michele fait une demande de passeport où il inscrit les noms d’Alexandrine et de leur fils nouveau-né, Alessandro, et tous trois s’embarquent pour l’Argentine, un voyage de trois mois.

À bord, une jeune fille de la bourgeoise marseillaise, Joséphine Truilher, tient un journal où elle consigne les sempiternels repas de morue, l’eau rationnée, les pluies diluviennes et les rares distractions comme le passage d’une « Baleine monstrueuse », les couchers de soleil, les tensions entre le capitaine et son second. Selon Bechini, Alexandrine a probablement hérité de l’intérêt maternel pour la geste napoléonienne, la fréquentation des militaires voisins, qui ont sans doute façonné son patriotisme à l’époque où les troupes françaises se heurtaient à la résistance des populations locales. « Aussi son sentiment d’appartenance à la nation française semble-t-il indissociable de son expérience de l’ordre colonial installé en Algérie et des logiques de catégorisation qui le sous-tendent ». Son mariage lui a fait perdre sa qualité de femme française au regard de la loi, mais il n’est pas dit que cette perte « ait entamé la conscience nationale de la jeune femme ». D’autant moins qu’il ne reste de la jeune femme aucun écrit ni aucune trace de paroles qu’elle aurait prononcées.
À leur arrivée, en 1849, Buenos Aires compte 80 000 habitants. Michele, maçon de son métier, « restaure peut-être les vieilles maisons », mais il meurt en 1851, laissant seuls Alexandrine et le petit Alessandro. C’est alors que leur viennent en aide les Tessinois. Ici intervient une autre source d’information, Rose Doladilhe, mariée elle aussi à un natif d’Arioso, avec qui elle a émigré en Algérie puis à Buenos Aires. La méthode paradoxale de Bechini lui permet de dresser un état des lieux où passe son héroïne, prétexte à une série d’exposés sur les chaînes migratoires, les réseaux de solidarité, les pratiques administratives. Alexandrine se situant à une grande distance sociale des riches négociants français, elle « côtoie donc de préférence les milieux des migrants tessinois, tout en nouant par ailleurs des relations avec la population locale ». Il le déduit d’un recensement où elle figure sous son prénom hispanisé bien qu’elle se soit déclarée française, de ses adresses successives, et de quelques mentions à l’état-civil, dont aucune ne lui attribue de profession. Qui sait, couturière, blanchisseuse, employée dans une confiserie, secteur en pleine expansion, ou encore domestique chez le maître-charpentier Gibelli, qui a pu être « en relation d’affaire avec le maître maçon Barchi ». Après douze ans de veuvage, elle se remarie avec Paolo Ferrari, et échappe ainsi « à la précarité qui semble avoir été la sienne ». Enfin, nous assistons au décès d’Alessandro, à l’âge de vingt-deux ans : « On imagine le mourant entouré… » Le chagrin d’Alexandrine se mesure aux dépenses qu’elle engage pour les obsèques. Une longue, très longue procédure successorale et les documents y afférents occupent les dernières pages. Par la transmission des prénoms, « le souvenir d’Alexandrine continue d’habiter, ne serait-ce que de manière souterraine, la mémoire familiale ».
L’ouverture d’Anacharsis aux « seconds couteaux de l’histoire » s’étend aux deux extrêmes de la zone d’ombre : une vie de notable nourrie de faits issus des archives, et une vie presque intangible en bordure pointillée de la sociologie. Comment tirer de l’oubli un être qui n’a laissé que de faibles traces sans recourir à un éventail des possibles ou se faire romancier, c’est le défi qu’auront à relever les prochains volumes de la nouvelle collection.