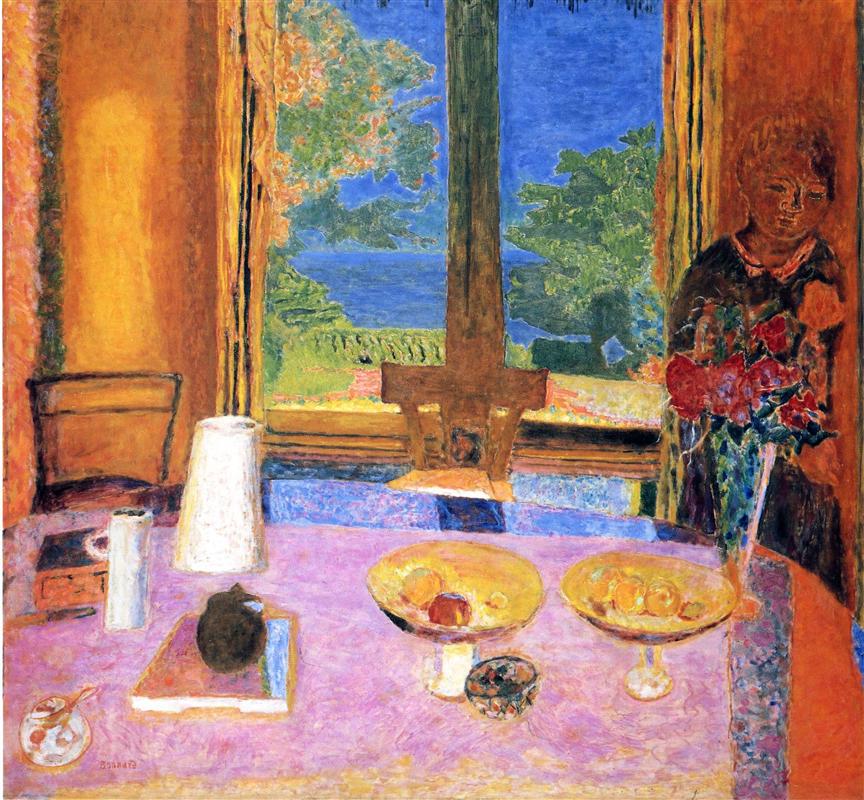Vingt-cinq ans et 150 000 visiteurs : le succès des Utopiales, festival international de science -fiction à Nantes, ne s’est pas démenti. À travers le thème « Singularités », c’est une diversité joyeuse et fière qui s’est exprimée pendant tables rondes et rencontres : littéraire, scientifique, artistique, éditoriale, souvent passionnante. Mais avec la conscience que cette diversité était menacée. Par l’IA, par la post-vérité, le capitalisme et la réaction. Compte-rendu et sélection de livres, parcellaires et subjectifs.
Enki Bilal, qui avait dessiné l’affiche de la première édition en 2000, rappelle que « les lecteurs de science-fiction sont blindés pour affronter le monde » puisque « la SF n’existe plus ; on vit dans un monde de SF ». D’ailleurs, le chessboxing, inventé par Enki Bilal dans sa BD Froid Équateur en 1992, a aujourd’hui sa fédération internationale et ses championnats du monde. Dans sa série actuelle, Bug, il imagine que « la mémoire disparaît, asséchée par le numérique ».
« Seconde révolution : le quantique sort des labos » confirme que la SF contamine le monde. Les physiciennes Michèle Leduc et Virginia D’Auria détaillent les progrès de la physique quantique : on réalise aujourd’hui des expériences qui n’étaient que théorie il y a vingt ans. La fragilité d’objets quantiques instables fait que l’ordinateur quantique n’est pas encore au point. Les qubits utilisés pour les calculs sont facilement affectés par « la décohérence » qui casse l’intrication quantique. Il faut donc les protéger en les entourant de nombreux autres petits qubits « comme les nains protègent Blanche-Neige ». Mais la fascinante faculté de transformation des objets quantiques fait qu’ils gardent la trace de toute intervention. Aussi, les espionner ou les hacker ne peut se faire secrètement.
La juriste Marina Teller souligne qu’on ne peut encore légiférer sur les développements quantiques car leurs implications pratiques restent imprévisibles. Une des grandes craintes est que les ordinateurs quantiques cassent les algorithmes RSA de cryptographie qui protègent aujourd’hui les échanges de données, par exemple avec les banques. Remarque finale : « il faudrait quand même réfléchir au coût écologique des innovations »…
L’empreinte écologique de la science, c’est là-dessus, entre autres, que travaille Mathieu Bouffard, planétologue intervenant dans « Des sciences en résistance ». Avec Floriane Soulas, écrivaine et ingénieure, et Laurent Devisme, enseignant-chercheur en architecture et vice-président de Nantes Université. À une époque où le gouvernement américain supprime en masse ou cesse de rendre publiques des données sur le genre, la diversité, le climat ou la santé, où le Premier ministre français soutient mordicus que le système solaire contient « des milliards de soleils », où les universités sont sous-financées, où un programme de recherches sur l’influence du Coran en Europe du XIIe au XIXe siècle est attaqué par la presse d’extrême droite, il est essentiel de repenser la relation entre la population et la science, jugent les participants. Il faudrait que les scientifiques investissent davantage internet ; en nouant des liens avec la recherche citoyenne et en développant la science participative, afin d’éviter une position scientiste.
Réfléchir à « la science qui ne se fait pas », aux domaines qui ne sont pas explorés, et montrer clairement les rapports de force constituent d’autres pistes. Pour casser l’image de scientifiques coupés du monde réel, on pourrait ouvrir les portes des laboratoires, développer l’école du dehors et l’université permanente. Étant donné la forte réduction du nombre de journalistes scientifiques, Mathieu Bouffard se réjouit que l’École de physique des Houches ait proposé une formation à la méthode scientifique pour les journalistes.
Dans l’immense salle 2001, « Le nom du monde est forêt » tire son intitulé d’un roman d’Ursula K. Le Guin, lequel a en partie inspiré Avatar. Ursula K. Le Guin à qui est également emprunté l’exergue du programme du festival : « La divinité de chaque être humain réside dans sa singularité ».
Premee Mohamed est l’autrice de Comme l’exigeait la forêt, belle novella jouant poétiquement des aspects horrifiques du conte de fées. Elle rappelle que les bois, « c’est dangereux. En Amérique du Nord, vous pouvez être mort au bout d’une journée en forêt ». Elle confirme que, comme celui d’Ursula K. Le Guin, qui l’a influencée ainsi que Printemps silencieux de Rachel Carson, son livre est anticolonialiste : « mon héroïne appartient à la forêt, mais elle y est envoyée par des gens qui ne comprennent pas la forêt, ne la respectent pas ».
Francis Martin, directeur du laboratoire ARBRE à l’INRAE de Nancy, a été pionnier dans l’étude de la manière dont arbres et champignons communiquent car « sous nos pieds grouille un réseau de filaments : le mycélium ». Pour autant, il ne faut pas anthropomorphiser les arbres en leur attribuant de l’altruisme : les plantes sentientes n’existent pas. Francis Martin souligne qu’il existe de la compétition dans la forêt, mais aussi une coopération fondamentale. Dans La forêt hyperconnectée, il décrit les interactions de l’écosystème forestier, du sol jusqu’aux cimes. L’arbre-monde détaille les 2 500 espèces d’êtres vivants qu’abrite un chêne. Bien que les forêts françaises soient jardinées depuis 3 000 ou 4 000 ans, elles abritent 70 % de la biodiversité du pays.
Premee Mohamed rappelle que « l’idée de l’individu est biologiquement inutile » mais que « le système est fait pour qu’on soit séparés en tant qu’individus ». Francis Martin indique qu’il y a de plus en plus d’arbres malades, mais aussi que la forêt se montre extraordinairement résiliente. Dix à vingt ans lui suffisent pour se réapproprier les sols livrés à eux-mêmes.

Les Utopiales rendent hommage à Ayerdahl, disparu à cinquante-six ans en 2015, en réunissant sur scène Sarah Doke, autrice qui fut sa compagne, son éditrice Marion Mazauric et Gilles Francescano, qui illustra les couvertures de ses livres.
Les intervenants rappellent la dimension politique de l’œuvre d’Ayerdahl, dominée par la soif de justice et l’idée de Sartre que « la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s’en dire innocent ». Et qu’il fut en pointe dans la défense des droits des auteurs, au sein du groupement « Le Droit du serf ».
Mais ils soulignent aussi qu’Ayerdahl a fait partie de la première génération d’écrivains francophones de science-fiction rivalisant avec les Anglo-Saxons. Ainsi, Demain, une oasis, Grand prix de l’imaginaire 1993, s’attaque aux problèmes des réfugiés, de la sécheresse, de la famine en Afrique et de la violence politique, mais c’est « avant tout un roman d’aventures » porté par le « sense of wonder ». Avec Chroniques d’un rêve enclavé, Ayerdahl a imaginé une utopie pacifiste communaliste, inventant une fantasy sans magie située sur la colline de la Croix-Rousse à Lyon. Transparences, Grand prix de l’imaginaire 2005, est un étonnant thriller sur la transparence sociale, sur le fait de ne pas voir ce qui dérange, comme la misère, avec une héroïne « nageuse de foule ». Bastards fond des fantastiques urbain moderne et mythologique. Quant à Cybione, c’est « une Lara Croft féministe » créée en réponse à un éditeur qui voulait « un roman avec de la sueur, du sang et du sperme »… Une œuvre à explorer.
« Quelle SF pour le changement climatique ? » permet d’entendre un autre écrivain de cette génération, Jean-Marc Ligny, qui essaie de « faire voir les fissures du mur vers lequel on fonce », en joignant « l’utile à l’agréable : je suis là pour raconter des fictions. Pas pour m’extraire du monde réel, mais le creuser et en extirper l’essence ». Écrire Exodes (2012), ce roman « très noir », l’a soulagé de sa propre écoanxiété mais il craint d’avoir angoissé nombre de lecteurs ! Semences (2015) et Alliances (2020) ont pu les rassurer : 300 ans dans le futur, l’humanité existe toujours.
Jean-Marc Ligny se sent responsable devant les lecteurs : « je pense tout le temps à eux. Je m’astreins à être rigoureux dans mes recherches et libre dans mes propos », comme les êtres non humains qui habitent son jardin, « le moins entretenu possible ». Les escargots grignotant son courrier, il va essayer « d’écrire un bouquin sur eux ».
Pour définir « l’écriture de l’étrange », luvan commence par l’étymologie : « étrange » vient de ex traneus : « qui provient de l’extérieur ». En allemand, ça se dit fremd, qui vient d’un mot signifiant « destination ». Conclusion : « ce qui est étrange est ce qui n’est pas la maison ».
Selon Gabriel Marcoux-Chabot, dans son roman Godpèle, l’étrangeté vient, non du monde décrit, mais de ce que l’écrit a disparu et qu’un personnage reconquiert une langue écrite proche du français québécois oral.
luvan cherche à provoquer l’émerveillement, le même pétillement que celui qu’on a observé sur des IRM de cerveaux de bébés lorsqu’on a fait rebondir une balle devant eux, et que la balle est soudain restée figée en l’air (grâce à une ficelle transparente). Dans le superbe Agrapha, comme elle trouvait qu’on n’était pas assez à l’époque, elle s’est projetée elle-même (en tant que narratrice) au Moyen Âge. « Le pétillement de cerveau est la braise sur laquelle j’ai envie de souffler. »
Jeff VanderMeer remarque que pour lui l’expression « sense of wonder » renvoie à une SF américaine conservatrice, traditionnelle, des années 1950. Il voit un intérêt à écrire des tropes pour aller ailleurs, au-delà des attentes du lecteur, inventer des pièges, des effets subliminaux qui déstabilisent le lecteur. Dans Astronautes morts, il a essayé de le faire au moyen d’expérimentations formelles, en particulier typographiques.
Un des grands intérêts des Utopiales est de remonter le temps de l’histoire de la science-fiction, en particulier française. Comme avec la table ronde sur Ayerdhal, ou celles sur Roland C. Wagner, les éditions Fleuve Noir ou Octavia Butler les années précédentes. Cela donne des discussions passionnantes.
Cette fois, on fête les trente ans des éditions Mnémos. Frédéric Weil, un des fondateurs, raconte : Mnémos est né du jeu de rôle, des éditions Multisim, portées par le succès du jeu Nephilim. Les auteurs de scénarios avaient envie d’écrire des textes ; les fondateurs de Mnémos, tous d’énormes lecteurs, étaient de leur côté convaincus qu’il était possible de développer une fantasy francophone, qui n’existait pas dans la littérature à l’époque. Le pari a été tenu avec l’émergence de Mathieu Gaborit ou de Fabrice Colin.
Sans expérience, les éditeurs ont pris « les choses à l’envers » : vendre des poches en diffusion directe. Ils ont appris sur le tas, connu « les montagnes russes », été au bord de la faillite puis sauvés par le succès du Cycle des Crépusculaires de Mathieu Gaborit ou du Secret de Ji de Pierre Grimbert.
Frédéric Weil et Bleuenn Guillou, qui s’occupe de la collection Young Adult de Mnémos, précisent qu’avant de publier un livre ils travaillent plusieurs mois sur le manuscrit avec l’auteur. Mais que celui-ci garde le dernier mot. « C’est comme un tango » ; « les créateurs ont besoin d’un premier miroir, même si c’est dans une relation d’amour-haine ». Règle d’or : « l’éditeur ne doit pas se prendre pour un auteur ».
Stéphanie Hans, qui a signé l’affiche du festival et dessiné l’excellente BD Die, fascine car elle est une des rares Françaises à avoir percé aux États-Unis, où elle a signé de nombreuses couvertures pour Marvel. Son discours est tranché : « Je trouvais bien l’idée de me faire de l’argent avec des illustrations… Mon problème avec les écoles d’art est leur négation des réalités du métier. Aux Arts Déco, on ne m’a pas expliqué comment négocier un contrat, alors que le milieu est extrêmement toxique. On s’est tous fait arnaquer sur nos premiers volumes ». On perçoit qu’elle a raison, que sa réussite ne pouvait pas se faire sans un fort caractère.
Elle précise qu’il faut qu’une couverture, souvent exposée au milieu de dizaines d’autres, se voie ; et que, pour cela, elle est particulièrement attentive à « la question des vides autour du dessin ».
Jeff VanderMeer a les honneurs de la scène Shayol pendant une heure, ce que méritent amplement ses quatre romans du Rempart Sud. Quelques scènes vécues résonnent étrangement avec ses livres. L’étoile de mer bioluminescente d’Annihilation, il l’a rencontrée une nuit d’enfance, perdu sur un récif des Fidji où ses parents travaillent pour le Peace Corps.
Plus tard, à l’issue d’un atelier d’écriture, l’animateur hospitalisé utilisait un haut-parleur placé au centre de la table pour dire qui avait le droit et qui n’avait pas le droit d’écrire. Jeff n’eut pas le droit. Les deux premiers livres du Rempart Sud lui sont venus en rêve, portés par la fatigue d’une randonnée en Floride du Nord et de dents de sagesse arrachées.
« La ville est-elle une erreur ? » Répondre à cette question fondamentale est difficile, mais les intervenants évoquent le rapport de leurs livres avec la ville. Blake Crouch a eu l’idée de sa trilogie Wayward Pines alors qu’il marchait dans « une petite ville trop parfaite du Colorado ». Plusieurs téléphones se sont mis à sonner autour de lui, il a pensé que les habitants s’appelaient pour parler de lui. Cette paranoïa a donné naissance à l’intrigue du roman.
Le Grand Vide est une BD graphiquement impressionnante. Elle a vu le jour à partir d’un défi sur internet d’un dessin par mois, que Léa Murawiec a relevé dans le but de « m’améliorer en décor urbain ». Dans Le Grand Vide, elle a voulu « couper l’horizon, le champ visuel pour donner une sensation d’étouffement ». Les nombreux panneaux portant des noms qui parsèment sa ville viennent de la vision des pierres tombales d’un cimetière.
Aurélien Vernant, spécialiste de l’imaginaire urbain, évoque l’architecte Yona Friedman qui, dans les années 1950, développa un projet de ville spatiale en orbite, éternellement nomade, puis Patrick Bouchain, « père des friches artistiques », pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels, comme le Lieu Unique, ancienne usine LU, où se tient justement la table ronde.
Les villes ont l’avantage de proposer des communautés plus nombreuses aux minorités, souligne Léa Murawiec. Bien qu’il soit « hyper dur de ne rien faire dans une ville, même si on en a envie », il faut savoir résister à la pression de performer, de se montrer, ce qui est le sujet du Grand Vide.
Tel un drone de grande taille ou un condor des Andes, l’IA aura plané sur la plupart des tables rondes mais, à l’heure actuelle, elle inquiète d’autant plus qu’on ne sait pas vraiment quelles seront ses conséquences sur la création littéraire et artistique.
La soirée des prix est l’occasion de conclure : « Nous sommes une collection de petites anomalies, de singularités qu’on voudrait supprimer ». Mais les « connexions » font de ces singularités « une communauté ».