Vous vous rappelez la chanson d’Aristide Bruant ? « Pour chanter Veni Creator / Il faut une chasuble d’or / Nous en tissons pour vous, grands de l’Église / Et nous, pauvres canuts, n’avons pas de chemise. » Une trame cousue de fil d’or, tel le fin fillé d’Arras d’où tire son nom (the arras) le rideau de scène anglais, court sur fond de misère dans le deuxième roman de Glen James Brown, Mother Naked. Le premier, Ironopolis, se déroulait au nord de l’Angleterre. Celui-ci, situé six siècles plus tôt, ne raconte plus la destruction d’une cité ouvrière mais d’un village.
Et c’est à l’époque du récit, les années 1430, que le ménestrel Modyr Nakett surgit dans les registres du prieuré de Durham, comme ayant reçu le plus modeste paiement jamais accordé à un artiste pour sa performance, en deux cents ans de comptes archivés : quatre pence, soit un tiers de shilling. Engagé pour divertir les invités du Sacristain au banquet de la Saint-Godric, le narrateur, Mother Naked, prie d’abord son auditoire de l’excuser, car il remplace l’illustre ménestrel Melchior Blanchflower, entièrement fictif celui-là, et doté d’un prestigieux CV : attaché à la cour d’Henry V, Melchior se tenait aux côtés du roi pendant le siège de Meaux, à Harfleur, Azincourt… Quelques chevauchées qui ravagèrent les campagnes sont évoquées, conduites par d’autres guerriers illustres, Woodstock, Philippe le Hardi, ou le Prince Noir.
Quel sera le contenu du conte ? « La triste et tragique histoire du Spectre de Segerston », un village pratiquement rasé de la surface de la Terre il y a quarante ans. Avec toutes sortes de précautions oratoires, car l’histoire risque de déplaire à certains des invités, marchands merciers, descendants des protagonistes. Mother Naked la tient d’un autre ménestrel itinérant, son compagnon de voyage, Pearl Eye, surnom dû à la teinte laiteuse de son œil de verre, qui a vu le Spectre semer derrière lui la désolation, moissons ravagées, morts violentes, dans d’autres villages. Les serfs vivent très loin en dessous du seuil de pauvreté, car ils doivent travailler cent cinquante jours par an sur les terres de leur seigneur avant d’être autorisés à labourer les maigres arpents censés nourrir leurs familles. Une mauvaise récolte, et leur fragile équilibre est détruit. Si l’un parvient à s’enfuir, ce sont les autres qui doivent assumer sa charge de travail, car on manque de main-d’œuvre depuis la Grande Peste de 1348. Les fuyards encourent de lourdes sanctions s’ils sont repris, et de longues peines dans l’au-delà pour avoir tenté de se dérober à l’ordre divin qui les maintient à leur place dans l’échelle sociale, enchaînés à leur manoir. Rêver d’un autre destin que celui fixé par Dieu est un grave péché, qui se paiera de milliers d’années de purgatoire. Dieu ayant ordonné que la Bible soit en latin, et lue à l’église seulement par des prêtres capables de l’expliquer, six Lollards sont fouettés à mort pour avoir traduit des Psaumes en anglais. Les envies de rébellion sont freinées par le souvenir de Wat Tyler, un des leaders de la révolte des Paysans sous le règne de Richard II.
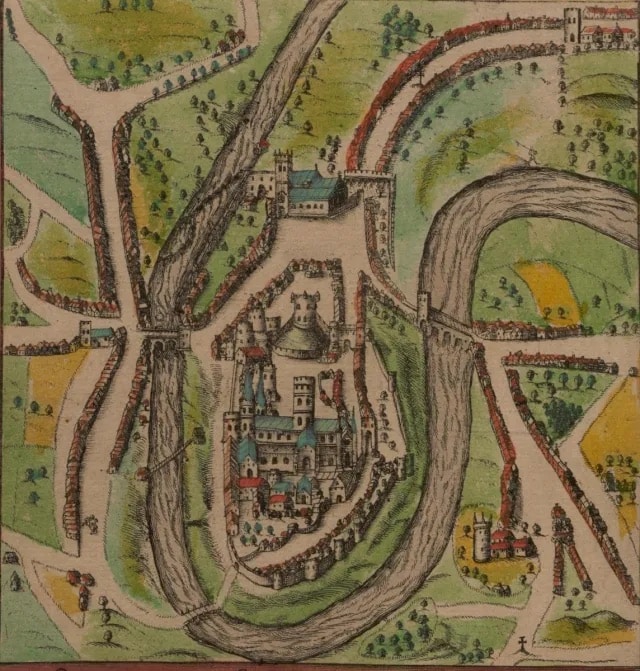
L’histoire de la destruction du village commence par la haine entre deux familles. Alice, la femme de Henry Payne, brasse la meilleure bière de Segerston, ce qui excite la jalousie et les calomnies de Joan Deepslough, épouse du nouveau Reve, Ralf, qui use avec jubilation des pouvoirs de sa charge contre les Payne en les accablant de travail. Les recours à la justice sont inopérants. La communauté villageoise se tait, rongée par la disette, la peur des sanctions, la corruption. Absolution, sacrements, extrême-onction, peines de purgatoire écourtées, tout se paie au prix fort, bien trop élevé pour leurs ressources. Coût de la communion accordée à Henry mourant : deux shillings, destinés à remplacer le vitrail sud de l’église. Il en gagnait seize en un an de travail forcené.
Pearl Eye, esprit frondeur, perturbe le Mystère du Jugement dernier avec ses notes discordantes, accuse de simonie les Orfèvres qui jouent les rôles du Christ et de l’Ange, et se fait rouer de coups. Mais attention, le conteur ne veut pas dire qu’il n’y avait que d’avides sangsues dans l’Église. Ce sont les mots de Pearl, et non les siens, il se contente de répéter les scènes terrifiantes que lui a racontées son ami, et loue la bonté des prêtres qui agissent pour le bien des âmes, la sage autorité des puissants, garants de l’ordre au sein de la communauté. La stratégie de Mother Naked, celle du romancier, consiste à manœuvrer adroitement pour capter l’attention de ses auditeurs et déjouer leur méfiance. Comme dans une enquête policière, il ménage le suspense, chaque révélation viendra à son heure. Tandis que l’on sert aux convives du cuissot de chevreuil rôti, il déroule l’enchaînement fatal qui a gangrené le village.
Le fin mot de l’histoire, lui a expliqué le docte Pearl Eye, c’est que nous créons nos propres monstres en nous efforçant d’échapper à la vérité qui nous effraie. Le conte est entrelardé de digressions comme autant de paraboles. Celle de saint Matthieu, sur l’ivraie et le bon grain, va jouer un rôle crucial dans l’intrigue. Faussement naïf, à mesure que ses auditeurs s’abrutissent de boisson, le conteur se livre à une critique de plus en plus sévère de la classe dominante, dont fait partie la guilde des Merciers, et finit par les injurier ouvertement quand il approche de sa conclusion, élégants fumiers, merde sous des vêtements de soie et de lin doré. Eux n’ont pas souffert de la crise, la pression s’exerce toujours sur les plus pauvres. Eux sont à l’abri des sanctions, protégés par leur rang et leurs richesses. Ils font des legs importants à leur paroisse, disposent d’un autel séparé, paient un prêtre pour dire les messes qu’ils ont composées et choisies. « Que ce doit être commode de dicter la parole protectrice de Dieu, afin que vous puissiez faire affaire en toute sérénité. » Les dernières pages livrent l’ultime rebondissement de cette tragédie mouvementée en dénonçant les coupables d’une série d’assassinats.
Dans un entretien avec l’écrivain Joe Bedford, Glen James Brown explique comment et pourquoi il s’est construit une méthode de recherche originale [1]. Il voulait montrer que la vie des pauvres n’était pas constamment malheureuse, donner l’impression forte de la vie d’une communauté rurale, faite de fardeaux et de joie partagés. Mais il a beau croire que l’amour et la bonté existent encore, ses personnages en donnent rarement l’exemple. Dans le système économique qui les opprime, et qui pointe du doigt le nôtre, tous les liens de solidarité ont été détruits. Un seul personnage fait preuve d’une vraie générosité, en partageant avec les malades son savoir et ses remèdes efficaces, qui lui valent bien sûr d’être mis au ban de cette société gouvernée par les superstitions.
Quant à ses recherches, Brown se définit comme « a grammar nerd », un obsédé de la grammaire. Sa méthode empirique l’a conduit vers les romans de chevalerie, les recettes de cuisine médiévale, et vers Chaucer, dont il ne s’est pas risqué à singer la langue. Il a peaufiné ses archaïsmes au nez, à l’oreille, en insistant sur ce qui sonnait lisible, et qui donnerait à son narrateur une voix juste. Aussi a-t-il pris soin d’éviter tout ce qui pourrait ressembler à du Shakespeare. Ce qui ne l’empêche pas d’emprunter des éléments structurels aux revenge tragedies, également en vogue sous le règne d’Elizabeth. Parmi ses nombreuses sources d’inspiration, il cite une demi-douzaine d’auteurs qui ont affronté le risque de créer une langue originale dans le but de suggérer un avenir proche, comme Anthony Burgess, ou refléter un temps révolu, comme James Meek, sans forcément s’imposer l’exactitude.
Une quantité de ritournelles en vers de mirliton vient encore compliquer la tâche de la traductrice, dont les choix ne sonnent pas toujours aussi justes et lisibles que le voulait Brown. Il a choisi d’éviter les didst authentiquement médiévaux mais difficiles à prononcer, elle saupoudre les discours par ailleurs châtiés de son narrateur de quelques termes populaires et de contractions, « j’prends ce qui s’présente », « si vous t’nez à la vie », « dommage qu’il n’en soit de même pour ton Vrai Cul ». Son éditeur devrait changer de correcteur : automatique, ou pressé, il a laissé passer nombre d’accords fantaisistes, « son intervention avait suffit », « je voulais que Segerston voit », « les choses avaient beaucoup changées ». La fortune fait tourner non pas une mais des roues. Hugh de Tanfield bat le record de Melchisedech (465 ans) en atteignant sa « quatre-vingt-dixième décennie ». Cela dit, la VO – « Now Hugh, you be in thy ninth decade, and look at thee ! » – ferait bondir un auteur médiéviste de whodunit, et en effet ni Shakespeare ni ses confrères n’useraient d’une grammaire aussi douteuse.
Claire Charrier traduit avec élégance, mais sans audace. Loin de chercher à rendre les archéo-néologismes de l’original, elle se garde d’inventer. Et elle coupe, simplifie, gomme les nuances. Ainsi, « rustics did not possess the liberties they flaunt in these modern tymes », devient « les paysans ne disposaient pas des mêmes libertés qu’aujourd’hui », effaçant rustics (rustauds), they flaunt (font étalage), these modern tymes (ces temps-ci) qui adoptent le point de vue méprisant de ses auditeurs pour se les concilier. Le fantôme, the Fell Wraith, n’est plus qu’un banal Spectre. Pearl se réchauffe près d’un feu humide et fumant, alors qu’en anglais il s’en rapproche aussi près qu’il le peut sans s’évanouir. Brown forge des conjugaisons barbares, I telt thee, you hast, could not hath come, et détourne ou chantourne les mots. Le nom de l’hérésie Lollard viendrait de lolium, l’ivraie, une étymologie improbable que mentionnait l’historien George Lyttleton. Furlough n’a jamais été une mesure agraire mais une mise au chômage provisoire, ici confondu ou fusionné avec furlong, la distance qu’un bœuf peut labourer d’une seule traite. Claire Charrier corrige discrètement en substituant aux furloughs des sillons, qu’elle découpe en hectares. La langue de la traduction est intemporelle, grammaticalement correcte, sans anachronismes flagrants si on oublie les hectares et les kilomètres, ni parfum médiéval, synthétique ou non. Brown, certes plus créatif, est encore très loin d’atteindre le niveau du nadsat que parlent les droogs de Clockwork Orange, de la novlangue d’Orwell, ou de l’orghast savant de Ted Hugues. Dans quel univers, quelle langue se déroulera son troisième roman, tous les progrès sont possibles, tous les espoirs permis.












