Affirmer que le Dictionnaire critique de l’Église (DCE) représente désormais un des beaux fruits de la véritable révolution épistémique qui a touché l’histoire religieuse, comme discipline historiographique, en France, depuis les années soixante du XXe siècle, ne paraît pas excessif.
Encore minorée dans l’Université française aujourd’hui, l’histoire religieuse s’intègre pourtant toujours plus au chœur des sciences sociales et démontre, avec ce formidable outil scientifique, combien elle peut puissamment éclairer la genèse des sociétés contemporaines, dévoiler des inconscients théoriques, des adhérences cachées au cœur des débats ‒ on songe, bien sûr, à ceux autour de la laïcité, mais aussi bien à ceux autour du rôle l’État, de la justice, etc. ‒ d’une certaine naïveté scientifique, qui se croit intégralement libérée du poids du passé, et montre enfin qu’elle doit être utile dans la définition d’institutions propres à la modernité tardive, qui se caractérise par ce sentiment que le projet moderne n’a pu encore exprimer pleinement sa spécificité. En un mot, la discipline historique dite « histoire religieuse » est légitime, elle dépasse largement les frontières de la « religion » et elle le prouve avec l’apparition (plutôt que la parution) de ce dictionnaire. Une telle œuvre collective a sans doute été rendue possible aujourd’hui, d’une part à cause de l’affaiblissement, au sein des sciences sociales, des paradigmes explicatifs, et, d’autre part, grâce à la conscience toujours plus aigüe de la genèse de ces mêmes sciences sociales à l’intérieur d’un riche héritage théorique, aussi bien théologique que juridique ou philosophique, développé dans la longue histoire du christianisme.

Avant d’aller plus loin, il faut évoquer la forme du pondéreux objet lui-même. Elle tranche sur celles des autres dictionnaires de la collection des Presses universitaires de France. Les concepteurs ont préféré la justification pleine page aux doubles colonnes habituelles. Ce choix de mise en page fait de chaque entrée davantage un dossier qu’un « article ». Il met en scène le processus de production du dictionnaire. Loin du modèle de la commande d’article par un comité éditorial pilote, il s’agit vraiment d’une œuvre élaborée collectivement depuis 2016 lors de séminaires, au cours desquels les différents auteurs n’ont pas hésité à livrer leurs textes à la discussion commune avant de parvenir à une version définitive. La formule du dossier réduit le nombre d’entrées. Le Dictionnaire critique de théologie, par exemple, paru aux PUF en 1998, et auquel les auteurs du DCE se réfèrent souvent, en compte davantage. Le lecteur, notamment, ne trouvera pas d’article « Concile », cette notion étant traitée, entre autres, dans le dossier « Synodalité », pas plus que d’entrées nominales, elles sont exclusivement thématiques. Le lecteur a même failli échapper à un article « Papauté », selon l’aveu d’Alain Rauwel, l’un des trois directeurs du DCE, dans Le Monde (26 septembre 2023). Et l’on pense à la préface que donnait Alfred Baudrillart au Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE), dont le premier fascicule parut en 1912, qui avertissait de la difficulté d’une telle entreprise en ce qu’elle comportait en elle-même une infinité d’articles.
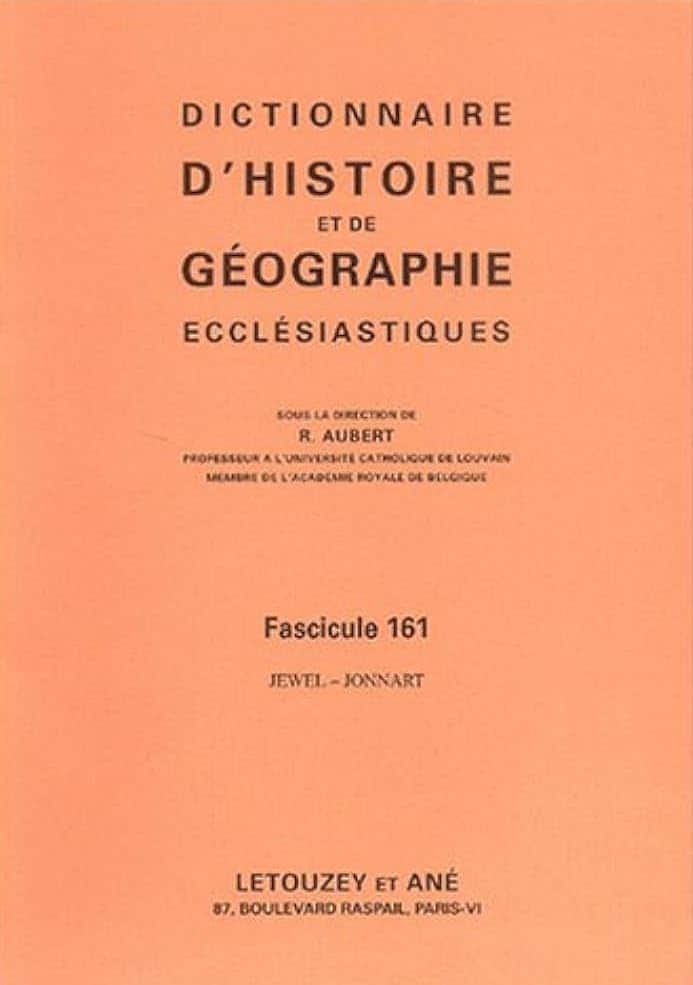
Cet écueil est évité par le DCE, qui n’a pas l’intention « d’abord d’élaborer un livre « de contenu », comme une histoire de l’Église découpée en articles », comme le précise un des textes-accroches préparatoires aux séminaires. Et, puisque nous évoquons ce monument d’érudition qu’est le DHGE, il faut évidemment souligner une autre différence : le DHGE se voulait, selon les mots de la préface, « scientifique et catholique », le DCE se veut « critique », rigoureusement constitué par le regard des sciences sociales. Reste que le choix du dossier peut parfois se retourner contre la « forme » dictionnaire, pour reprendre une des expressions favorites des auteurs, en ce que la synthèse, ce que doit être un article de dictionnaire, est parfois perdue, certains textes allant même jusqu’à se concentrer sur des points très (trop ?) circonscrits, retrouvant par ce biais un des défauts des ouvrages collectifs. Dernier aspect formel à souligner et à saluer : la performance éditoriale, qui réjouira la communauté scientifique, que représente la bibliographie raisonnée finale, forte de plus de 200 pages !
Les difficultés sont nombreuses pour mener à bien l’ambition portée par le DCE. La première réside dans la définition de l’objet. Non seulement l’auto-compréhension de l’Église a varié de manière importante au cours de l’histoire, mais au sein des sciences sociales elles-mêmes le débat continue. Entre Durkheim qui nomme « Église » tout « système solidaire de croyances qui unit une communauté morale » et Weber qui la considère comme « une entreprise institutionnelle de caractère hiérocratique, dont la direction administrative revendique le monopole de la coercition hiérocratique », la différence n’est pas mince. L’Église-institution, l’ecclesia, coextensive à la société médiévale, selon l’hypothèse fructueuse de l’historien Alain Guerreau, l’Église-Christianisme, la congregatio fidelium, et tant d’autres aspects d’un phénomène social complexe… les auteurs ont choisi de ne pas se focaliser sur un travail définitionnel et de mettre en avant la notion d’« ecclésialité », véritable fil rouge du dictionnaire, préférée à la proposition d’Alexis Fontbonne de « champ ecclésial » (cf. Archives de sciences sociales des religions, n° 200, décembre 2022), c’est-à-dire « un état des pratiques par lesquelles l’ensemble des personnes (institutionnelles ou non, collectives ou individuelles) qui considèrent appartenir à une « Église » se rapportent à cette communauté et les uns aux autres et par là l’imaginent de manière performative comme leur horizon ».
En somme, l’objet n’est pas tant l’Église elle-même que ses « modes d’advenir à elle-même comme espace social ». L’ecclésialité, c’est le « faire Église », et cette modalité permet de dépasser la fameuse opposition secte-Église (la secte étant censée résulter d’une affiliation volontaire, l’Église d’une incorporation native), puisque, dans son histoire, l’Église se montre les deux à la fois dans la mesure où elle s’inscrit dans la transmission générationnelle (le baptême des nouveau-nés) tout en exigeant une confession de foi explicite et librement assumée. Constatons, pour terminer sur ce point, que les sciences sociales rejoignent ici un des leitmotivs récurrents de la pastorale d’après-concile Vatican II, dans laquelle les clercs invitent régulièrement les fidèles à « faire Église ».
Mais, une fois l’axe du dictionnaire établi, il fallait surmonter les biais, les impensés, les sédimentations conceptuelles et poser pour chaque notion le curseur des sciences sociales à l’endroit adéquat. Si, comme l’explique l’introducteur du dictionnaire, le coup de force, le rapt que Durkheim opère avec le mot « Église » pour lui faire désigner « toute communauté soudée par un ensemble de valeurs et de pratiques définissables comme religion », au point de faire que « l’ecclésial soit au cœur et à la racine du social », que « la forme-Église devienne comme matrice et paradigme potentiel de toute société – si du moins on entend société non tant comme un état stabilisé que comme un processus, une dynamique », ce « vol » conceptuel n’aura été possible que parce que la théologie, dans son histoire, a construit son ecclésiologie sur le modèle de la polis aristotélicienne, puis, à l’époque moderne, selon le modèle de la « société » qui s’établit en grande partie contre elle et sur des fondements contractuels, l’Église serait « société parfaite », où l’on entend encore le concept aristotélicien d’accomplissement téléologique de l’essence de la polis, mais surtout un besoin de réaffirmation par rapport à une instance en train de devenir dominante, l’État.
Autrement dit, on pourrait affirmer qu’il y a dans l’intérêt des sciences sociales pour l’ecclésialité comme un juste retour des choses. L’Église s’est conçue elle-même comme société et les sciences sociales le lui ont bien rendu. Si bien que toute cette « dynamique » recouvre un double chassé-croisé : non seulement la « société », l’État, les institutions modernes, se sont construites en miroir de celles de l’Église, il suffit de penser à l’effort des canonistes de la fin du Moyen Âge pour donner un status à l’Église comme « corporation », effort repris par les cours princières pour élaborer le pouvoir royal en son administration, mais il faudrait mesurer en retour ce que le discours ecclésiologique, relativement tardif, emprunte à la conceptualité « politique », au sens aristotélicien d’abord, puis au sens moderne de la « philosophie politique » naissante. Si bien que l’expression qui synthétise le mieux une histoire longue de l’Occident (un Occident large incluant les Orients grec et moyen-oriental) est bien celle, employée par le philosophe Jean-François Courtine, d’époque de l’« ecclésiologie-politique », dont nous ne sortons que très lentement.

Cette situation entraîne une instabilité constante dans le traitement des notions du DCE, qui offre à la fois des textes franchement théologiques et d’autres relevant davantage du descriptif des sciences sociales. Ce balancement est assumé. Il illustre un dialogue entre des sciences sociales conscientes de leur histoire conceptuelle et une théologie ne pouvant plus les ignorer. Mais peut-être y sent-on une certaine réserve ou timidité qui empêche de mobiliser entièrement les sciences sociales pour explorer toute la construction historique d’un système de médiation et de représentation, reconduit, en partie malgré elle, par la modernité. Peut-être aurait-il fallu recourir davantage à l’histoire comparée et à l’anthropologie comparée, notamment entre les monothéismes, ce que laisse entrevoir l’article « Médiation », pour éclairer le régime chrétien de la délégation, de la « représentance » (quelques exemples : quel régime de médiation engendre la présence torahique de Dieu par rapport à la présence du Logos ressuscité ? ou, pour l’islam, quelle différence entre l’apostolicité chrétienne et la succession califale – le mot calife signifiant le successeur, et, partant, quelle différence dans les modalités d’unité et dans le processus de rupture schismatique ?), ou s’appuyer plus encore sur les analyses que peut produire une histoire-sociologie au-delà de l’opposition Durkheim/Weber – il faut remarquer que l’équipe du dictionnaire compte une majorité d’historiens ‒, je pense, entre autres, aux célèbres articles de Pierre Bourdieu, « Le mystère du ministère » (Actes de la recherche en sciences sociales, n° 140, décembre 2001), et, plus ancien, « La délégation ou le fétichisme politique » (Actes, n° 52-53, 1984), dans lesquels le sociologue explique les mécanismes en œuvre dans les institutions (Église, État, etc.) qui « se font en se faisant », engendrant ainsi ce qu’il appelle « l’illusion de l’appareil ».
Michel de Certeau, très sollicité par les auteurs du DCE, se demandait dans un livre important trop oublié, Le christianisme éclaté (Seuil, 1974), si l’Église n’aura été « qu’une figure historique de la question de Dieu, une variante proportionnée à un système en train de disparaître ». Certainement, cette perte du sol, du « lieu », explique en partie, avec les raisons avancées en commençant, la possibilité même du DCE. Le dictionnaire, pas plus que le jésuite, ne répond à cette question, mais il a le grand mérite de l’« exposer », comme on le dit dans le vocabulaire de la radiologie, à l’intelligence prospective d’un monde de plus en plus mis en demeure de donner naissance à des institutions renouvelées. Nous saurons, en examinant le synode romain d’octobre 2023, si l’Église catholique, comme à Vatican II et autrement, en prend ou non le chemin.












