Depuis qu’une certaine raison a construit notre monde, celui du « ça marche » de la science, depuis que celle-ci a conquis à peu près toutes les anciennes possessions de la philosophie, ce qui reste, le « reste » de ces annexions successives, ne sait plus où trouver une présence, une « utilité sociale », une force capable d’informer la « réalité ». Impuissance de la pensée dans ses modes d’expression habituels, le livre, la dispute, réduite au bavardage du « cause toujours », pendant que les choses sérieuses se passent ailleurs. C’est pourquoi il peut être intéressant de reprendre en arrière le mouvement du temps, de se transporter dans un moment où les jeux n’étaient pas encore faits, où il pouvait encore arriver à la raison des « aventures », non au sens galant de l’expression, mais plutôt dans celui des contes philosophiques du XVIIIe siècle : « où l’on voit la raison décliner ses saisons ». Quatre livres récents, dont deux rééditions, nous ouvrent au moins deux saisons. La première, avant la Grande Guerre, réunissant Péguy et Benda, la seconde, appelons-la par commodité celle des « années trente et quarante », reliant Benda, notre fil d’Ariane, Alquié et Patočka.
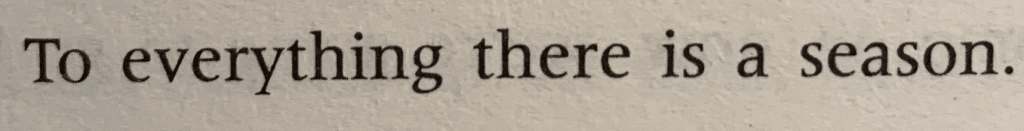
Pourquoi instituer Julien Benda en Virgile de notre voyage ? C’est la réédition du livre que Pascal Engel lui consacra en 2012 qui nous en donne l’occasion. La longévité relative de l’auteur de La trahison des clercs (1867-1956) et son énergie batailleuse font de lui un témoin, bien oublié, souvent qualifié de « figure secondaire », mais, comme souvent, pour cette raison, symptomatique de ce que l’histoire de la pensée, à l’orée du XXe siècle, a appelé la « crise de la raison ». Pascal Engel, comme il le reconnaît, a mis « beaucoup de lui-même » dans cet ouvrage, qui n’est pas sans faire penser aux deux livres de Vincent Descombes Le même et l’autre et Philosopher par gros temps (Minuit, 1979 ; 1989), dans la mesure où il s’agit, à travers le portrait d’un inactuel, d’un « a-moderne » de déployer à la fois le bilan de plus d’un siècle de philosophie et une défense et illustration d’un « rationalisme de doctrine » contre tous les irrationalismes, qu’ils soient philosophiques, esthétiques ou politiques.

Benda, « l’artiste de la raison ou styliste d’idées », disciple du néokantien républicain Renouvier (1815-1903), a porté sur son siècle un jugement très sévère. Au moment où apparaît la fameuse crise des fondements des mathématiques, où sont bousculés par la physique les concepts d’espace et de temps, de nécessité et de causalité, où le langage lui-même cesse d’être transparent, Benda réaffirme l’éternité des lois de l’esprit et des règles de la logique. Il semble réitérer la scène inaugurale de la Métaphysique d’Aristote qui voit les sophistes mis devant leurs contradictions et les règles du vouloir dire placées sous la dépendance de l’ontologie. Ce que diagnostique Benda, c’est, avec le retour du « mobilisme » (il dénonce par là aussi bien les concepts « fluides » bergsoniens que la raison élargie de Léon Brunschvicg), une nouvelle crise sophistique de la raison sous la forme de son abandon pur et simple au profit d’un mysticisme vague, d’une sentimentalité impressionniste. Pascal Engel, en animant son livre d’un mouvement de balancier, allant des époques de son héros à la nôtre, considère que les ennemis de Benda, et en particulier Bergson dont l’influence s’étendra sur toute la philosophie du XXe siècle (et pas seulement en France, comme on le verra pour Patočka), sont aujourd’hui encore les siens, que les pathologies du discours dénoncées par Benda sont encore celles de penseurs contemporains qui semblent oublier que la pensée ne peut échapper aux lois de la signification si elle veut dire quelque chose.
Dans notre première saison, Benda collabore étroitement avec les Cahiers de la Quinzaine. Dreyfusard, non par hostilité à l’antisémitisme mais par souci de la justice, Il y publie ses premiers essais et même un premier roman. Mais Pascal Engel nous éclaire sur ce qui va le séparer de Péguy : le bergsonisme, dont il est écrit dans la Note sur M. Bergson qu’il entend « servir la raison encore de plus près ». Ce qui n’empêchera pas la publication dans les Cahiers du deuxième pamphlet de Benda, Une philosophie pathétique, contre l’auteur de L’évolution créatrice.
Il se trouve que la collection GF nous propose une édition d’un texte de Péguy devenu difficilement accessible (sauf en Pléiade), Clio, dialogue de l’histoire avec l’âme païenne, assurée par un spécialiste de la littérature française du XXe siècle, Jean-Louis Jeannelle. L’ouvrage ne vise pas Benda, mais les historiens (Langlois et Seignobos) ; néanmoins, celui-ci aura certainement été heurté en voyant la durée bergsonienne ouvrir à Péguy le chemin d’une conception originale de l’Histoire, prise entre l’ordre du temporel et l’éternité. L’Histoire conçue comme celle du progrès, et dont la science historique se fait la servante en ne considérant que la chronologie, apparaît aux yeux de Péguy comme une « théorie de caisse d’épargne », fondée sur une représentation du temps confondue avec celle de l’espace. Et l’on reconnaît là la thèse défendue par Bergson. Loin d’offrir une théorie de la littérature, comme le dit l’éditeur de GF, Clio propose une véritable doctrine de l’évènement qui n’existe que sur le mode de l’inachèvement, ou plus exactement d’un va-et-vient entre achèvement et inachèvement.
Par ses « reports », ces « retours », l’évènement selon Péguy se rapproche de la « survivance » chez Aby Warburg et inspirera au grand historien Alphonse Dupront sa conception d’une histoire « transférentielle ». La force de l’évènement réside dans sa capacité à créer une « situation » qui dure, et Péguy est peut-être le premier à donner un sens nouveau à ce terme, avant même la phénoménologie. L’exemple paradigmatique dont se sert Péguy pour se faire comprendre est celui du texte et de sa lecture. Comme l’évènement, un texte, le sens d’un texte reçoit achèvement ou « désachèvement » de ses lectures, c’est l’ordre de « l’éternel temporel ». La lecture, modèle de l’historique selon Péguy, comme la mémoire (déjà opposée à la science historique), ne sort pas du texte-évènement, elle « le remonte en dedans ». Et Péguy d’utiliser des métaphores issues de l’acoustique : l’évènement (la « situation ») forme des « ventres, des nœuds, des vides, un rythme, peut-être une régulation, des tensions et des détentes, des points de vibration » ; ou bien de la physique : fusion, ébullition, condensation, coagulation, cristallisation.

Notre deuxième saison nous ramène chez les philosophes patentés. En 1946, Benda publie dans la Revue de métaphysique et de morale un compte rendu du livre d’un jeune auteur de trente-sept ans, Ferdinand Alquié (1906-1985), Le désir d’éternité (1943). Alquié n’apparaît à aucun moment dans l’ouvrage de Pascal Engel, parce que, sans doute, entre « la passion de la raison » d’Alquié et celle de Benda il y avait la mémoire encore vive du chant des sirènes surréalistes auxquelles le jeune auteur, natif de Carcassonne et visiteur de Joë Bousquet avec son ami René Nelli, avait un temps succombé. Ils auraient pu se croiser durant l’Occupation à Carcassonne où Benda se réfugiera, mais Alquié, depuis 1937, est revenu enseigner à Paris. La réédition des Études cartésiennes chez Vrin, opportunément augmentée de divers textes, dont un inédit centré sur la « querelle de la folie » entre Foucault et Derrida, nous permet d’instaurer un dialogue fictif, mais qui n’est pas sans fondement si l’on songe à la présence secrète et discrète, malgré tout, d’Alquié dans le livre de Pascal Engel : ce n’est sans doute pas par hasard que l’auteur a intitulé son chapitre conclusif « Solitude de la raison », qui se trouve être le titre d’un ouvrage d’Alquié paru en 1966 (réédition à la Table Ronde, 2018). Il a d’ailleurs consacré un article à Alquié dans EaN.
Benda aurait apprécié ce genre de propos : « le salut de l’homme ne peut se trouver dans l’homme tout entier, mais seulement dans cette partie de l’homme qui se nomme la Raison », et certainement aussi celui-ci : « l’homme ne peut pas dire « ma raison » mais seulement « la raison » », elle est non pas « ce que je porte en moi, mais ce qui me porte et peut rendre compte de moi ». Pourtant, après avoir loué le jeune Carcassonnais comme étant un « oiseau rare » qui use de distinction en philosophie, Benda, dans son article de la Revue de métaphysique et de morale, termine en le qualifiant de « philosophe de tribune » atteint du « stigmate moderne qui veut qu’il n’y ait point de vraie valeur morale hors de l’action ». Or, la seule « tribune » ayant mobilisé l’énergie du philosophe a été celle de la chaire d’enseignement, comme il l’explique dans un texte de 1963 (que Benda n’a pas pu lire), « L’évidence philosophique », qui montre, entre autres, combien Alquié a été fidèle aux vertus intellectuelles chères à Benda. Mais on peut imaginer que Benda se serait intéressé vivement aux débats entre Martial Guéroult et Alquié à propos de « l’ordre des raisons » chez Descartes au colloque de Royaumont de 1955 (soit un an avant sa mort). Il aurait penché plutôt vers la lecture « structuraliste » de Guéroult, en réalité plutôt logico-déductive, de l’ordre des raisons que vers celle, existentielle, d’Alquié. Il aurait détesté la « querelle de la folie » et, avec elle, l’intervention d’Alquié dans la discussion.

On le voit, le dialogue entre le rationalisme de Benda et celui d’Alquié s’avère difficile, mais les rééditions récentes des livres de ce dernier à la Table Ronde, et celle, précieuse, de Vrin, nous invitent à poursuivre cette confrontation. Peut-être la conclusion en serait-elle plus nuancée que le jugement de Merleau-Ponty sur Benda en 1948 : « Aimer la raison, comme le fait Julien Benda – vouloir l’éternel quand le savoir découvre toujours mieux la réalité du temps, vouloir le concept le plus clair quand la chose même est ambiguë, c’est la forme la plus insidieuse du romantisme, c’est préférer le mot de raison à l’exercice de la raison. » (Causeries radiodiffusées, 1948 ; Seuil, 2002)
Mais il est temps de terminer notre voyage en restant dans notre saison des années sombres. Nous allons cette fois rejoindre le philosophe Jan Patočka (1907-1977) que Benda n’a pu ni connaître ni lire. Mais, là encore, il va être question de raison et même de fondement de l’objectivité. En 1939, le penseur tchèque vient de soutenir son habilitation (1936) et il s’apprête à passer les années d’occupation nazie dans l’enseignement secondaire. Les éditions Vrin viennent de publier un recueil de textes inédits sous le titre d’Intériorité et monde, que l’ardente traductrice de Patočka, Erika Abrams, et les éditeurs en langue originale datent des années 1939-1940. Ils représentent un jalon important dans l’évolution de la pensée de l’auteur des Carnets philosophiques, dans lesquels, au passage, Benda n’a qu’une présence réduite (deux mentions critiques).
Appartenant à la tradition phénoménologique et influencé par Bergson (encore lui), Patočka repose la question, vieille question dont il dit qu’elle n’est pas « le foyer central de la philosophie, mais s’en approche », de l’idéalisme et du réalisme. Sans donner raison à l’idéalisme, qui aime à « se donner les airs de rationalisme absolu », il constate « l’impensabilité d’un être purement objectif ». Seul un être possédant un « esprit », autrement dit une « distance à soi », peut faire naître un rapport effectif avec une réalité extérieure. Autrement dit, la distinction cartésienne entre une res cogitans, pure intériorité, et une res extensa, pure extériorité, tombe dans une impasse ontologique. Reprenant à sa façon la méditation kantienne sur la « synthèse » et sur le concept inobjectivable de « monde », Patočka (re)découvre que la synthèse esthétique (au sens de l’aisthêsis, la perception) est « l’acte commun du sensible et du sentant » pour parler comme Aristote (ce qui fait écho à la doctrine de Péguy sur la lecture comme « acte commun du lisant et du lu ») et va accomplir dans ces années un pas de plus vers une phénoménologie a-subjective offrant une issue au dualisme objet-sujet.
Avec ce dernier livre, nous sommes au fond du problème que pose le rationalisme version Benda. S’il entend défendre la logique et les vertus intellectuelles, il ne semble jamais poser la question de la « logicité » dans son étroite relation avec l’ontologie, du ce qui nous est donné à penser et de ce qu’il révèle à l’esprit dans son acte du comment le penser. Il envisage l’organon, pour reprendre encore un vocabulaire aristotélicien, sans s’engager dans le discernement ontologique qu’il présuppose, comme si les fondements de l’objectivité – régime moderne de l’ontologie ‒ étaient évidents. En refusant les questionnements des philosophes de son temps, Benda, aurait-il, non pas repoussé l’idée de vivre avec son temps, mais appauvri le thaumazein philosophique ?












