Adoptant des démarches très différentes, trois ouvrages parus cet automne relatent le sort fait aux peuples autochtones. Le génocide des Amériques revient sur la période de la conquête et dresse un tableau synthétique des assassinats de masse dont furent victimes les populations amérindiennes et caraïbes, Vies de Samis exhume l’histoire ignorée de ces éleveurs de rennes chassés de leurs territoires du nord de la Scandinavie, tandis qu’Allons enfants de la Guyane est consacré au destin des enfants autochtones, enlevés à leurs familles et placés dans des pensionnats religieux. Leurs auteurs, usant d’écritures très différentes, s’attachent à sauvegarder la mémoire de ces violences, en plaçant au cœur de leurs travaux les témoignages des principaux protagonistes pour composer avec ces archives un récit polyphonique.
Elin Anna Labba, Vies de Samis. Les déplacements forcés des éleveurs de rennes. Trad. du suédois par Françoise Sule. CNRS, 216 p., 23 €
Marcel Grondin et Noema Viezzer, Le génocide des Amériques. Résistance et survivance des peuples autochtones. Trad. du portugais (Brésil) par Yves Carrier et Raymond Levac. Écosociété, 360 p., 20 €
Hélène Ferrarini, Allons enfants de la Guyane. Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République. Anacharsis, 288 p., 16 €
L’ouvrage de Marcel Grondin et Noema Viezzer, initialement paru au Brésil, comprend pour cette édition en français une partie due à Pierrot Ross-Tremblay sur le sort des populations amérindiennes au nord des Amériques. Nécessaire ajout, tant il convient aujourd’hui de lire ensemble les multiples épisodes de la conquête qui constituèrent ce que les spécialistes et les militants qualifient de « génocide » sur les populations autochtones : un génocide faisant près de 70 millions de morts. Il n’est pas étonnant que l’ouvrage soit publié au Canada car cet événement global est omniprésent en Amérique du Nord. La littérature, comme souvent, avait devancé les sciences sociales, avec en particulier les récits du romancier ojibwé Richard Wagamese (1955-2017) dont plusieurs ouvrages, comme Indian Horse (Jeu blanc) qui évoque en particulier les violences sexuelles infligées aux adolescents amérindiens, ont été traduits ces dernières années par Christine Raguet aux éditions Zoé.
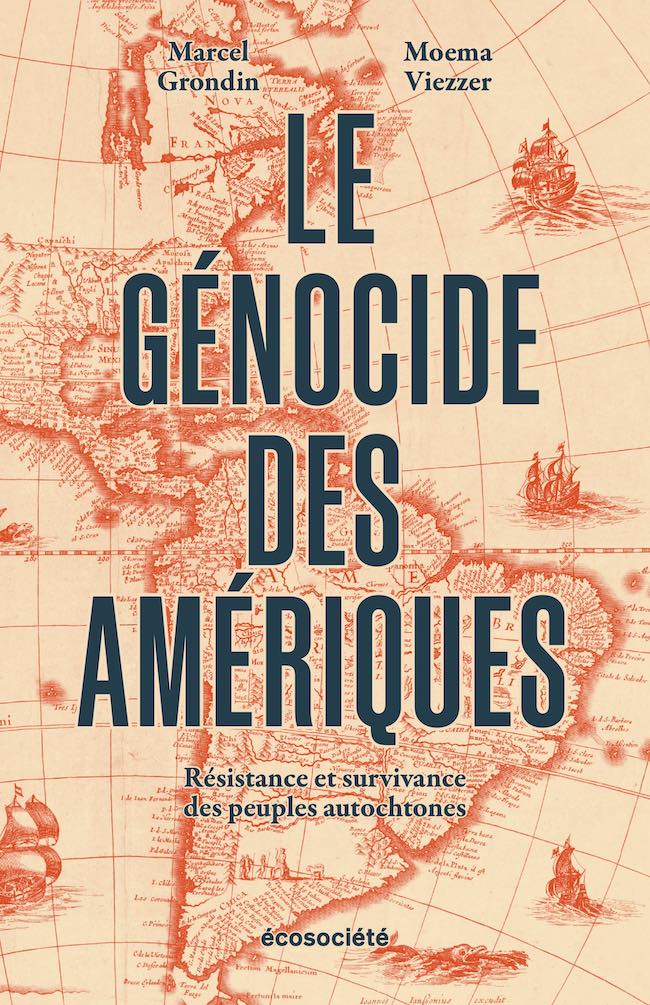
Le génocide des Amériques est un « livre noir » des crimes commis sur les peuples autochtones. Sa structure suit leurs différentes étapes depuis l’arrivée de Colomb dans la Caraïbe ; tour à tour, et en faisant une place importante aux données démographiques et aux différentes modalités de ces crimes de masse, sont abordés les cas du Mexique, des Andes centrales, du Brésil, puis des États-Unis et du Canada. L’un des intérêts de cette synthèse est qu’elle fait aussi une large place à la « résistance » de ces sociétés confrontées à cette violence. Les auteur.e.s ne cachent pas le caractère militant de leur entreprise. L’ouvrage s’achève d’ailleurs sur le très contemporain en évoquant la manière dont, unis sous un même nom, celui de peuple d’Abya Yala, les rescapés de ces populations originaires des Amériques sont engagés depuis l’an 2000 dans un « processus de construction politique d’identité » collective qui prend la forme de grands rassemblements réguliers (le premier à Teotihuacan au Mexique) et s’efforcent, en partageant leurs expériences, de « décoloniser » le regard de ces communautés sur elles-mêmes et de s’approprier cette histoire douloureuse.
À la conquête succéda la colonisation, et c’est à cette période plus contemporaine, le XXe siècle, que deux ouvrages s’intéressent en révélant par des enquêtes très documentées des événements méconnus et surtout effacés de notre histoire : le premier a pour cadre l’une de nos colonies, la Guyane, et pour objet l’histoire du placement d’enfants amérindiens dans des institutions religieuses disciplinaires ; le second a pour cadre un territoire qui s’étend en Europe du Nord, entre la Suède et la Norvège, et pour objet le déplacement autoritaire du peuple Sami. Ces deux publications se rejoignent en choisissant de prêter attention, plutôt qu’aux mots autoritaires de ceux qui pensèrent et orchestrèrent les tentatives de destruction de ces cultures autochtones, aux voix, aux visages, aux histoires singulières de celles et ceux qui en furent victimes. Loin d’en écrire les tombeaux, leurs auteures parviennent, et l’entreprise n’est pas aisée, à nous faire entrer dans ces histoires violentes.
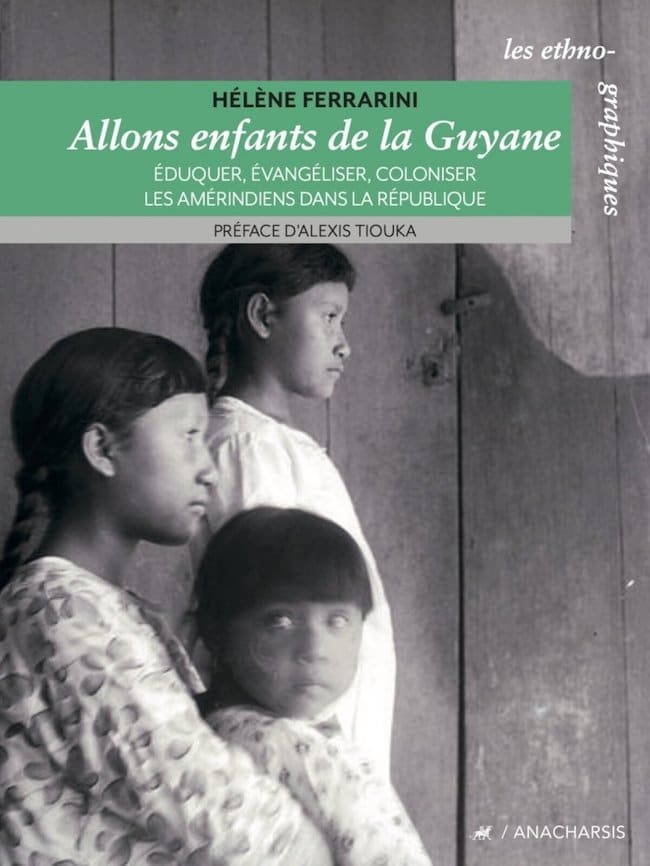
C’est en journaliste connaisseuse de ce singulier territoire qu’est la Guyane française – elle couvre son actualité pour plusieurs médias « métropolitains » — qu’Hélène Ferrarini a mené son enquête. Chez nombre d’habitants des rives de l’Oyapock, le terme de « Homes indiens » est aujourd’hui encore dans les esprits. La survivance jusqu’aujourd’hui dans la région de Mana de cette étrange institution qui commence à se développer au début des années 1930 est au centre de sa recherche : comment, avec la départementalisation de la Guyane en 1945, ces institutions religieuses ont-elles pu continuer à soustraire à leurs familles des centaines d’enfants pour les placer dans ces internats ? Hélène Ferrarini montre que, malgré l’absence de tout concordat, l’État colonial français et l’Éducation nationale ont, avec l’accord du préfet, délégué à des religieux, sans le moindre contrôle, le pouvoir d’éduquer des enfants amérindiens et un neuvième du peuple marron Boni.
Ce sont ainsi plusieurs milliers de jeunes gens qui ont été retirés de leur cadre familial, « recueillis temporairement » et soumis à une vie collective sévère. La journaliste raconte chacune des étapes du dévoilement de ce qui constitue un véritable scandale d’État (sans avoir la dimension des institutions dénoncées il y a peu au Canada qui ont « discipliné » des dizaines de milliers de jeunes Amérindiens en leur infligeant de nombreux sévices). Un dévoilement difficile, tant les bouches sont « paralysées » (dans le cas des victimes) ou volontairement closes. Restent les archives que Ferrarini a retrouvées et qui donnent à voir noir sur blanc cette pratique, avec le témoignage notamment du géographe Jean Hurault, qui dénonça dans plusieurs livres parus au début des années 1970 les dangers de cette éducation forcée en internat.
Si elle n’a jamais pu accéder aux archives de la dizaine de « homes » qui fonctionnèrent, et si elle se confronte à un véritable mur de silence de la part des responsables de l’éducation et de l’aide à la jeunesse, Hélène Ferrarini a constitué une énorme base de témoignages qui raconte de l’intérieur ces « homes ». La première des violences est l’obligation d’abandonner sa langue et de parler français – soulignons que l’interdiction de parler créole dans les Antilles françaises dans les cours de récréation a perduré jusqu’aux années 1980. La deuxième violence à laquelle ces enfants sont soumis est un processus d’acculturation par une évangélisation sans limite – « on priait comme des dingues », dit l’un d’eux. La liberté dont jouissent les jeunes filles est moindre que celle des garçons, et, pour certaines, le « home » devient leur lieu de vie : elles n’y apprennent plus, elles y travaillent aux emplois les plus bas (cuisine, ménage, etc.). Hélène Ferrarini creuse cette histoire à l’inverse des orpailleurs guyanais : elle sort non des pépites mais une boue, une mémoire boueuse qui contribue à expliquer l’état de la Guyane, les conflits entre les communautés et surtout la violence qui la mine.
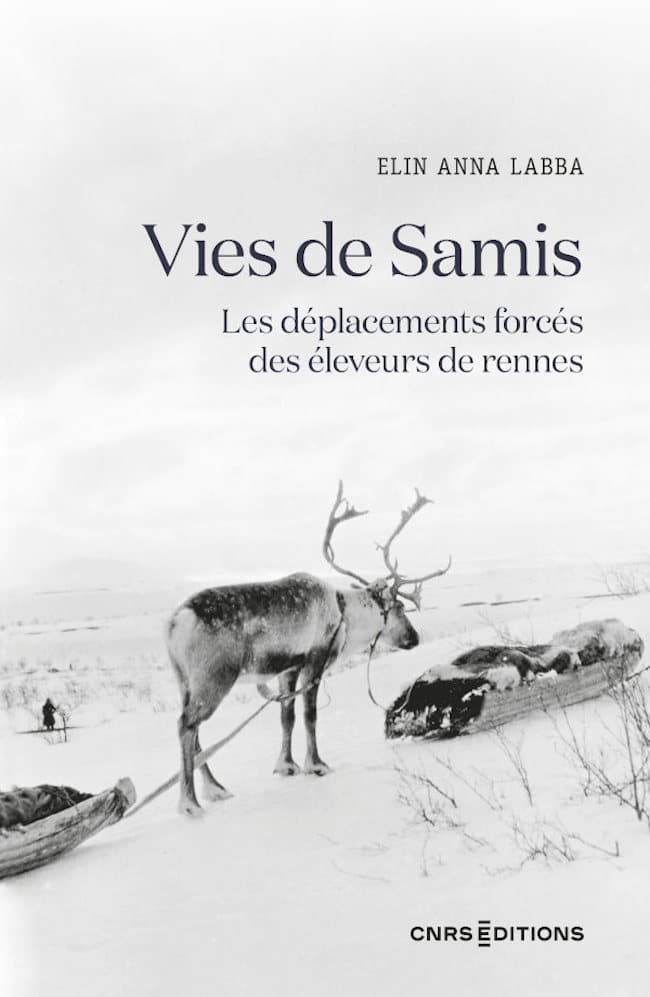
Vies de Samis est aussi une enquête sur un fait colonial méconnu mais, d’emblée, comme on le comprend à la lecture de la préface très claire de l’ethnologue française Marie Roué, il s’agit d’abord ici de retisser une pièce manquante de l’histoire, avec un ensemble de matériaux hétérogènes (photographies, reproductions d’archives, paroles de chants). La suédoise Elin Anna Labba nous associe à sa quête en adoptant un « je » de modestie et en composant un récit très sensible. Celui-ci prend la forme d’un « accrochage » d’une rare finesse, organisé chronologiquement entre les années 1920 et 1932, qui permet de plonger dans la vie quotidienne de quelques-un.e.s de ces éleveurs et éleveuses de rennes confronté.e.s à l’interdiction de pratiquer un élevage « extensif ». On suit ainsi plusieurs d’entre eux qui ont abandonné leur vie nomade dans l’immensité de la plane toundra pour rejoindre des lieux spécifiques dans les montagnes où d’autres communautés Sami élevaient également les rennes mais en les parquant, entrainant des conflits.
Si la dimension politique est largement présente – avec le mépris des accords signés en 1751 donnant à ce peuple autochtone la liberté de circulation sur un large territoire étranger aux frontières nationales –, Elin Anna Labba a trouvé une forme très originale pour « joiker » (un joik est une pratique traditionnelle de chant qui peut aussi bien évoquer un moment ordinaire de la vie domestique qu’un événement touchant toute la communauté) : un agencement de fragments d’entretiens, de photographies, de poèmes en langue sami, de directives gouvernementales. Servi par un travail graphique remarquable, qui n’esthétise ni ne dégrade les clichés, ce livre choral parvient – ce qui n’était pas facile – à restituer un peu de cette culture violentée. Surtout, il devient lui-même un objet réceptacle de cette culture. L’auteure, malgré son omniprésence, nous initie à cette poétique des éleveurs de rennes.
On le saisit très vite, ce que Vies de Samis raconte est l’histoire d’un fragment du monde, de la manière dont il a été effacé. Alors que sa tonalité pourrait être celle de la désolation, cet ouvrage est délibérément du côté de la vie, entendue comme cette relation singulière que les Samis entretiennent avec leur environnement. C’est moins un crime contre des humains que contre une forme de rapport au monde, contre un paysage, qui est mis en évidence. Remarquablement traduit du suédois mais aussi laissant parfois la langue sami se déployer sur des doubles pages (sans traduction), ce livre constitue le plus efficace plaidoyer pour les cultures autochtones. Il ne s’agit jamais de les constituer en modèles, comme c’est le cas chez certains anthropologues contemporains, mais plutôt de nous permettre d’y accéder, d’entendre résonner leurs joiks. Elin Anna Labba achève son ouvrage par ces mots : « Je décroche mon texte maintenant pour en transmettre les fils. Dans l’espace vide de l’histoire de la Suède, il reste beaucoup de place pour tisser nos modèles, avec une voix que ceux qui nous ont précédés n’ont jamais obtenue. » Livrant ces récits de vies, non comme des offrandes, mais comme des possibles.












