Cela fait des années maintenant que les éditions bilingues yiddish-français de la Bibliothèque Medem publient des auteurs majeurs de cette littérature, sans pouvoir franchir les limites d’une diffusion réservée aux connaisseurs et autres usagers de la Maison de la culture yiddish. L’année 2021 a été particulièrement faste puisque ont paru à très peu d’écart deux livres traduits à partir de l’œuvre foisonnante d’Aaron Zeitlin (1898-1973), l’un des grands poètes yiddish de la modernité, qui fut également dramaturge et romancier.
Aaron Zeitlin, Weitzmann II. Fantaisie en 14 tableaux. Trad. du yiddish par Evelyne Grumberg. Postfaces de Yitskhok Niborski, Evelyne Grumberg et Natalia Krynicka. Bibliothèque Medem, 243 + XLI p., 20 €
Aaron Zeitlin, Le dernier lointain. Poèmes choisis. Trad. du yiddish par Batia Baum. Choix, édition et présentation de Yitskhok Niborski. Bibliothèque Medem, 369 + XXXIX p., 20 €
La Maison de la culture yiddish propose également une exposition virtuelle autour d’Aaron Zeitlin.
La Maison de la culture yiddish organise, parallèlement à ses publications, des expositions et des cycles de conférences sur ces artistes ignorés par le grand public, trop souvent absents des rendez-vous hebdomadaires consacrés à la littérature dans la presse mainstream. À intervalles réguliers, et avec une impressionnante ténacité, toute une équipe unit ses forces et ses compétences pour faire paraître ces beaux volumes qui déroulent de droite à gauche, en sens inverse de nos habitudes de lecture occidentales, leurs versions en miroir, droite pour la traduction française, gauche pour le texte original en caractères hébraïques. Des couvertures aux facsimilés empruntant leurs motifs colorés aux avant-gardes du XXe siècle ont succédé plus récemment à la sobre couverture blanche des premiers ouvrages de la fin des années 1990.

Aaron Zeitlin (1929) © D.R.
Aaron Zeitlin est le fils d’Hillel Zeitlin, philosophe de la mouvance néo-hassidique des débuts du XXe siècle en Pologne, mort assassiné par les nazis en 1942. De l’héritage paternel tourné vers le bilinguisme hébreu-yiddish et l’activisme spirituel, Aaron a gardé une foi paradoxale et l’attrait pour la mystique ; mais il s’est aussi, à sa façon contradictoire et souvent sarcastique, à l’égal de son ami proche Isaac Bashevis Singer, frayé un chemin vers la littérature dans ses aspects les plus intramondains : teintés de complexité quant aux questions religieuses et de fidélité à l’invisible, mais aussi d’humour et de fiel quant à l’autosuffisance moderne. Tout ce parcours est minutieusement retracé dans les introductions de Yitskhok Niborski, auteur d’une thèse sur Zeitlin et médiateur de son œuvre en France.
Le premier ouvrage, Weizmann II. Fantaisie en 14 tableaux, traduit par Evelyne Grumberg, est une comédie grinçante aux accents tragiquement prémonitoires : écrite en 1934 (à part quelques remaniements datant de l’après-guerre qui sont pris en compte dans cette traduction), elle s’ouvre sur l’intervention toute-puissante du personnage de l’« Aryen » (dans la première version, il s’agit de Hitler en personne) qui, à l’orée de la Seconde Guerre mondiale, organise son programme d’émigration forcée de « l’élite juive » vers la Palestine ; le reste de la « marchandise juive » devra être « transporté plus tard ou détruit ».
Fantaisie bouffonne à la Ubu mais parfois aussi cruellement référentielle, la pièce déroule quelques lieux symboliques, entre diaspora et « terre promise », peuplés de personnages-marionnettes, représentant à gros traits, excessivement satirisés, les lieux communs d’un antisémitisme à la fois caricatural et outrancièrement ordinaire. Tous les poncifs antijuifs sont représentés par des noms propres-étiquettes, masques d’une histoire viciée par le poison de la propagande : le pouvoir de l’argent (Rothschild), de l’intelligence (Einstein), de la conspiration mondiale (les « sages de Sion », les dirigeants des différents congrès juifs et sionistes), les agitateurs politiques (Trotsky II, Jabotinsky, Simon Schwartzbard), la « belle juive » Alexandra, une actrice d’Hollywood, figure de la femme moderne et de l’amazone, les acteurs culturels (le metteur en scène de théâtre Reinhardt, le journaliste Abe Cahan, l’écrivain yiddish Sholem Asch), et jusqu’à Charlie Chaplin, « enjuivé » de force par les nazis et rebaptisé Kaplan, qui va être le caméraman de l’expédition.
Seule exception et « unique spécimen » représentant l’ancien monde, le chimiste Weizmann II (double grotesque de la figure bien réelle de Haïm Weizmann) est autorisé à rester en Angleterre au motif de ses trouvailles « géniales » en matière de « gaz ressuscitants ». C’est d’ailleurs grâce à cette « découverte », qui ranime les soldats morts, que l’Angleterre finit par vaincre l’Allemagne à la fin de la pièce. Nous sommes en 1934, il fallait à Zeitlin une certaine dose de courage pour imaginer un tel dénouement : dans la réalité, réfugié en 1939 aux États-Unis, il verra toute sa famille anéantie par l’Holocauste, ayant lui aussi l’impression, comme son personnage, d’être le « dernier juif ».
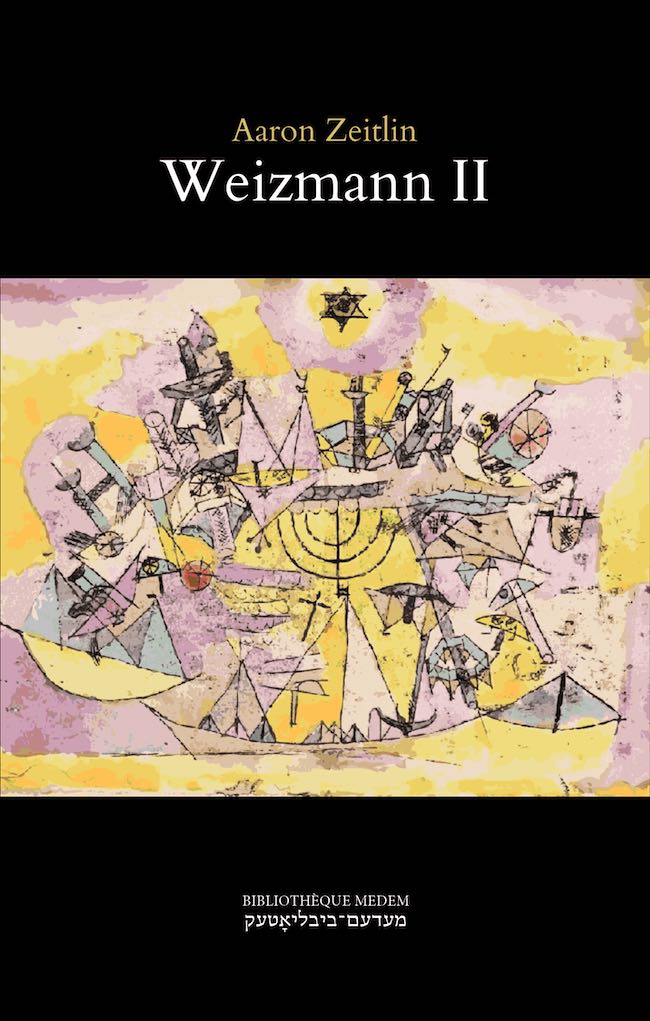
Le motif du carnaval est explicitement relié à l’un des tableaux se déroulant à Tel Aviv, après une traversée mélancolique où les personnages ne cessent de regretter leur statut diasporique. De fait, la thématique carnavalesque englobe l’ensemble de la pièce, évoquant le purimshpil et reliant, là encore de façon prémonitoire, autocritique féroce de la société juive et rituels de réparation tels qu’on les voit fleurir dans les camps de DP’s après la guerre (voir l’ouvrage de Nathalie Cau sur ces performances symboliques et mémorielles qui réunissaient à la fois les véritables victimes de la déportation et des acteurs ou des figures en effigie revêtus des insignes nazies, évoquant précisément le personnage de Hitler : l’Aryen dans notre pièce ou l’ambassadeur Von der Boche, venu négocier la reddition allemande et ne pouvant réprimer, tels de véritables tics, ses automatismes grossièrement antisémites).
Au motif théâtral du dédoublement (Weizmann II, Trotzky II, et toute la galerie de portraits parodiant les « célébrités » du « peuple élu ») s’adjoint celui, carnavalesque, du renversement : la « nef des fous » juive transporte le chaos diasporique en « terre promise », faisant de l’État juif, dirigé de main de maître par Alexandra et ses amazones, la caricature des démocraties parlementaires impuissantes à empêcher la catastrophe mondiale. Un « parti du retour » s’organise, retour en diaspora, bien sûr, puisque « Sion n’est plus dans Sion » et que partout gronde la menace de la révolution.
C’est d’ailleurs pour parer à cette dangereuse éventualité, illustrée par un pays où « tous [sont] rouges de sang et blêmes de faim », que le concert des nations, à peine sorties de la guerre et sans s’attarder à tirer vengeance de l’Allemagne, s’accorde sur la nécessité du retour de « ses » juifs, boucs émissaires idéaux en période de crise, refondant l’unité générale à partir de leur exclusion même. On voit que, s’il utilise systématiquement le grotesque, Zeitlin s’avère par bien des côtés un redoutable polémiste, très au fait des rapports de force politiques de son temps. Mais, au lieu de se plier à une visée réaliste, il préfère jouer de la multiplicité des registres, ici presque uniquement satirique, dans d’autres pièces ou dans ses poèmes, comme dans son unique roman Terre brûlante, plutôt mystique et d’inspiration prophétique. Comme chez un Claudel, la fiction théâtrale autorise un irréalisme dévoilant les faux-semblants et tranchant au vif des illusions bien-pensantes.
Mais, comme chez Claudel aussi, la littérature chez Zeitlin est au service d’une instance supérieure, d’ordre transcendant et surplombant par son mystère le lieu du politique. Tel est sans doute le sens de l’apparition, dans la pièce, d’un niveau de sens métahistorique, représenté par le personnage du « Juif éternel », ainsi que du jeune zélote Sholem Ben-Khoyrn (« fils de la liberté »), et de la Sulamite, directement importée du Cantique des cantiques, qui semblent s’opposer à la fois à la perversion idéologique contemporaine et à l’humble revendication d’existence – ancrée dans l’affreuse misère quotidienne – du Juif ordinaire.
Celui-ci, représenté dans la pièce par des types culturels familiers au lecteur, s’obstine à vouloir revenir à son balluchon de « fripes » ou à son échoppe de soda, telle la réincarnation de ces types humains du shtetl, évoqués dans la plus grande ambivalence par la narration des « classiques » et pourfendus par la verve vengeresse des « modernes », les Bialik, Shapiro, Peretz Markish, Uri Zvi Grinberg, ainsi que par le message sioniste refusant ces figures de la victimisation traditionnelle. De notre point de vue, il est facile de voir dans cette conclusion (une royauté purement mystique des véritables « amants de Sion ») une dimension intégrée au contraste parodique ; à la lumière du contexte familial de Zeitlin, cependant, on peut y voir une référence directe aux idées de son père, qui appelait à la création de communautés utopiques sur une base spirituelle. À moins que le lecteur contemporain ne retienne plutôt la mise en abyme, ce film « tourné d’avance » par Charlie Chaplin, qui risque de ressembler fortement à la pièce que nous sommes en train de lire et qui nourrit peut-être quelques analogies immatérielles avec Le Dictateur, qui verra le jour six ans plus tard.
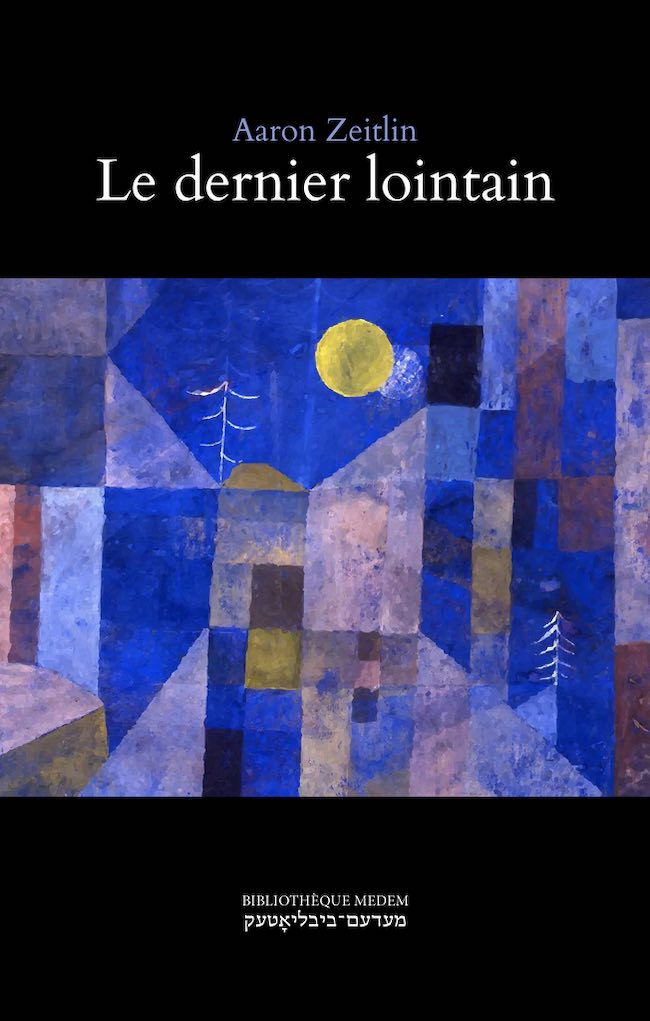
Le second ouvrage, très différent par sa facture et son genre, est un choix représentatif de poèmes recouvrant toute la production de Zeitlin. La traductrice, Batia Baum, y déploie une fois de plus son admirable savoir-faire, depuis les premiers poèmes, d’inspiration plutôt lyrique, jusqu’aux poèmes de la période post-génocidaire, que Zeitlin lui-même avait répartis entre ses deux volumes intitulés « poèmes de l’Anéantissement et poèmes de la foi ».
Ce volume demanderait à lui seul une plus longue recension. Risquons une confidence : c’est en étudiant en cours avec Yitskhok Niborski le poème « Entre Plotsk et Varsovie » que s’est affermie la décision de l’auteure de ces lignes de se consacrer à l’étude de la littérature yiddish. Le souvenir de ce moment fondateur reste entier : le rythme, le balancement des vers évoquant le mouvement du bateau sur la Vistule, la strophe inaugurale, avec sa tristesse définitive : « En ces années sans Dieu d’après Maïdanek, / je revois les années écoulées. / Par un beau jour d’été nous sommes allés / à Plotsk voguant sur la Vistule, / à Plotsk voguant au fil de la Vistule. » Et puis cette autre strophe au milieu du poème, une fois que le souvenir radieux semble s’être replié devant la coupure infranchissable du temps :
« Moi, toi et la Vistule – vers Plotsk nous voguons.
Si je veux – cette heure demeure,
bien que tu ne sois plus, ni toi ni mon peuple,
et que la fin ait été Maïdanek.
Si je veux – cette heure demeure. »
Et finalement ces lignes, qui renvoient au Zeitlin lecteur du Livre de la Splendeur et du Cantique des cantiques :
« En esprit, Maïdanek n’est pas non plus la fin,
en esprit rien n’est voué à disparaître,
en esprit rien n’est éphémère. »












