Le 29 janvier 2021, deux jours après l’anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, devenu Journée internationale de la mémoire des victimes du génocide et des crimes contre l’humanité, l’historien Otto Dov Kulka nous a quittés. Il avait quatre-vingt-sept ans, et se battait contre un cancer qui s’était déclaré vingt ans plus tôt. Le public français avait découvert sa voix par un livre singulier et même tout à fait extraordinaire, paru en 2013 dans la belle traduction de Pierre-Emmanuel Dauzat (Albin Michel) : Paysages de la Métropole de la Mort. Réflexions sur la mémoire et l’imagination.
Jusque-là, Otto Dov Kulka était connu surtout d’une communauté internationale de chercheurs, celle des historiens de l’antisémitisme européen, du nazisme et de la « solution finale ». Au terme d’une brillante carrière universitaire, l’historien avait tourné le dos à l’ascèse de la « distance » scientifique pour réveiller une expérience de lointaine enfance, enfouie des années durant : il avait vécu onze mois dans le « camp des familles » tchèques de Birkenau, où il avait été déporté à dix ans. Expérience privée d’archive, car ce camp fut entièrement « liquidé » en juillet 1944. Un de ses Blocks, celui des enfants, le Kinderblock, avait abrité une activité culturelle qui prolongeait les équivoques du ghetto-vitrine de Theresienstadt – mais cette fois à moins de 400 m des crématoires de Birkenau. Ce camp siglé « BIIb » et surnommé « Familienlager » avait été bâti à la hâte à l’été 1943 près de l’entrée principale de Birkenau. Il se trouvait non loin du Zigeunerlager créé sur le même modèle dès janvier 1943, où s’entassèrent 7 000 familles. Le camp tsigane devint vite un mouroir de masse et un vivier pour les expériences de Mengele, qui supervisait les deux camps. Autre chose se déroula dans le camp des familles tchèques, et plus singulièrement dans son Kinderblock, « centre culturel de ce camp unique », dit l’auteur.

Otto Dov Kulka, dans le documentaire « Die vorletzte Freiheit. Landschaften des Otto Dov Kulka » de Stefan Auch (2018) © Avec l’aimable autorisation de Stefan Auch
Camp unique. Livre unique. Le lecteur de Paysages de la Métropole de la Mort est mis en présence de deux singularités en même temps : celle d’une expérience historique collective et celle d’une écriture individuelle, issue d’un homme qui, pour passer le « fleuve infranchissable » de ce passé, quitte la méthode du « savoir » historien sans pour autant rejoindre la « littérature » – du moins pas la « littérature de l’Holocauste », à laquelle il se sentait étranger. Or sa puissance de suggestion relève d’une force éminemment poétique. Et précisément parce que ce texte cherche sa voie, ou sa porte d’entrée, dans un vibrant et trouble entre-deux-rives, il jette une lumière nouvelle, précieuse, profonde, sur l’histoire et la littérature à la fois. Une lumière critique. Plus rare encore, il le fait, non au cours d’une démonstration argumentée, mais par flux et reflux, éclats et ellipses, du fond même de cette puissance poétique. C’est pourquoi il importe de revenir sur ce livre incandescent, et sur le destin très singulier de son auteur, à présent qu’il n’est plus là pour nous parler [1].
Pour ce livre à nul autre pareil, Otto Dov Kulka avait d’abord travaillé à la voix, en enregistrant ses souvenirs sur magnétophone pendant dix ans – de 1991 à 2001, dit-il –, et en notant ses rêves et pensées dans un journal intime. Le livre, qui débute avec des taches de noir sur fond blanc, images subliminales des morts tombés dans la neige lors de l’évacuation de Birkenau, s’achève avec deux rêves notés en 2001 et 2002. Entre le prologue et cette fin, un certain nombre de scènes s’animent en dix chapitres, surgies de couches différentes de mémoires superposées et glissantes, liées chacune aux visites du survivant dans les « paysages de la Métropole de la Mort ». Le premier retour à Birkenau, en 1946, lors du procès de Cracovie où il témoigna à quatorze ans, ne se réveille qu’après la visite qu’il fit seul en 1978, en marge d’un colloque polonais. Mais ce retour s’était décidé alors qu’il errait dans les pourtours de Jérusalem en contemplant l’antique Porte scellée, dite « Porte de la Miséricorde ».
Lorsqu’elle surgit ainsi, la mémoire ne fait pas que « raconter ». Un champ de tension fait parler et penser en écoute flottante. La conscience longe les précipices, se penche sur leurs bords et, privée de la « méthode » de l’historien, s’accroche au langage du mythe. La réflexion l’incorpore et le manipule à la manière d’un jeu distancié, engendrant ce que l’auteur appelle sa « mythologie privée » – formule ironique et quasi litanique, comme le sont « Métropole » et « Grande Mort ». Les paysages de Birkenau et ses camps satellites, la Vistule et les bords de la Baltique forment un pays soumis à la Loi de la « Grande Mort » : celle de l’anéantissement programmé, vécu comme présent sans fin d’où l’enfant, devenu lui-même éternel, ne pourra jamais sortir tout à fait. Il lui faut redescendre sans fin dans l’Hadès nazi, au cœur de la Métropole, pour indéfiniment chercher l’issue. Il lui faut rejoindre ses camarades engloutis sans lui – mais aussi le docteur Mengele, qui lui, n’a jamais disparu : dans un des rêves, l’enfant visite Birkenau longtemps après et découvre que le guide du camp n’est autre que Mengele. « Où étiez-vous donc passé toutes ces années ? », demande l’enfant. « J’étais ici. J’ai toujours été ici », répond Mengele.
Dans la succession de ces paysages revisités à l’état de ruines, l’écriture oscillante et circulaire produit un effet d’hypnose, et même d’emprise tenace. Impossible d’ouvrir ce livre sans le lire d’une coulée. Et impossible ensuite d’oublier son ton, son rythme, ses images. Une voix d’outre-monde parle, ranime les fantômes par visions ajustées, du lointain au proche et du proche au lointain, livrant une série de méditations corrosives : sur l’insolite assimilation de l’histoire par celui qu’elle aurait dû faire disparaître, sur la valeur éthique de la culture, sur la transmissibilité aléatoire d’une « mythologie privée ». Transmission qui tente de s’effectuer pourtant, à l’aide de scènes ensommeillées que le commentaire réveille, déplace et réendort, figées dans l’aura d’allégories brouillées. Paysages de la Métropole de la Mort est un livre inoubliable parce qu’hypnotique, et vertigineux. Il ensorcèle son lecteur et le fait penser, emporté dans la brèche que l’historien a ouverte en lui-même, explorant son « circuit » extra-scientifique qui lui fait tout questionner à la fois : le sens d’une survie collective, la capacité de résister par l’art, le vertige de la justice, l’infirmité de la littérature, le pouvoir et l’impuissance de l’histoire, l’existence de Dieu. Avec la figure d’un destin opaque se dessine un monde de questions ouvertes, livrées à la manière d’un liquide en fusion : ça déborde, ça brûle. De quoi était faite cette expérience qui poussa l’historien à cesser de l’être ? Que s’était-il donc passé dans ce « camp unique » et son « centre culturel », le Kinderblock ?
De Theresienstadt au Block des enfants de Birkenau
On connaît bien à présent l’histoire de Theresienstadt, le vertige de l’imposture nazie retournée par les Juifs tchèques en résistance ardente. Nous avons tous vu ou entrevu quelque chose de son éblouissante archive, celle des dessins et poèmes d’enfants, ou encore des spectacles donnés au cœur de la ville-forteresse proprette et fébrile dans le film de propagande Theresienstadt. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt, que dut tourner Kurt Gerron avant d’être déporté à Auschwitz.
En 2001, W. G. Sebald a fait entrer cette histoire en littérature par la grande porte de l’Unheimliche post-mémoriel avec Austerlitz, et quinze ans plus tard Hélène Gaudy empruntait la voie ultra-contemporaine de l’enquête dans Une île, une forteresse (Inculte, 2016). L’exceptionnelle production issue des « foyers » – enfants et « madrichim » (éducateurs) – que Lilian Atlan avait ritualisée en 1989 dans Un opéra pour Terezin occupe un chapitre entier de L’enfant et le génocide (2007), avec un large choix de traductions littéraires de Stéphane Gailly [2]. Plusieurs textes ont été traduits ou retraduits depuis : le Journal 1941-1942 de Petr Ginz, rédigé avant que son auteur crée et anime à Terezin la revue Vedem (Seuil, 2010), ainsi que l’étonnante pièce métaphysico-politique de Hanus Hachenburg, On a besoin d’un fantôme (Rodéo d’âme, 2018) : deux auteurs de quatorze et treize ans, actifs dans le même foyer de Terezin où s’était formée une « République des enfants » sur le modèle russe « Chkid », qui furent tués à Birkenau en 1944. En 2019, deux films ont été consacrés à cette poignante résistance par l’art : celui de Baptiste Cogitore, Le fantôme de Theresienstadt, centré sur Hanus Hachenburg, où témoignent plusieurs survivants (George Brady, Zdenek Taussig, Dita Kraus), et celui de Chochana Boukhobza, Terezin. L’imposture nazie, chronique du camp-vitrine nourrie de l’archive enfantine et de témoignages oraux – dont celui d’Otto Dov Kulka. Celui-ci apparaît de nouveau dans la « suite » qu’a réalisée Chochana Boukhobza l’an dernier, Kinderblock (2020), film d’animation réalisé à partir d’œuvres de survivants du camp des familles. Celle en particulier du peintre-poète Yehuda Bacon, dont la parole de gamin vieilli conclut le film de manière poignante.
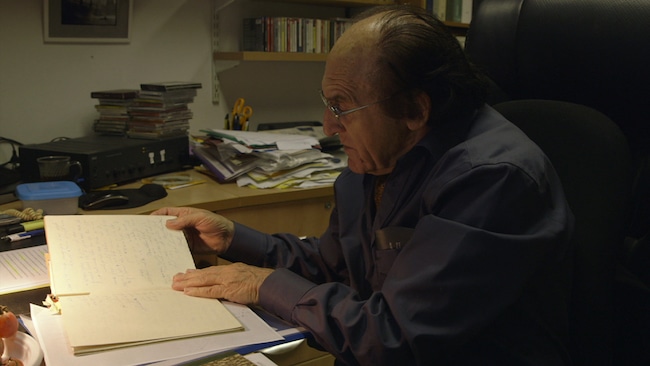
Otto Dov Kulka, dans le documentaire « Die vorletzte Freiheit. Landschaften des Otto Dov Kulka » de Stefan Auch (2018) © Avec l’aimable autorisation de Stefan Auch
L’histoire du camp des familles de Birkenau et de son Kinderblock, négligée par les historiens français, commence ainsi à être connue, mais elle reste plus âpre que celle de Terezin, et son espace-temps privé d’archives tend à sombrer dans l’inimaginable. L’un des éducateurs devenu écrivain, Otto B. Kraus, a raconté cette résistance collective désespérée dans The Painted Wall (1995), roman paru en tchèque en 1993 et en anglais à Tel Aviv : il a paru en français en 2013 sous le titre Le mur de Lisa Pomnenka, accompagné d’un essai, Le leurre et l’espoir [3], où je revenais sur le double leurre de Terezin et de Birkenau, sur les formes résiduelles d’espérance ou de foi qui s’y manifestèrent, et sur le chemin que se fraya la mémoire des survivants entre Israël et la Tchécoslovaquie communiste.
Le témoignage majeur d’Otto B. Kraus, chronique des derniers mois du camp des familles, était servi et desservi par sa mise en fiction, mais il interrogeait l’énigme qu’avait été cette persistance des gestes du jeu, du rite et de l’art au Kinderblock. Persistance dont témoigne le livre récemment paru de celle qui fut son épouse (Moi, Dita Kraus, bibliothécaire d’Auschwitz, Michel Lafon, 2020), dont l’écrivain catalan Antonio Iturbe a tiré un roman, La bibliotecaria de Auschwitz (Planeta, 2012). Comment cette activité a-t-elle pu durer des mois ? Quel sens lui donnait son ambiguïté ? Que signifiait le voisinage des crématoires et des ateliers de poésie que raconte Kraus, ou l’Ode à la joie de Beethoven entonnée dans les latrines de Birkenau, qu’interroge Kulka ? Derrière le « secret nazi », il y a eu une énigme juive, ou simplement humaine, qui résiste elle aussi à l’entendement. Mais cette résistance-là est nourrie de l’autre, celle qui, à travers le leurre, cherchait une lumière effective.
17 517 Juifs furent envoyés de Terezin dans le « BIIb » en trois vagues de transports – septembre 1943, décembre 1943, mai 1944, pour une durée de six mois au terme de laquelle chaque transport était soumis au gazage. Ils étaient tchèques pour la plupart mais aussi, à la fin, hollandais, allemands et autrichiens – parmi eux Ruth Klüger et sa mère. À l’arrivée, les déportés conservaient leurs vêtements civils, leurs cheveux et leurs bagages ; hommes, femmes et enfants vivaient séparés mais les enfants rejoignaient les mères pour dormir. Au cours de cette vie en sursis, les déportés étaient encouragés à mener une vie sociale et même culturelle – sous certaines conditions, dont l’usage exclusif de la langue allemande –, en vue d’une éventuelle visite de la Croix-Rouge, qui n’eut jamais lieu. Une fois que le CICR eut visité Theresienstadt le 23 juin 1944, et que son représentant suisse eut écrit à son homologue de Berlin qu’il en gardait un « excellent souvenir » et jugeait ses « conditions de vie satisfaisantes » – il dira avoir été mystifié dans le film de Claude Lanzmann Un vivant qui passe – le camp BIIb ne servait plus à rien. Le Zigeunerlager fut lui aussi liquidé peu après (août 1943) afin de faire de la place aux Juifs de Hongrie.
De septembre 1943 à juillet 1944, une vie sociale juive eut lieu, à la fois désespérée et ardente, dont le foyer fut le Block des enfants (il y en avait en fait deux, pour les moins de huit ans et les plus de huit ans). Des cours de toutes disciplines, des ateliers de jeux et d’activités artistiques y furent organisés pour 600 enfants, à l’initiative d’un jeune homme sportif et germanophone, Alfred Hirsch dit « Fredy », qui s’entoura d’une équipe de « madrichim » issus de mouvements de jeunesse juifs : ils s’efforcèrent de protéger les enfants du chaos inhumain qui les entourait en leur faisant respecter des valeurs de solidarité et de dignité, cultiver le sport et l’étude, les rites et le jeu, encourageant la créativité artistique : pièces de théâtre, expositions de sculptures, concours poétiques, peintures murales – ce « painted wall » créant un « îlot » trompeur mais humain.
Le camp était géré par les Juifs sous l’étroite surveillance des autorités nazies, qui applaudissaient de bon cœur aux spectacles. « Les SS les traitaient avec respect, plaisantaient avec eux, jouaient avec les enfants », écrira Rudolf Vrba, alors secrétaire du « camp de quarantaine » voisin. Éventé par la résistance polonaise, le leurre resta impénétrable aux Juifs tchèques jusqu’à ce que le premier convoi fut envoyé à la chambre à gaz le 8 mars 1944, nuit de la « grande conflagration », dit Kulka. Hospitalisé alors, lui et les malades furent maintenus en vie pour ne pas inquiéter les médecins, nécessaires aux convois suivants. L’enfant passa donc à travers mais il vit partir à la mort tous ses camarades et une partie de sa famille, et arriver les deux convois suivants, promis au même sort. Tous, adultes et enfants, se savaient dès lors condamnés.
La vie culturelle ne cessa pas pour autant : elle sembla s’absolutiser en se dégageant de toute perspective d’avenir, dans une forme de présentisme tragique. C’est cette énigme qu’ont tenté d’éclaircir Otto B. Kraus et Otto Dov Kulka, l’un du point de vue de l’éducateur – devenu alors professeur, nourri de la lecture de Viktor Frankl – l’autre du point de vue de l’enfant devenu chercheur. Or cet enfant s’était initié en même temps à l’absence d’espoir et à l’histoire grecque, au chant choral et à l’humour noir, aux piles de cadavres à éviter chaque matin et à l’éclat foudroyant du ciel bleu parsemé d’avions-jouets à l’annonce de la libération.
Langage du mythe et porte messianique
Le temps mythique où nous plonge Paysages de la Métropole de la Mort s’apparente à un bain de jouvence et de malédiction, mêlant angoisse archaïque et irradiation lumineuse. Ce texte étrangement poétique, où se réfléchit à grande distance le métier d’historien, n’est cependant pas littéraire, et l’auteur renâcle à entrer dans une « littérature de l’Holocauste » à l’égard de laquelle il éprouve un profond malaise : je me réfugie dans Kafka, dit-il, et le Kleist de Michael Kohlhaas semble jouer un rôle similaire. Le refuge est aussi dans la poésie, citée à des moments cruciaux, qui vient cristalliser la « mythologie privée ». Mais la prose tâtonnante de Kulka sécrète sa propre poésie, un rythme dont la fouille s’éblouit par instants dans une totale suspension du sens. Un sous-texte biblique et mystique trame son écriture, tout près du langage du mythe, inscrit à son verso ou surgi de sa nuit : après le rêve de Mengele vient celui du « Chagrin de Dieu », dont la glose tourne au Musivstil, centon judaïque familier aux lecteurs de poésie juive médiévale, de Kabbale et de Rosenzweig. Tout le livre est secrètement travaillé par la Critique de la violence de Walter Benjamin et son contrepoint entre violence mythique et violence théologique. Le Kafka qui inspire Kulka est celui dont débattaient Benjamin et Scholem à l’heure du départ de ce dernier en Palestine. Cette prose pleine d’échos vibrants et pensants entrelace partout l’histoire et le mythe, la terreur et l’illumination. Une écriture se tisse dans un langage visuel et un rythme lent, créant un mouvement oscillant, une lumière clignotante, sourdement messianique.

Otto Dov Kulka, dans le documentaire « Die vorletzte Freiheit. Landschaften des Otto Dov Kulka » de Stefan Auch (2018) © Avec l’aimable autorisation de Stefan Auch
Le texte est ponctué de photos en noir et blanc, prises par l’auteur ou empruntées aux archives des camps ou à certaines œuvres, entraînées dans cette géographie de la Mort où le monde entier paraît absorbé : plan du complexe d’Auschwitz et de l’estuaire de la Vistule, vestiges désolés de Birkenau, tas de chaussures éventrées envoyées d’Auschwitz au Stutthof, marais, forêts et maisons au bord de la Baltique, etc. La « Métropole » est à l’image du camp tel qu’il apparaît à Kulka en 1978 : « Enterré mais néanmoins expansif, comme une sorte d’immense tombe, d’horizon en horizon ». Or, cet espace infernal, qui fait citer la gare ferroviaire de Londres empruntée à l’Austerlitz de Sebald, se dilate jusqu’en Israël. Il atteint Jérusalem par sa porte la plus oubliée, la « Porte d’Or » ou « Porte de la Miséricorde », celle qui fut scellée lors de la construction du mur ottoman, et par laquelle, d’après les vieilles légendes, le Messie devait entrer dans Jérusalem – de sorte que l’histoire guerrière d’Israël esquisse un scabreux échange de signes avec les vestiges de Birkenau.
Le texte est traversé par le motif kafkaïen de la Porte de la Loi : porte à la fois ouverte et fermée, faite pour tous et pour un seul à la fois, indiquant une sortie possible et impossible. Une de ces portes interdites et promises est sans doute celle de l’art. Une autre, plus fondamentale puisqu’une vie s’y est jouée, est celle du « savoir » historien. L’histoire était-elle ma « porte de la Loi ? », demande Kulka. Le livre médite sur le « passage sûr » qu’avait cru trouver en lui l’historien, méthodiquement accroché au temps linéaire et au document, et sur cette longue esquive qui aura été salutaire un temps : une vie. Sans cette croyance durable en une « mission » scientifique, dit-il, le « message » de la grande Mort aurait écrasé son porteur. Et si cette porte devait se refermer, ajoute-t-il, il croit avoir vu briller au-delà une « lumière nouvelle ». La totalité du savoir historien est ainsi placée sous les lueurs de la « faible espérance messianique » dont parlait Benjamin. Mais cette lumière est-elle autre chose que la leçon sur les Thermopyles reçue par l’enfant au Kinderblock ? Et qu’a-t-elle à voir avec L’Ode à la joie que faisait chanter Imre aux enfants, bras grands ouverts ?
D’Otto Deutelbaum à « Otto Dov Kulka » : le nom de la mère
Le livre a paru en 2013 en quatre langues : français, hébreu, anglais, allemand – certains fragments avaient été édités par Heinz Brüggemann, historien de la littérature avec qui Kulka avait longuement échangé sur Kafka, Sebald et Benjamin [4] –, et un an plus tard il parut en tchèque. Kulka maîtrisait toutes ces langues : né dans une famille germanophone de Tchécoslovaquie, il vivait en Israël depuis 1949, enseignait à l’Université Hébraïque de Jérusalem depuis 1985, et publiait ses travaux en allemand et en anglais. Il en cosigna certains avec ses amis Eberhard Jäckel et Ian Kershaw – qu’il remercie à la fin de ses Paysages pour le dialogue mené avec eux, et il exprime une gratitude particulière pour Saul Friedländer, qui le premier l’encouragea à publier ses écrits « extrascientifiques ». D’origine tchèque lui aussi, l’auteur de L’Allemagne nazie et les Juifs et de Reflets du nazisme avait accompli beaucoup plus tôt le saut mémoriel en écrivant dès 1978 Quand vient le souvenir, nouant le passé intime à sa vie présente. En 2013, l’acte transgressif qu’effectuait Otto Dov Kulka venait à la fin de sa vie, et c’est son propre impératif catégorique qu’il transgressait : celui d’une totale séparation de l’expérience personnelle et du travail d’historien.
Pourtant, cette expérience était inscrite dans sa signature, publique et secrète à la fois : « Kulka » était le nom de jeune fille de sa mère, Elly Kulkova, et c’est ce nom que son père et lui firent inscrire sur leurs papiers d’identité lorsqu’ils revinrent tous deux de Pologne sans elle. Lorsqu’il naquit le 16 avril 1933 à Novy Hrozenkov, village de la région de Vzetin, Otto s’appelait « Deutelbaum », nom du premier époux de sa mère, dont elle divorça quand il avait cinq ans. L’homme qui l’avait conçu était Erich Schön. Elly, Erich et Otto avaient été déportés à Auschwitz dans des circonstances différentes : arrêté comme résistant par la Gestapo dès 1939, envoyé à Dachau puis Neuengamme, Erich Schön fut déporté à Auschwitz en octobre 1942. La même année, Otto et Elly furent enfermés à Theresienstadt, de même que Rudolf Deutelbaum, sa fille Eva de onze ans et sa nouvelle épouse, Ilona, qui, eux, furent tous trois déportés et tués à Treblinka en octobre 1942 : Elly avait choisi de rester à Terezin avec Otto plutôt que de partir avec Eva, son aînée [5].
À Birkenau, Erich retrouva Elly et Otto, et parvint à les faire hospitaliser afin qu’ils échappent au gazage. Otto et son père s’échappèrent le 23 janvier 1945 lors des « marches de la mort » – « voyage nocturne » par lequel débute Paysages. Elly, elle, avait été transférée au Stutthof enceinte, y avait perdu son enfant, s’était évadée lors de l’évacuation, mais avait succombé à une typhoïde dans une ferme où elle s’était réfugiée – ce qu’Otto apprit bien plus tard. Revenu avec son fils en Tchécoslovaquie, Erich épousa la veuve de son beau-frère tué à Auschwitz, Gabriela Kulkova, et adopta en 1946 ce nom de « Kulka ». C’est sous le nom d’Erich Kulka qu’il signa dès 1946 un des tout premiers livres sur Auschwitz, L’usine de la mort, qui fut largement diffusé dans toute l’Europe communiste, et qu’il témoigna au procès de Francfort puis au procès Eichmann. En 1968, il partit en Israël, fuyant l’invasion soviétique et la politique antisémite. Otto y habitait depuis près de vingt ans : il y était parti seul, à seize ans, dès 1949, s’était installé dans un kibboutz du nord du pays, et avait fait ajouter à son nom le « Dov » hébreu. Quand Erich Kulka arriva à Jérusalem, Otto Dov Kulka était devenu un jeune historien israélien.
La disparition de la mère de l’auteur occupe une place centrale dans Paysages de la Métropole de la Mort : de l’adieu laconique qu’elle adressa à l’enfant avant d’être emmenée vers la « cité satellite » du Stutthof, sans autre signe que son dos tourné et la toile grise de sa robe voltigeant au loin, aux recherches qu’il fit pour retrouver le village où elle avait été enterrée, en passant par la lettre d’adieu qu’elle avait fait parvenir au père le 30 juin 1944, où elle appelait à venger le « sang des innocents ». Devenu un vieil homme, Otto Dov Kulka entend résonner dans cette lettre le « langage de la prière » (Hashem yikom dam nekiim), mais aussi un « appel à la justice comme méta-dimension » : appel qui, quoique adressé à son époux et évoquant son fils, transcendait le destin familial en « se déployant dans ce prodigieux système de la Grande Mort qui règne sur tout, et qu’on ne saurait affronter directement ». Elle avait pu ouvrir cette brèche « en personnifiant cette réalité », rapportée au « petit garçon condamné à mourir ». Mais son appel ne pouvait que « flotter » dans cet univers bouclé par la Loi, comme toute étincelle d’espoir ou de soulèvement – et l’auteur fait ici allusion au soulèvement qui se prépara au camp des familles, mais échoua avec le suicide de Fredy Hirsch, qui recula devant la perspective d’un massacre impliquant les enfants.
Kulka fait alors discrètement apparaître la nécessité de l’art : l’art peut faire cesser le « flottement » de « l’appel métadimensionnel » en l’arrimant dans une forme. Dans Paysages, la prière maternelle est relayée, décuplée et comme traduite par un poème féminin : le premier des trois textes qu’une jeune fille tchèque avait confiés à un Kapo au seuil de la chambre à gaz, la nuit de mars 1944 où 3 800 Tchèques condamnés chantèrent les trois hymnes, national, sioniste, socialiste – nuit tragique que raconta aussi Zalmen Gradowski dans Au cœur de l’enfer. « Nous, les morts, accusons ! », disait ce poème apocalyptique. Ces trois poèmes féminins, que le père récupéra au camp et publia dès 1945 [6], sont reproduits par le fils en 2013 sans commentaire ou presque – juste avant le chapitre consacré à sa mère. Il n’y reproduit pas la « merveilleuse lettre » d’Elly à Erich, mais précise qu’elle se trouve à Yad Vashem. La pudeur du fils hérite de tous les silences, mais celui-ci n’est plus une esquive.
De l’historien à l’écrivain
Une fois remonté à la surface, le lecteur veut comprendre l’itinéraire qui mena à un tel « écrit extra-scientifique », observer comment l’« autre circuit » se dessina dans le temps d’une carrière d’historien. En 1958, Otto était parti étudier l’histoire et la philosophie à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Il entama des recherches sur l’antisémitisme allemand – sa première publication en 1961 portait sur Wagner – et soutint une thèse en 1975 sur « La « question juive » dans le Troisième Reich, sa signification dans l’idéologie et la politique nazie et son rôle dans la détermination du statut et les activités des Juifs [7] ». Ce travail lui fit étudier un temps à la Goethe Universität de Francfort, ville où il s’était rendu dès 1964 pour témoigner au procès d’Auschwitz : dans sa déposition, il insiste sur la dimension culturelle et politique du Kinderblock, « centre de la vie spirituelle » et QG de l’équipe dirigeante, où se préparait la résistance. Il évoque aussi le « mystère de leur privilège » au sein de Birkenau, « non éclairci encore » (enregistrement disponible). C’était le 30 avril 1964.

Otto Dov Kulka, dans le documentaire « Die vorletzte Freiheit. Landschaften des Otto Dov Kulka » de Stefan Auch (2018) © Avec l’aimable autorisation de Stefan Auch
Vingt ans plus tard, Otto Dov Kulka publia un long texte dans un volume collectif sur les camps nazis : « Un ghetto dans un camp d’extermination. L’histoire sociale juive au temps de l’Holocauste et ses limites ultimes [8] ». Il y récapitulait « l’histoire politique » du camp des familles, examinant les « preuves » de l’imposture nazie, la principale étant la correspondance entre Eichmann à l’Office central de sécurité du Reich et la Croix-Rouge de Berlin, et entre celle-ci et la Croix-Rouge de Genève, montrant que la création du camp était destinée à une vitrine humanitaire prolongeant Theresienstadt; mais son sujet central est le « phénomène remarquable » du « maintien des structures, des activités et des valeurs de la société juive » en l’absence de toute perspective d’avenir – et c’est ce versant-là du texte, au-delà du « savoir », qui résonne aujourd’hui : « ici, dit-il, les valeurs et modes de vie historiques, fonctionnels et normatifs, furent transformés en quelque chose de l’ordre de valeurs absolues ». Ici le texte s’arrête net et revient aux « documents » relatifs à la liquidation. Le vide qu’ouvre l’ellipse sur les « valeurs absolues » sera comblé par les interrogations sur la « méta-dimensionnalité » des conduites de résistance culturelle, qui traversent Paysages de la Métropole de la Mort – où l’étude de 1984 est reproduite en annexe, allégée d’une partie de ses notes.
Otto Dov Kulka fut recruté l’année suivante au département d’histoire juive de l’Université Hébraïque de Jérusalem, invité à Harvard comme visiting professor, puis nommé en 1988 à la chaire israélienne d’histoire juive Sol Rosenbloom. En 1997, il édita avec deux collègues allemands un volumineux recueil de documents sur les Juifs dans l’Allemagne hitlérienne de 1933 à 1939, qui fut primé par Yad Vashem et l’Institut d’études juives [9]. Deux ans plus tard, sa carrière d’enseignant s’arrêta pour raisons médicales mais il poursuivit ses travaux, et en 2004 parut une monumentale exégèse des rapports secrets nazis relatifs aux Juifs dans l’opinion publique allemande, réalisée avec Eberhard Jäckel [10].
Otto Dov Kulka fait partie de la génération d’historiens héritiers de Yehuda Bauer et d’Israel Gutman, lesquels, à l’heure où Yad Vashem s’enlisait dans des conflits stériles, donnèrent un nouvel élan à la recherche à l’Université Hébraïque de Jérusalem, créant un Institut du judaïsme contemporain et un département d’histoire orale [11]. Au sein de cette « école israélienne » qui travailla en contact étroit avec la recherche américaine (George Mosse, Saul Friedländer), Kulka s’est singularisé par son analyse du foyer idéologique de l’antisémitisme hitlérien, observant l’enchevêtrement des repoussoirs juif, chrétien et bolchevique, soulignant la dimension messianique sécularisée de « l’antisémitisme rédempteur » – formule partagée avec Friedländer. Soumettant l’histoire juive aux exigences usuelles de la compréhension historiographique, analysant la rupture à partir des éléments de continuité, il évitait le terme « Holocauste » et préférait parler de « l’histoire des Juifs sous le national-socialisme » et de la « solution finale », et voyait la singularité nazie se manifester dans l’éradication de l’élément juif dans la culture européenne. « L’esquive » a donc nourri une méthode historiographique, un lexique et un choix d’objets en amont ou aux abords de l’extermination : l’idéologie et la politique antijuives, l’attitude de la population allemande et celle de la société juive vis-à-vis de leurs dirigeants respectifs. En 2013, Kulka invite à saisir une « dimension de silence » dans son « attitude de distance stricte et impersonnelle propre à la recherche », due à son « choix de couper le passé biographique du passé historique ». En se mettant à explorer librement ses souvenirs en 1991, il s’attaquait à cette paroi étanche en pratiquant sur lui-même une forme unique d’histoire orale.
Durant ces années, Otto Dov Kulka ne cessa de lire philosophes et poètes. Et c’est à un duo de poètes qu’il confie le commentaire du dernier rêve, « Chagrin de Dieu » – rêve, dit-il, « sur la présence physique de Dieu – au crématoire ». Dans ce tout dernier chapitre de Paysages de la Métropole de la Mort, où un « rabbin de douleur » répond à son père révolté par la foi religieuse qu’il ne faut pas poser la question de l’existence de Dieu, se trouvent mêlés Job, Abel et Caïn, et la figure du « Margrave de la Métropole de la Mort », à travers la poésie de Dan Pagis et de Gershon Ben-David. L’un, poète hébreu originaire de Bucovine, et l’autre, poète et penseur de langue allemande, étaient tous deux de très proches amis, et le premier tentait en vain de traduire le second, butant sur la figure du « Margrave ». Or le poète Gershon Ben-David, né Georg Lekhovitz, avait aussi été le tout premier historien du camp des familles : au début des années 1960, celles où Otto Dov Kulka, apprenti historien, errait sur les pourtours de Jérusalem à la recherche de son enfance enfouie, Gershon Ben-David, ancien enfant caché, orphelin réfugié en Israël, s’était composé une famille d’adoption avec les adolescents survivants de Birkenau, en particulier Otto Dov Kulka et Yehuda Bacon, qui l’avaient initié à leur humour noir, « langage vernaculaire » du Kinderblock [12]. Le jeune poète s’était lancé dans le travail de collecte de témoignages oraux auprès des survivants, enfants et éducateurs, soutenu par le département d’histoire orale de l’Université Hébraïque de Jérusalem, et encouragé par Kulka lui-même [13]. Le titre de ce travail soutenu en 1970 fait saisir leur proximité : Cultural Life and Educational Activities in the Theresienstadt Ghetto (1941-1945) and in the Special (« Family ») Camp for Theresienstadt Jews at Auschwitz (1943-1944) [14]. Ce travail pionnier, qu’on désigne en Israël comme la « collection Ben-David », est devenu la source majeure des travaux relatifs à cet épisode, qu’ils relèvent de la littérature ou de l’histoire.
Gershon Ben-David est mort précocement, en 1975. Vingt ans plus tard, alors qu’il visitait les enfers de sa « mythologie privée », Otto Dov Kulka publia un magnifique volume en hommage à son ami disparu, imprimé en allemand et en hébreu : sous le titre In den Wind werfen. Versuch um Metabarbarisches [15], explicitement inspiré du dictum d’Adorno sur la poésie barbare après Auschwitz, il contenait une trentaine de poèmes de Ben-David accompagnés de deux textes critiques de Susan Bernofsky et d’Anne Birkenhauer, mais autre chose encore. Sous les poèmes de son ami courait, sur le mode talmudique, une frise d’extraits de textes bibliques et midrashiques, de témoignages oraux recueillis par Gershon, de documents nazis, de dépositions judiciaires : c’était l’œuvre de Kulka. Le graphisme de la couverture beige et noire, d’une sobriété constructiviste, rappelait celles des revues d’enfants de Terezin.
Il est troublant d’apprendre que l’année où l’historien ouvrit en lui la brèche des images de mémoire fut aussi celle où son cancer se déclara. Mais cette coïncidence n’est qu’une des « questions ouvertes » égrenées dans Paysages de la Métropole de la Mort. Seule peut y répondre la couleur du ciel qui s’était incrustée en lui un jour d’été 1944 – celui où le camp fut liquidé, et où des aéroplanes gris argent apparurent dans le bleu, « salutations de mondes lointains » qu’il commente ainsi au seuil du chapitre des Portes de la Loi : « Il n’est presque pas de sentiment d’un retour à ce monde sans le sentiment du retour à ces merveilleuses couleurs, à cette expérience tranquille, magique, engageante, de ce ciel bleu de l’été 1944 à Auschwitz-Birkenau. Le seul bleu qui soit à sa place, éclipsant toute autre couleur, imprimé dans ma mémoire comme la couleur de l’été, la couleur de la tranquillité, la couleur de l’oubli – de l’oubli momentané, est cette couleur d’un été polonais en 1944. […] Ce retour, même s’il est dissocié de l’autre retour sombre et sans issue, est en soi un retour sans issue. La couleur est la couleur de l’enfance, une couleur d’innocence, une couleur de beauté. Et c’est aussi une loi immuable à laquelle on n’échappe pas. On n’échappe pas à la beauté, au sentiment de la beauté à l’apogée et au sein de la Grande Mort qui gouverne tout ».
-
Un film a été consacré à Otto Dov Kulka en 2018, qui n’a jusqu’ici été diffusé qu’en Allemagne, en Israël et en République tchèque : Stefan Auch, Die vorletzte Freiheit. Landschaftendes Otto Dov Kulka ; The Freedom Last But One. Landscapes of Otto Dov Kulka, 65 mn.
-
Voir Catherine Coquio et Aurélia Kalisky, L’enfant et le génocide. Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2007.
-
Otto B. Kraus, Le mur de Lisa Pomnenka, traduit par Stéphane et Nathalie Gailly ; Catherine Coquio, Le leurre et l’espoir. De Theresienstadt au Block des enfants de Birkenau, L’Atalante, 2013
-
« In Search of History and Memory. Landschaften der Metropole des Todes », in Walter Benjamin und die romantische Moderne, hrsg. von Heinz Brüggemann und Günter Oesterle, Königshausen & Neumann, Würzburg, 2009, p. 551-575.
-
Les détails de cette histoire familiale ont été donnés par une jeune historienne thèque, Anna Hajkova, dans un article malveillant qui reprochait à Otto Dov Kulka son silence sur la disparition d’Eva et Rudolf Deutelbaum, sa sœur et son père légal : « Israeli Historian Otto Dov Kulka tells Auschwitz story of a Czech Family That Never Existed », hcommons.org 30 octobre 2014, et opendemocracy.net, 18 novembre 2014.
-
My mrtvi zalujeme!, Vsetin, 1945, coédité avec Ota Kraus.
-
« The « Jewish Question » in the Third Reich. Its Significance in National Socialist Ideology and Politics and its Role in Determining the Status and Activities of the Jews ».
-
Paru dans Ysrael Gutman et Avital Staf (dir.), The Nazi Concentration Camps : Structure and Aims, the Image of the Prisoner, the Jews in the Camps, Jerusalem, 1984.
-
Otto Dov Kulka (hrsg.), Anne Birkenhauer, Esriel Hildesheimer (Mitarbeiter), Deutsches Judentum unter dem Nationalsozialismus. Dokumente zur Geschichte der Reichsvertretung der deutschen Juden 1933-1939. Le livre, paru aussi en anglais (German Jewry under the National-Socialist Regime), a été couronné en Israël par le Buchman Memorial Prize et le Wiznitzer Prize.
-
Die Juden in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1939-1945, Droste Verlag, Düsseldorf 2004, 896 p., avec un CD-Rom et 3 744 documents annotés ; The Jews in the Secret Nazi Reports, on Popular Opinion in Germany 1933-1945, Yale University Press, New Haven and London, 2010 (1 064 p.).
-
Dan Michman, « La recherche sur la Shoah : existe-t-il une « école israélienne » ? Revue d’Histoire de la Shoah 2008/1 (n° 188), p 93-115.
-
Voir Catherine Coquio, « « Nous, enfants et Madrichim ». Les voix du camp des familles : une polyphonie insulaire en quête de rituel », dans Fleur Kuhn et Cécile Rousselet, Les expressions du collectif dans les écritures juives d’Europe centrale et orientale, Inalco Presses, 2018.
-
Échange personnel avec Otto Dov Kulka, 7 janvier 2013.
-
Paru dans les catalogues d’archives orales de l’Institut d’études juives contemporaines de l’Université Hébraïque de Jérusalem (« Ben-David collection », 1970, Oral Division Catalogue n° 3).
-
Gershon Ben-David, In den Wind werfen. Versuch um Metabarbarisches. Gedichte. Herausgegeben von Renate Birkenhauer und Otto Dov Kulka. Mit einer Übersetzung ins Hebraïsche von Abraham Huss sowie Essays von Susan Bernofsky and Anne Birkenhauer, Jerusalem, Straelener Manuskripte Verlag, 1995.












