Ce qui nous arrive
Le Journal de l’année de la peste est un roman de Daniel Defoe, publié en 1722, soit cinquante-sept ans après l’événement qu’il raconte : la peste qui a ravagé Londres en 1665. Dans ce récit à la première personne, le narrateur présente, « rédigée par un citoyen qui a résidé à Londres tout du long », une chronique de l’épidémie qui ressemble beaucoup à ce que l’on qualifierait aujourd’hui de reportage sur le terrain.
Daniel Defoe, Journal de l’année de la peste. Trad. de l’anglais par Francis Ledoux. Gallimard, coll. « Folio classique », 384 p., 8,30 € (publié en 1722 ; édition parue en 1982)
Le narrateur rapporte les événements qu’il voit, les statistiques officielles qu’il compile, mais également les bruits qui courent, les fausses nouvelles, et bon nombre d’anecdotes. À l’époque de sa publication, ce texte a été considéré comme un essai historique rédigé par un témoin direct plutôt que comme un texte de fiction. Ce n’est évidemment pas le cas étant donné qu’en 1665 Defoe avait cinq ans, mais la construction de son récit et l’importante recherche que l’auteur – dissimulé derrière un pseudonyme, les simples initiales H.F – a dû mener pour l’étayer expliquent fort bien qu’on ait pu le penser. Par ailleurs, on peut noter qu’une autre épidémie de peste avait frappé Marseille en 1720 – Defoe, très informé (il a beaucoup écrit sur la question, par exemple Due Preparation for the Plague (Comment se préparer à la peste), publié deux mois avant le Journal), tente manifestement d’inculquer à ses lecteurs ce qu’il considère comme de bonnes pratiques à adopter face au risque encouru.
Un roman, donc, mais dont la teneur, pour le lecteur de 2020, semble confirmer ce qu’avance l’Ecclésiaste : « Ce qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui a été fait, c’est ce qui se fera ; et il n’y a rien de nouveau sous le soleil. » En effet, à la lecture du Journal, on ne peut qu’être frappé par la similarité des comportements des différents acteurs à quelques siècles de distance.

Estampe (1750) © Gallica/BnF
Au tout début du récit, en 1663, les Londoniens entendent parler d’une épidémie de peste qui sévit en Hollande, mais la Hollande, c’est loin, et Defoe note : « À l’époque, nous n’avions pas tous ces journaux […] aussi les nouvelles ne se répandaient-elles pas dans toute la nation ». Rapidement, le grand public oublie la chose, et le sujet ne réémerge qu’en décembre 1664, lorsque deux Français sont les premières victimes répertoriées. Et avec eux apparaissent les premiers tableaux de décompte des victimes, par paroisses, publiés hebdomadairement : « Peste, 2. Paroisses infectées, 1. »
Cette fois-ci, les gens sont inquiets. Mais, au cours des semaines suivantes, il n’y a pas de nouveaux décès, aussi tout le monde se dit que l’épidémie est passée. Les autorités ne prennent pas de mesures particulières, et lorsqu’elles le font enfin, vers fin mai 1665, l’épidémie s’est déjà énormément étendue, et le décompte des morts devient « effrayant ». Les Londoniens qui sont en mesure de partir (plus précisément, ceux qui en ont les moyens) quittent la ville. Pour ce faire, ils ont besoin de sauf-conduits délivrés par le maire, qui les leur accorde volontiers, et beaucoup se réfugient ainsi à la campagne, contribuant à la propagation du bacille. Pendant ce temps, à Londres, « c’était une chose surprenante que de voir ces rues habituellement si encombrées à présent désertes ».
Mais le nombre de morts continue de croître, et les autorités en viennent à prendre des mesures de confinement, non pas préventives, comme le font les gouvernements aujourd’hui, mais qui ne sont appliquées que lorsque des cas sont avérés. C’est évidemment une très mauvaise idée car, dès qu’un cas est déclaré dans un foyer, les forces de l’ordre enferment le malade chez lui avec les siens, et deux gardes sont postés devant la porte pour empêcher toute infraction à la quarantaine, ce qui, presque obligatoirement, condamne à mort toute la famille. En conséquence, les gens font tout pour dissimuler qu’ils sont atteints et contribuent ainsi à propager encore plus l’épidémie.
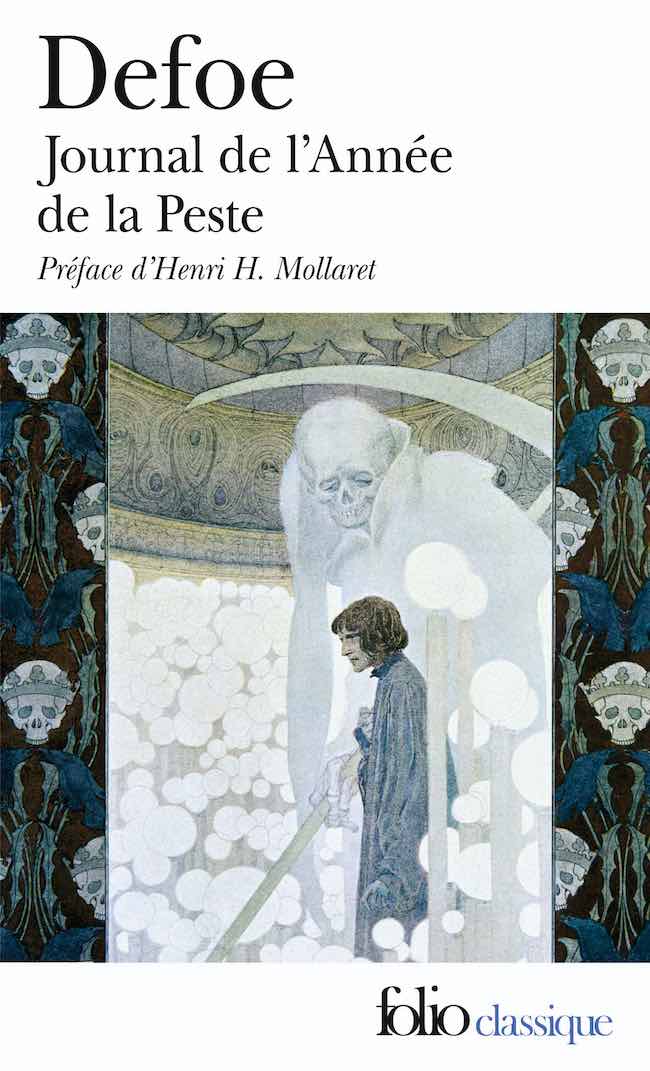
Certains, plus clairvoyants que les autres, géraient leur maisonnée « comme une garnison pendant un siège, sans laisser personne entrer ou sortir », mais la plupart, y compris le narrateur, « ne peuvent réprimer l’envie d’aller dehors » au bout de quinze jours de confinement volontaire – on notera la récurrence des préoccupations liées à l’isolement dans le Journal, de la part de l’auteur de Robinson Crusoé… Au plus fort de l’épidémie, H.F remarque « le profond silence qui règne dans les rues ». Quand tous les commerces sont fermés, la crise économique pointe, et « le travail, et par là même le pain, faisait défaut aux pauvres ». Ces derniers sont les plus durement touchés, et quand ils échappent à la peste, ils meurent de faim.
On pourrait continuer à établir une bijection entre ce qu’on observe aujourd’hui et ce qu’observait H.F : les Cassandre annonçant l’apocalypse, les vendeurs de recettes miracles, les empoignades entre les tenants des diverses théories concernant la contagion et la façon de s’en prémunir, et, plus que tout, les « explicationnistes » qui avancent aujourd’hui que « c’est la nature qui se venge » et qui clamaient à l’époque : « Dieu nous punit de nos péchés ». Ces similitudes sont l’aspect le plus saisissant de ce texte en ce début d’année 2020.
Enfin, le narrateur remarque que, à la suite de cette épreuve, contrairement à ce qu’il aurait pu croire, « toutes choses reprirent leur cours peu désirable, redevenant ce qu’elles étaient auparavant ». Espérons – naïvement ? – que le parallèle ici présenté n’ira pas jusque là et que nous saurons collectivement, une fois cette crise passée, ne pas retourner à nos affaires comme si de rien n’était.












