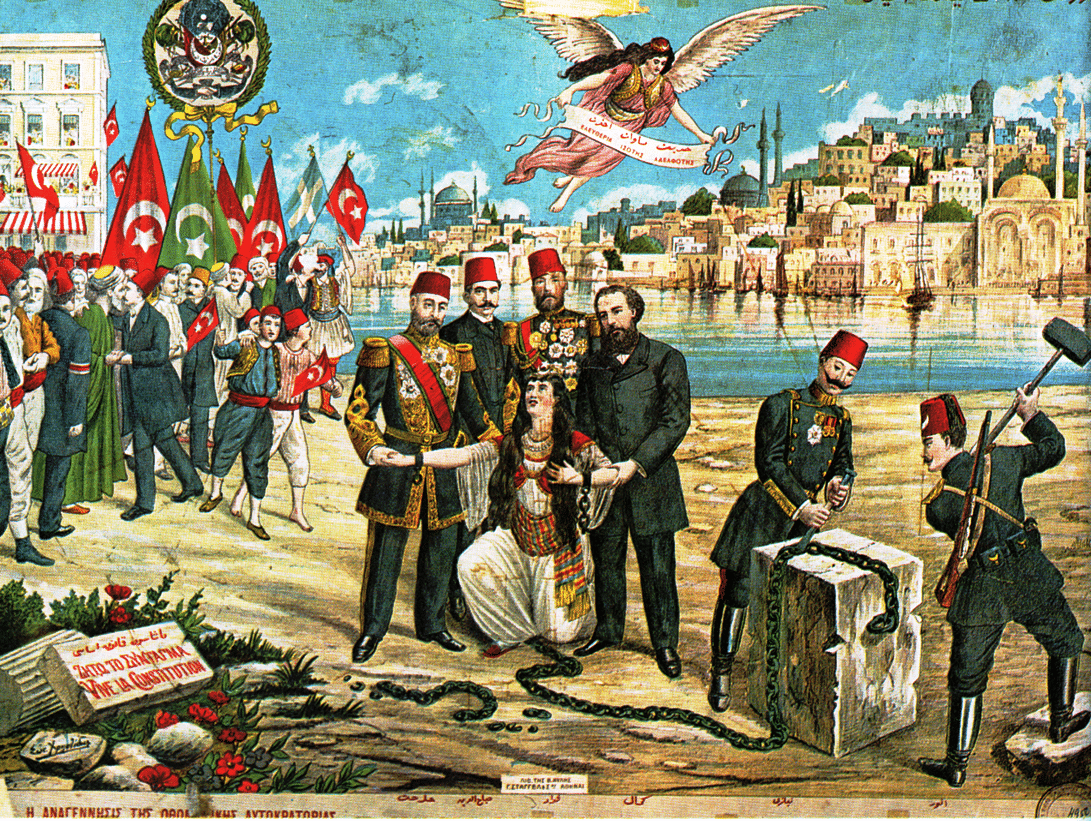Entre avril et juillet 1994, le régime hutu au pouvoir au Rwanda procédait à l’élimination de la minorité tutsi et de ses opposants au cours d’une extermination organisée et systématique à grande échelle. Le 22 juin 1994, la France, son soutien contre la rébellion du Front patriotique rwandais (FPR), lançait l’opération Turquoise, officiellement pour « arrêter les massacres ». Vingt-cinq ans après, l’histoire du génocide est plus écrite que l’histoire de la France au Rwanda. Et tandis que les officiels français creusent leur silence, les Rwandais prennent la parole. Catherine Coquio, qui était au Rwanda en avril dernier, évoque pour En attendant Nadeau les commémorations officielles, le colloque international qui s’y est déroulé, ainsi que l’important livre de Laurent Larcher, Rwanda. Ils parlent, qui élargit le spectre aux relations malades de la France à l’Afrique et élabore une impressionnante et originale méditation sur la « zone grise » en (post)colonie.
Laurent Larcher, Rwanda. Ils parlent. Témoignages pour l’histoire. Seuil, 800 p., 24,90 €
Le 14 juin s’est tenu au musée de l’Armée un colloque organisé par le ministère des Armées « en hommage aux soldats de Turquoise vingt-cinq ans après ». La ministre Florence Parly a assuré que « le sujet serait abordé de façon opérationnelle, on ne fait pas de politique », tout en confiant le soin d’ouvrir la séance à l’amiral Lanxade, ancien chef d’état-major de François Mitterrand [1]. Pour les 25 ans du génocide des Tutsi rwandais, le gouvernement a donc décidé de célébrer l’opération militaire controversée qui se déroula du 23 juin au 21 août 1994, et qui se donnait pour « mission de mettre fin aux massacres partout où cela sera possible, éventuellement en utilisant la force ». Et ce, après avoir créé une commission d’historiens où ne figure aucun spécialiste de l’histoire du Rwanda, ni de la France au Rwanda. Le 22 juin, date anniversaire de l’autorisation de l’ONU pour lancer l’opération, un autre colloque est prévu à Paris, intitulé « Bisesero, l’opération Turquoise face au génocide des Tutsi », où parlent deux personnes rescapées des massacres. Organisé par Survie, la FIDH et la LDH, il ouvre la campagne « 25 ans d’impunité » qui s’achève les 27, 28 et 29 juin, jours anniversaires des massacres à Bisesero, auxquels l’armée française n’a précisément pas mis fin. Ces échanges se tiennent significativement à deux pas de la Bibliothèque François-Mitterrand.
Retours à Kigali
« Au Rwanda, le 7 avril les oiseaux ne chantent pas. C’est comme s’ils savaient », disait il y a cinq ans le chanteur et romancier Gaël Faye au retour des commémorations d’avril 2014 à Kigali. Et il ajoutait : « le génocide n’est pas une maladie, on n’en guérit pas, on vit avec, plus ou moins mal » [2]. En avril, je me suis rendue à Kigali pour participer et assister aux commémorations des 25 ans du génocide, « Kwibuka25 ». J’ai entendu peu de chants d’oiseaux, mais beaucoup de paroles, et quelques chants humains.

Kigali (avril 2019) © Catherine Coquio
Au retour, j’ai lu le livre de Laurent Larcher, Rwanda. Ils parlent. Témoignages pour l’histoire, livre proliférant, trop pour atteindre un vaste public mais livre important, car ce qu’on y entend « parler » est au fond inouï, même si les faits évoqués sont en partie connus. Bien qu’il s’agisse d’une enquête politique, son apport majeur se situe dans la langue de ceux qui « parlent », dans l’image qu’ils donnent d’un certain rapport français à l’Afrique, au monde, au pouvoir, à l’action et à l’histoire, dans la difficulté surtout qu’ont certains acteurs à devenir témoins pour l’histoire : 23 acteurs politiques, militaires, médiatiques, humanitaires et religieux qui répondent à la maïeutique d’un reporter du journal La Croix, lequel, ni témoin ni acteur du génocide lui-même, semble jouer là le sens de sa propre vie.
Dans ce théâtre de paroles, la scène est en France, ou plutôt elle est la France au sens de l’État français, son état-major et ses soldats, sa « cellule élyséenne », son Matignon et son Quai d’Orsay, ses cerveaux et ses corps, ses services et ses serviteurs, ses partis et ses disputes, sa gauche et sa droite. Mais aussi ses mythes en matière d’Afrique, de politique africaine de la France et de « vraie culture de l’Afrique » comme dit l’ancien chef d’état-major de François Mitterrand ; son imaginaire en matière de race, de majorité et de minorité, de demos et d’ethnos…
Ces « paroles » françaises complètent celles que livre Jean-Christophe Klotz dans son documentaire Retour à Kigali [3], diffusé ce même mois d’avril : un film important lui aussi, où l’on voit en chair et en os certains de ceux qu’on entend parler chez Larcher, Français mais aussi diplomates et hauts fonctionnaires belges, canadiens et américains. Film violemment amer : jeune reporter en 1994, Klotz était au Rwanda au plus fort du génocide et avait tenté en vain d’empêcher par sa caméra et ses communiqués un massacre de Tutsi réfugiés dans un orphelinat catholique. Cette scène terrible était au cœur de son premier film en 2006, Des images contre un massacre, et revient dans Retour à Kigali comme un cauchemar qui hante, accompagné d’un dossier à charge accablant, qui creuse l’angoisse de l’inempêché : « Nous y étions, nous avons filmé, nous avons raconté. Nous aurions pu éviter un massacre et on n’a rien fait [4]. »
« Si je suis retourné à Kigali, dit Klotz aujourd’hui, c’est parce que j’avais la conviction qu’à 25 ans de distance, la parole pouvait se délier et la vérité enfin émerger ». C’est fort du même espoir que Laurent Larcher a entrepris de « délier » les paroles, mais c’est une autre vérité que fait émerger son livre en donnant à ses « témoignages pour l’histoire » une caisse de résonance imprévue. Je voudrais faire entendre un peu de cette résonance, mais seulement après avoir évoqué les journées d’avril à Kigali : journées d’un deuil impossible mais humain, étrangement humain, là où le livre de Larcher fait entendre un son inhumain au fond de paroles trop humaines. Le grand écart vertigineux entre les âpres rites de la commémoration rwandaise et la description du déni qu’entreprend ce livre à charge inspire un sentiment violent, entre effroi et dégoût, qui ne relève même plus du sentiment d’injustice : il ouvre à travers ces paroles un trou sans fond, dont l’idée de différend, souvent reprise à Jean-François Lyotard pour parler de la négation du génocide nazi, ne rend pas bien compte.
« Avec le Rwanda, il y a quelque chose de vertigineux. À chaque fois que je retravaille ce sujet, je reviens au même état de vertige », dit le journaliste Vincent Hugeux à Larcher, qui commente : « Je partage son vertige ». Et Patrick de Saint-Exupéry, présent au Rwanda en juin 1994, en 1993, et dès 1990 lors de l’opération dite « Noroît », dit au sujet de ce premier regard : « d’entrée de jeu… ce dossier aspire. On sent très nettement : il y a quelque chose de bizarre. Qui cogne. […] cette histoire-là n’est pas finie. Elle continue, elle se poursuit ».
Pour moi aussi, qui n’ai été témoin de rien en 1994, ce voyage à Kigali était un retour. J’ai découvert le Rwanda en 2000 sous le signe de la littérature, en accompagnant les auteurs africains réunis par Nocky Djedanoum pour l’opération « Écrire par devoir de mémoire » de Fest’Africa. Bien que tardive, cette découverte, en effet vertigineuse, a été un tournant : derrière l’histoire d’un génocide il y avait l’histoire coloniale de la France et sa relation narcissique à l’Afrique, un monde qui « cogne » et fait parfois vaciller la pensée.
Kwibuka 25 : commémoration internationale et rite national
L’organisation des commémorations est une affaire d’État, qui concerne la politique internationale. « Kwibuka 25 : remember-unite-renew », tel était le titre officiel de l’événement qui figurait partout en langue anglaise : le Rwanda est devenu anglophone, même si le français s’y porte mieux qu’il y a dix ans, l’élection de Louise Mushikiwabo à la tête de l’Organisation internationale de la francophonie en 2018 ayant eu des effets sensibles dans l’intelligentsia. La Commission nationale de lutte contre le génocide (CNLG), créée en 2007 pour préserver la mémoire du génocide et lutter contre l’idéologie ethniciste, y prend une part décisive, mais c’est tout le régime du Front patriotique rwandais (FPR) et de Paul Kagame qui s’y expose à la face du monde.

Kigali Conference Center, avril 2019 © Catherine Coquio
Le 7 avril, les puissants furent nombreux à discourir sous la tournoyante coupole du Kigali Convention Centre, superbe fleuron d’architecture contemporaine au cœur de la capitale, qui donne une image un rien babélique de la mutation du pays et des ambitions du régime. Ce fut une longue litanie d’éloges de l’exceptionnel « leadership » rwandais, saluant la « leçon » donnée par le Rwanda au monde et aux Africains, éloges prononcés par les amis politiques du président avant son propre discours. Certaines présences faisaient mal, comme celles de Denis Sassou N’Gesso et d’Idriss Deby, heureusement silencieux, et en tribune du délégué de l’Union africaine, malheureusement bavard. Mais de vraies voix se sont fait entendre, comme celle du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui, présent en 1995 comme soldat des Nations unies, a parlé en « témoin de la dévastation » avant de saluer la « réussite extraordinaire » des « solutions locales ». Parmi les rares Européens en tribune, l’hommage intense du Premier ministre belge, Charles Michel, contrastant avec le pathos idéalement creux de Jean-Claude Junker (« C’est au cœur des moments les plus sombres que nous remontons dans la lumière »), a fait résonner le silence français. Invité, le président Emmanuel Macron avait renoncé à venir : occupé à mater les Gilets jaunes et soucieux du soutien de son armée, il a envoyé un député d’origine rwandaise, chargé de se taire.
Le soir du 7 avril, la veillée nationale s’est déroulée selon le rite dans l’immense stade Amahoro, sur les hauteurs de Kigali. Après un long temps ponctué de chants de deuil, un jeune rescapé tutsi, dont l’image est apparue sur deux écrans géants au-dessus d’une foule juvénile, jusque-là bavarde, a raconté son histoire de déchirure familiale, de solitude et d’intégration, d’efforts couronnés de succès scolaires. Cauchemar, résilience, dignité et force recouvrées : c’est au jeune survivant devenu acteur social d’incarner l’histoire héroïque d’un pays qui se redresse.
Plus que toutes ces paroles, ce sont les visages qui sont fichés dans ma mémoire, certains avec netteté, d’autres brouillés dans le grand émoi troublé qu’ont été ces journées, d’où l’on ne pouvait revenir qu’étourdi, sonné, presque giflé. Et cette fois la gifle venait surtout de l’immense énergie qui se manifeste dans ce pays en plein essor, bien qu’inconcevablement sinistré. L’étranger français qui débarque au Rwanda, fatigué et hébété par le climat sociopolitique de son pays, mouliné de violences diverses, de débats irréels et de querelles publiques aussi fatales qu’ineptes (sur la « tyrannie des minorités » ou l’incomparabilité de la Shoah et de l’esclavage, par exemple), est frappé d’une évidence : malgré la vigueur de sa propre jeunesse, notre pays est vieux, très vieux. D’une vieillesse privée de sagesse, et dont l’énergie même s’apparente à de la démence sénile.
Est-ce une question d’âge moyen, de natalité ? Au Rwanda, où 60 % de la population a moins de 20 ans, tout est évidemment différent, sonne et bouge autrement, et cette vitalité n’est pas pour rien dans la sensation d’y voir s’illustrer le propos de Hannah Arendt : chaque naissance ouvre un monde. Cette aptitude à (re)commencer s’éprouve dans la vibration de l’air et la vitesse des gestes, mais aussi dans les rires et les sourires qu’on reçoit en plein cœur. Souvent ironiques et parfois complices, d’une tristesse reléguée au fond, ils diffusent sans le vouloir un secret bienfait, qui se mêle à la honte de tant d’immenses privilèges oubliés, et réveillent quelque chose comme de l’espoir.
Car ce pays très jeune revient de très loin, enfants et nourrissons compris, et ce très loin fait partie de l’incroyable énergie présente. Le très regretté Naasson Munyandamutsa, psychiatre mort en 2016 et dont le souvenir était vif en ces jours, tant son intelligence a aidé à vivre et penser l’après, a écrit un texte où on lit ces lignes : « Ce qui va te tuer, c’est aussi ce qui va te sauver. Ce qui fait qu’on vient de loin est aussi ce qui peut faire aller très loin ». Son espoir à lui s’exprimait en ces termes : « Mon plus grand rêve est que les enfants de ce pays puissent se rencontrer en découvrant que la diversité constitue une valeur inestimable. […] Les citoyens du monde pourront passer ici pour voir comment on peut survivre après les cendres, comment, même sans moyens, on peut créer. […] Ce pays pourrait devenir une leçon pour l’humanité [5] ».
Une extermination fratricide produit des ondes de choc dont personne ne peut fixer la durée, ni toutes les formes. Quand une jeunesse est appelée à commémorer une catastrophe qu’elle n’a pas vécue, sinon par un legs familial fait d’un deuil sans fin, ou d’une culpabilité sans fond, une étrange passation a lieu : la tâche est léguée de créer un avenir dans l’obligation de vivre ensemble, et « ensemble » signifie ici la cohabitation forcée des descendants de victimes et de perpétrateurs. La parole publique joue alors le rôle de tiers dans une histoire familiale forcément déchirée pour les enfants de victimes, forcément anxiogène pour les enfants d’assassins – comme le montrent les films d’André Versaille [6], de Violaine Baraduc et Alexandre Westphal [7]. De cette passation de l’avenir on s’étonne d’être le témoin, stupéfait qu’un tel mandat de vivre existe sur terre. Au-delà des questions politiques qu’elle suscite, elle pourrait nourrir une vie de méditation.
Étourdie, sonnée, émue, je l’ai été en particulier lorsque, le soir du 7 avril, des milliers de bougies se sont allumées sur les gradins de ce stade géant de 10 000 places, plein à craquer d’une foule très jeune. Moment difficile à oublier, qui à cause de ce chiffre fut parasité par un autre souvenir : 10 000, c’était aussi le nombre de morts retrouvés en 1994 dans l’église de Nyamata et ses alentours, que j’avais visités la veille. Ce lieu de refuge devenu celui d’un épouvantable massacre est à présent l’un des mémoriaux rituellement visités, avec ceux de Murambi, Bisesero, Ntarama, et surtout Gisozi, le centre d’exposition et de documentation créé en 2000 avec l’ONG britannique Aegis Trust.

Dans le stade Amahoro de Kigali (avril 2019) © Catherine Coquio
Ce fut un tout autre trouble que de voir, deux jours plus tard, une fillette photographier la pousse d’arbre que venait de planter la « Première Dame » dans le « Jardin de la Mémoire », inauguré le 8 avril à la périphérie de Kigali, en un lieu plein de sens : face au récent Mémorial de Nyanza-Kicukiro, sur la route du Bugesera qui mène au Mémorial de Rebero où sont enterrés les politiques qui avaient résisté au génocide. Dans ce lieu, où 4 000 Tutsi ont été assassinés après le départ des troupes belges, viennent d’être réinhumées 35 756 dépouilles exhumées des divers quartiers de Kigali.
Le Jardin de la Mémoire est le résultat d’un vaste projet de l’artiste plasticien Bruce Clarke, conçu vingt ans plus tôt. « “Jardin”, “Garden”, nous avons choisi ces mots car notre langue aurait dit “potager”, a expliqué, presque espiègle, le président de la CNLG. En kinyarwanda, pour que notre jeunesse entende bien » : « c’est un peu colonial et catholique, mais c’est une manière de les entraîner avec nous ! ». Bruce Clarke, artiste sud-africain devenu français, s’est laissé entraîner, et convaincre. Il avait imaginé au départ, en guise de « cathartic healing process », de faire poser aux Rwandais un million de pierres, une par disparu, ce qui aurait abouti à un énorme Treblinka rwandais – mais non : le Jardin de la Mémoire sera fait d’arbres vivants, réels et symboliques. 25 jeunes Rwandais ont planté les premiers d’entre eux dans un paysage qui représente les périls surmontés (marais, fosses, spirales de la violence…), mais surtout le refuge et la vie retrouvée. « Le Jardin de la mémoire sera plein d’arbres, de fleurs et de fruits, il formera un lieu paisible et harmonieux où se ressourcer à la mémoire des nôtres », a dit en français le président d’Ibuka. Au Rwanda, le langage de la mémoire est celui de l’arbre qui repousse et fait revivre ensemble.
Ce langage de l’arbre nouveau relève du pari politique : « Nous misons sur la génération nouvelle. Si un arbre ne peut plus être redressé, le potentiel de la graine est illimité », a dit Kagame à la fin de son allocution le 7 avril, recourant tout du long au langage à la fois du défi et du cœur. Langage du combat et de la force aussi, ponctué d’allusions aux tensions régionales actuelles avec l’Ouganda, le Burundi ou la République démocratique du Congo. Au cours de cet étonnant (et remarquable) discours, Kagame a remercié les survivants du prix élevé que l’effort national leur faisait payer, mais aussi les assassins qui avaient reconnu leur crime, pour dire à tous leur appartenance à la nation nouvelle et l’importance vitale de leurs efforts pour l’avenir. Mais l’exhortation à l’unité valait aussi pour les « frères d’Afrique » (« Ce qui nous unit est toujours infiniment plus grand que ce qui nous divise »), et cette re-vie concernait le monde : « Le génocide a décimé la population rwandaise plus radicalement qu’une arme de destruction massive. […] La seule conclusion à tirer de notre histoire, c’est qu’il y a de l’espoir pour notre monde. Aucune société n’est jamais trop détruite pour se redresser. Jamais la dignité d’un peuple ne peut être détruite ».
Cette vingt-cinquième commémoration voulait marquer le coup : celui du passage de la déchirure collective à la reconstruction nationale unitaire, du trauma à la résilience ; celui aussi d’une « histoire à écrire à l’endroit » (Dafroza Gauthier) et dans une longue durée. 2019, c’est non seulement 25 ans après le génocide, mais soixante ans après la « révolution sociale » de 1959, qui lança le signal de pogromes anti-Tutsi, lesquels, comme cela fut rappelé par Jean-Damascène Bizimana, président de la CNLG, furent qualifiés de génocide dans plusieurs journaux français dès 1964. Telles étaient les lignes directrices des événements qui ont ponctué cette commémoration, et pour commencer la « Kwibuka 25 International Conference » des 4-5 avril, organisée par la CNLG dans l’immense salle de congrès du FPR à l’extérieur de la capitale. Ce débat, à la fois très encadré et assez improvisé, rassemblait à chaque fois une quarantaine de personnes autour des enjeux sociaux, judiciaires et mémoriels de l’après-génocide : chercheurs, acteurs politiques et culturels, jeunes rescapés tutsi, mais aussi jeunes Hutu désireux de participer publiquement à l’essor national – sous le regard ironique des survivants d’Ibuka.

Église de Nyamata (avril 2019) © Catherine Coquio
Au-delà des échanges sur la résilience post-génocide, qui ont fait revenir le parallèle avec l’Afrique du Sud (Boatomo Mosupyoe) et le génocide des Juifs (Aleksander Edelman, petit-fils de Marek Edelman, qui prépare un film sur la jeunesse rwandaise, a plaidé pour la lutte et le rire), les débats les plus vifs et les plus précis ont porté sur les imbroglios politico-judiciaires et leurs pommes de discorde : les archives rwandaises prêtées au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) d’Arusha et que l’ONU refuse de rendre ; le refus des demandes d’extradition au prétexte de la non-équité des procès rwandais (sur 1 012 demandes, 19 ont été satisfaites) ; la lenteur des instructions menées en France par le « pôle génocide » créé en 2012 au tribunal de grande instance de Paris. Malgré trente plaintes déposées, dont deux dès 1995 – et plusieurs grâce aux enquêtes du Collectif des parties civiles pour le Rwanda, créé en 2001 par Alain et Dafroza Gauthier, les « Klarsfeld rwandais » [8] –, deux procès seulement ont eu lieu, en 2014 et 2016.
Le chapitre des responsabilités internationales a fait aborder les responsabilités décisives du Conseil de sécurité de l’ONU. Linda Melvern a détaillé celles de son conseil d’administration, dont dépend l’application de la convention de 1948, ici devenu l’« épicentre du déni » aux bons soins de Boutros Boutros-Ghali, qui, fortement soutenu par Mitterrand après sa campagne d’élection au poste de secrétaire général, a filtré et pesé partout dans le même sens, et facilité les livraisons d’armes au Rwanda. Charles Petrie, ex-coordonnateur adjoint aux affaires humanitaires de l’ONU, auteur de The Triumph of Evil [9] , a évoqué les « seigneurs de guerre » de l’ONU et le cas de deux criminels rwandais qui ont continué d’y travailler après le génocide, sans être jamais arrêtés.
Concernant l’histoire rwandaise, les domaines abordés ont été, classiquement, l’idéologie du génocide et ses médias par Jean-François Dupaquier, la guerre de libération de 1990 à 1994 par un de ses acteurs, le général-major Charles Karamba, la « transformation » du Rwanda post-génocide. L’historien Jean-Paul Kimonyo, conseiller du président Kagame et auteur de Rwanda demain (Karthala, 2017), a présenté la politique de reconstruction dite d’« appropriation radicale » comme un mélange d’« ethos de dignité », de volontarisme et de pragmatisme : démocratie consensuelle, développement inclusif participatif, parité (51 femmes sur 80 députés au Parlement), rôle donné aux jeunes…
Rien ne s’est dit des politiques d’éducation – l’enseignement de l’histoire du génocide à l’école reste minimal car porteur de divisionnisme – et très peu sur l’écriture de l’histoire. Stéphane Audoin-Rouzeau a distingué « l’ethos de vérité » propre à l’historien du rôle de transmission des œuvres ; mais il est resté silencieux sur la commission d’historiens que venait de créer Emmanuel Macron, en partie à son instigation, mais dont il a été évincé car jugé trop partial : l’historien, auteur de Rwanda. Une initiation (Les Belles Lettres, 2017), a préfacé le livre de l’ancien militaire Guillaume Ancel, sur lequel on reviendra plus loin. C’est Jean-François Dupaquier, auteur de Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda. Histoire d’une désinformation (Karthala, 2015), qui a vertement mis en cause cette commission jugée fantoche et son président, l’historien Vincent Duclert, rappelé à la « dignité » rwandaise. En réponse, celui-ci a rappelé l’affaire Dreyfus et affirmé qu’un refus de sa part aurait probablement compromis la création de cette commission, qui devait absolument se tenir.
Ils parlent : non une commission d’enquête, mais le « journal d’une enquête »
C’est donc en aparté, lors de ces journées tendues, puis les semaines suivantes que j’ai lu l’épais livre de Larcher qui, en plus de rouvrir le dossier des responsabilités françaises, documente la lourdeur et la variété du déni politique et militaire et « voyage dans les méandres de la mémoire » en observant de très près les régions du « pas net » et du « gris ». Cette approche à la loupe éclaire d’une lumière crue les points de fuite de chacun, et ouvre certains abîmes. En lisant ce livre, je crois que j’ai compris pourquoi la France est un si vieux pays. La vieillesse est un naufrage, dit-on, et le mot convient bien quand un État se laisse à ce point submerger par son histoire. Naufrage avec spectateur, car le lecteur observe l’engloutissement des officiels (parmi lesquels l’ancien ministre Alain Juppé et l’ancien secrétaire général de l’Élysée Hubert Védrine) en se demandant : comment peut-on être français ?
De nombreux ouvrages ont été écrits sur la question des responsabilités françaises au Rwanda. Celle-ci a fait l’objet de deux commissions fort différentes, l’une en 1998 dite d’ « information parlementaire », présidée par le socialiste Paul Quilès et publiée sous le titre Enquête sur la tragédie rwandaise 1990-1994 ; l’autre dite d’« enquête citoyenne », initiée en mars 2004 par le collectif Survie avec d’autres associations dont la Cimade et Aircrige [10]. Ses 600 pages d’actes ont paru sous le titre L’horreur qui nous prend au visage. L’État français et le génocide au Rwanda (Karthala, 2005), en écho à la formule qu’avait utilisée Mitterrand le 10 mai 1994 dans son intervention télévisuelle : « Nous ne sommes pas destinés à faire la guerre partout, même lorsque c’est l’horreur qui nous prend au visage ». En préface, il était rappelé qu’une guerre française avait au contraire été menée au Rwanda, que le général Quesnot, son chef d’état-major, avait même appelée « une vraie guerre, totale et très cruelle ». Survie était alors dirigée par François-Xavier Verschave, décrypteur et pourfendeur de la « Françafrique » qui fut aussi l’un des premiers à se pencher sur ce « plus long scandale de la République », avec de nombreux journalistes et chercheurs (Colette Braeckman, Jean-François Dupaquier, Jean-Paul Gouteux, Maria Malagardis, Jacques Morel, Gérard Prunier, entre autres). Il siérait de rompre la lourde amnésie qui pèse sur l’énorme travail de Verschave, après qu’il a été traîné dans la boue de son vivant pour des raisons transparentes (la CEC dépouillait les traitements médiatiques du génocide en 1994), silence que les disputes actuelles ne sont pas propres à briser (son nom apparaît dans Ils parlent via les mauvais souvenirs que la CEC a laissés à Jean-Christophe Rufin).

Laurent Larcher © Jérôme Panconi
L’initiative de Larcher se veut elle aussi d’ordre « citoyen ». Son livre, qui ne relève ni du journalisme ni de l’histoire, mais cultive le brouillage des deux, questionne à son tour les zones d’ombre que la mission parlementaire avait contournées pour conclure au refus de toute responsabilité directe. Son président y est mis en cause par plusieurs pour cet évitement : « Il n’y avait pas d’enquête du tout, dit Gérard Prunier, ça a été un forum devant lequel chacun déclarait ce qu’il voulait bien déclarer. Et on vous demandait jamais de prouver. […] le but de l’opération, c’est de faire semblant. […] Il aurait fallu faire un boulot de flic. Un travail de juge d’instruction ». La lecture du rapport de la mission, où chaque intervention a été retranscrite à la troisième personne et lissée, lui a inspiré sa forme directe : « ne pas filtrer les discours » est le « bon chemin pour ce voyage dans les méandres de nos mémoires » et pour « fissurer la parole fabriquée ». Là où les rédacteurs de la mission avaient « passé au tamis » les propos, Larcher fait méthodiquement le contraire : il enregistre ses témoins dans un lieu ad hoc (café, bureau), transcrit et livre au lecteur les « pièces d’un dossier à trancher ou d’un puzzle à assembler » en faisant entendre le parler de chacun, mais aussi ses silences, balbutiements, hésitations, confusions, rires, troubles… Cette restitution est le gage d’un contrat de véridiction qui concerne l’histoire collective dont chacun témoigne, mais aussi la parole des individus témoins.
Cette parole vivante signe fortement ces « témoignages pour l’histoire », et dresse un portrait de chacun, parfois attachant, désarmant, souvent redoutable. Les locuteurs n’ont pas dû être très joyeux en lisant ce livre, tant les règles de ce jeu de la vérité se retournent contre eux, parfois avec fracas, même si l’auteur se heurte parfois à un mur. L’escrime de Larcher fait chou blanc devant Juppé, bardé dans son discours bouclé et minuté, même s’il se prend les pieds dans sa colère avant de prendre congé. Réflexions en roue libre, ratiocinations, borborygmes, sont entrelardés des commentaires de l’auteur : questionnements intérieurs, impatiences, ruses, lassitudes, stupéfactions, mais aussi micro-récits, confidences et détails d’allure anodine, le tout déballé à plat, ou plutôt scrupuleusement livré en aparté relativement à l’échange effectif, comme s’il en allait d’un même procès de vérité dans la maïeutique de l’échange, dans les moindres données annexes (circonstances du dialogue, modalités et délais de rendez-vous, physionomies et vêtements du locuteur, objets, débit) et dans un flot subjectif (impressions, souvenirs personnels, filmiques et livresques, angoisses, insomnies, associations d’idées).
La parrêsia intranquille d’un chrétien
Ce livre d’entretiens compose ainsi un autoportrait moral inscrit dans l’histoire d’une génération, celle des guerres civiles : le Liban, l’ex-Yougoslavie, l’Algérie, sont à plusieurs reprises évoqués. L’auteur, qui apparaît en père de famille, revient souvent sur son itinéraire d’intellectuel catholique de gauche. Auteur d’ouvrages sur les militants chrétiens en banlieue, sur la face cachée fascisante de l’écologie et sur les non-dits de la diplomatie française, cofondateur de l’Observatoire Pharos-Pluralisme des cultures et des religions, il a initié en 2008 une vaste campagne de soutien aux chrétiens d’Irak et créé en 2011 l’association « Liberté pour l’esprit » destinée à créer un réseau de journalistes dans les zones de guerre. Formé à l’histoire à l’EHESS, il avait renoncé à l’enseignement pour le journalisme de reportage, qui lui a fait couvrir de nombreuses zones de guerre vingt-cinq ans durant – c’est le sujet de son prochain livre.
Or ce tournant avait été pris lors d’un voyage au Rwanda à l’été 1994. Habitué de La Croix, où il a publié de nombreux articles sur l’Afrique subsaharienne, Larcher raconte que dans le tout premier, paru le 31 août 1994, il évoquait une lettre découverte dans les archives du Secours catholique. Écrite par un groupe de missionnaires le 15 janvier 1964, elle dénonçait le silence qui pesait sur le « génocide de 10 000 Tutsi » perpétré au Rwanda un mois plus tôt. L’un de ses rédacteurs était le père Henri Bazot, qu’il rencontra alors à Paris, et à qui, vingt-cinq ans plus tard, il dédie son livre – en même temps qu’aux 800 000 victimes, aux survivants et à un prêtre assassiné par ses propres fidèles. Cet hommage est une des motivations majeures de l’enquête, sans doute sa trame porteuse. Cherchant sa trace, Larcher apprend par une lettre des Pères blancs que ceux-ci « ne pensent pas “souhaitable de rappeler son nom” », et perçoit cet ultime silence « comme le froid qui transite dans le neuvième cercle ». Son insistance lui vaut de rencontrer « le Père X », dont il recueille les propos dans le chapitre sans doute le plus abyssal du livre. Les propos en zigzag du père lui font comprendre que Bazot a été victime d’une chasse aux sorcières ecclésiastique et révèlent diverses choses aussi accablantes pour l’Église que pour l’État. Par exemple que l’archevêque André Perraudin, qui avait joué en 1959 un rôle décisif dans la traque de milliers de Tutsi, et qui disait : « l’indépendance va nous amener les communistes », conseillait directement Mitterrand sur la politique à suivre, et fut consulté par l’ambassade de France au moment de choisir les ministres du président Habyarimana.
Cette faillite politique et morale de l’Église catholique au Rwanda, Larcher la rapproche du scandale des prêtres pédophiles couverts par leur hiérarchie : ici et là, l’Église se révèle être une « institution aveugle aux victimes, tolérante pour les criminels ». Ce lien s’inscrit dans le livre au moment où l’auteur évoque sa genèse, comme l’effet de deux événements : le « pacte silencieux » passé avec une amie qui avait porté plainte contre son père abusif, et le décès de Sacha, petit-fils d’un ami, mort d’un cancer à six ans, dont la vue du cercueil aux obsèques et le chagrin du grand-père et du père l’avaient « transpercé ».

Le fond hanté de la conscience est une mauvaise conscience. Lorsque, à l’été 1994, il est venu avec le Secours catholique pour « aider les victimes », Larcher n’a « rien compris. Rien vu » : « Qui avons-nous aidé cet été-là ? » Comprendre et voir a fait vaciller la foi. Larcher rappelle qu’en 2001 un reportage pour La Croix lui avait fait passer deux jours en compagnie d’Augustin Misago, l’évêque qui en 1994 avait laissé faire les massacres dans tout son diocèse : c’est ce que lui avait révélé un prêtre tutsi de Kibeho sauvé par les soldats de Turquoise. Lequel lui avait également raconté le massacre des déplacés hutus par le FPR en avril 1995, révélation prise « en pleine figure ». « Quelque chose de profond et d’essentiel s’est éteint en moi à Kibeho », dit l’auteur. Et c’est dans la pensée de ce lieu vide, « d’où Dieu et l’humanité avaient été bannis », qu’il fait résonner la voix haineuse de Madeleine Raffin, ex-directrice de Caritas au diocèse de Gikongoro, expulsée du Rwanda en 1997 pour le soutien actif qu’elle avait apporté aux génocidaires, et qui l’appelle au téléphone pour lui parler du « F.P.R du diable ». « Une voix inoubliable par sa texture, son émotion, son ressentiment », issue d’un « aveuglement terrible », qui la fit vivre jusqu’à sa mort « dans le songe éveillé de l’Église catholique au Rwanda ».
Se livrant ainsi au lecteur, lui et sa parrêsia de citoyen et de chrétien révolté, l’auteur veut lui faire partager ses inquiétudes et le gagner à son intranquillité. Le livre est explicitement placé sous le signe de ces deux valeurs, reprises à Foucault et à Pessoa. Ils parlent est d’ailleurs truffé de références littéraires – Virgile, Racine, Péguy, Camus, Orwell, Ingeborg Bachmann, mais aussi Patrice Nganang (Empreintes de crabe, sur la guerre camerounaise de 1955-1970) et Jean-Baptiste Naudet (La blessure, sur la guerre d’Algérie). Mais surtout Joseph Conrad : la référence court tout au long du livre qui veut être « un voyage au cœur des ténèbres, un récit de voyage dans la mémoire des Français du temps du génocide ». Si Larcher se compare à Marlow à la recherche de Kurtz, c’est que la relation franco-rwandaise reconduit aux ténèbres d’une histoire coloniale non réglée. Ils parlent est également travaillé par L’impérialisme et Le système totalitaire de Hannah Arendt, mais surtout par « Vérité et politique », grand texte suscité par l’affaire des Pentagon Papers et la guerre du Vietnam où elle analysait le processus de destruction de la réalité dont, dans les démocraties de masse, se chargent les « spécialistes de la solution des problèmes », acte radical qu’elle assimilait à un assassinat. Larcher le cite à point nommé à propos du rationalisme d’Hubert Védrine et de la « bêtise collective » de l’exécutif français, qui n’écouta pas ceux qu’on ne nommait pas encore « lanceurs d’alerte ».
Tout cela donne un livre substantiel et brouillon, palpitant et accablant, exaspérant à force de faire entendre la bêtise obtuse, l’intelligence inutile, la mauvaise foi stupéfiante. On y comprend de quelles erreurs monumentales est capable cette machine bringuebalante qu’est l’État français, où les instances et les protagonistes se doublent et se mentent à l’aveugle. Mais on y observe aussi une intelligence livrer une bataille têtue à l’obscène et au vide, dans des corps-à-corps au cours desquels les événements émergent à force d’être redépliés. Partant d’un récit pour aller vers un autre, l’auteur fait varier le point de vue au sein d’une même culture politique, et tente chaque fois de faire pénétrer la région de l’éthique par ceux qui structurellement la fuient. Armé d’une exigence de sens qui pour lui tombe sous le sens, il lutte contre le non-sens qui surgit et s’étale, à la manière un peu de Quichotte contre les moulins à vent.
Micro-histoires : raconter Turquoise « en détail »
Ils parlent trace une micro-histoire de 1990 à 1994, ponctuée d’une série d’actions françaises au Rwanda, dont certaines sont vite évoquées, tandis que d’autres sont observées au microscope. On peut les récapituler ainsi :
1. Opération Noroît (4 octobre 1990-décembre 1993), qui envoie secrètement un régiment de parachutistes en réponse à l’offensive militaire des rebelles du FPR le 1er octobre 1990 et à une attaque fictive de Kigali simulée par le président Habyarimana. Les « paras » sont suivis en 1991 d’un « Détachement d’assistance militaire et d’instruction », une trentaine d’hommes chargés de former l’armée et de « durcir le dispositif rwandais ». Trois ans plus tard, ils seront une centaine et l’armée rwandaise passera de 5 500 à 35 000 hommes. Ce, alors que, dès octobre 1990, l’ambassadeur Georges Martres avait parlé d’un risque de génocide, confirmé en novembre par le colonel Rwagafilita déclarant au général Jean Varret, chef de la Mission militaire de coopération : « Je vous demande ces armes car je vais participer avec l’armée à la liquidation du problème. Le problème, il est très simple : les Tutsis ne sont pas très nombreux, on va les liquider ». Varret, qui a informé ses supérieurs et tenté de freiner les actions du DAMI, sera remplacé par le général Huchon, adjoint du chef d’état-major particulier de Mitterrand, le général Quesnot. Cet encadrement militaire ne cessera pas avec les massacres des Tutsi du Bugesera en mars 1992.
2. Opération Chimère (20 février-28 mars 1993), où la cellule de l’Élysée radicalise son soutien sous la forme de nouvelles mesures imposées aux soldats français : patrouilles, contrôles de zones, vérification des identités autour de Kigali – ce dont commencent à s’inquiéter certains, comme Pierre Joxe. Le 4 août 1993, les accords d’Arusha prévoient, pour veiller au partage du pouvoir, l’installation d’une force des Nations unies (la MINUAR) et le retrait de l’armée française, effectif en décembre – mais non intégral.
3. Le 8 avril 1994, au surlendemain de l’attentat contre l’avion présidentiel, formation à l’ambassade de France du Gouvernement intérimaire rwandais (GIR), entérinée le soir même par l’ambassadeur Jean-Michel Marlaud, réunissant en fait les ministres hutus les plus radicaux.
4. Opération Amaryllis (9 avril 1994), soit l’évacuation de 1 400 Français et l’abandon du personnel rwandais, dont les 19 collaborateurs de l’ambassade, suivant la consigne orale : « uniquement les Blancs ».

Kigali (avril 2019) © Catherine Coquio
5. Enfin, opération Turquoise (23 juin-21 août 1994), intervention militaro-humanitaire destinée à « arrêter les massacres » (et non le « génocide »), décidée après la dénonciation par Médecins sans frontières du soutien militaire et financier des massacreurs par la France. Juppé a parlé de « génocide » le 17 mai. En juin, Mitterrand parlera d’une « bande d’assassins ». Cette opération, qui a sauvé des Tutsi mais a aussi permis aux assassins de se retirer et de se réarmer au Zaïre voisin (actuelle République démocratique du Congo), est marquée par le drame de Bisesero. Le colonel Rosier a laissé trois jours sans secours les survivants tutsis sous les yeux de journalistes, dont Sam Kiley et Patrick de Saint-Exupéry. C’est l’épisode des « trois jours de trop », raconté par celui-ci dans L’inavouable (Les Arènes, 2004), confirmé par Thierry Prungnaud dans Silence Turquoise (Don Quichotte, 2012, avec Laure de Vulpian). Cet ex-GIGN, qui avait formé la Garde présidentielle rwandaise et dirigé le Commando des opérations spéciales, est le premier militaire à avoir dénoncé la manipulation des soldats français. Cette opération Turquoise est revue en détail dans Ils parlent à partir du récit de Guillaume Ancel, auteur de Rwanda. La fin du silence (Les Belles Lettres, 2018), à qui est consacré le premier entretien.
Capitaine au 68e régiment d’artillerie d’Afrique, envoyé au Rwanda en renfort de la 1ère compagnie de légionnaires du 2e régiment étranger d’infanterie, Ancel affirme qu’un plan militaire « Turquoise 1 », destiné à défaire le FPR en faveur du GIR (qui orchestre toujours les massacres), a été remplacé in extremis par un « Turquoise 2 » humanitaire. Il dit avoir reçu l’ordre le 22 juin d’effectuer un raid sur Kigali, annulé brutalement, puis avoir été envoyé le 30 juin avec sa compagnie de légionnaires dans la forêt de Nyungwe pour procéder au bombardement du FPR, mission annulée le 1er juillet au profit d’un plan négocié avec Kagame : celui de la « zone humanitaire sûre » contrôlée par la France. Mais ce Turquoise 2 a poursuivi une action militaire en sourdine, permettant la fuite des génocidaires au Zaïre, que la France, loin de les désarmer, a réarmés : Ancel dit avoir vu une dizaine de camions transportant des armes en direction du Zaïre, et affirme qu’on lui a demandé de faire en sorte que les journalistes ne les voient pas. Enfin, il se dit hanté par ce 30 juin où sa compagnie a été envoyée à Nyungwe alors qu’à Bisesero des survivants se faisaient massacrer.
Au-delà de l’opération Turquoise, Ancel refuse la « culture du silence » de la « grande muette » qui fabrique du traître : « la guerre, on doit la faire mais pas la raconter, la raconter, c’est trahir. Tu mérites deux balles dans la tête ». Traité de subalterne et de mythomane par le haut état-major, Ancel n’est pas suivi par tous ceux qui dénoncent le rôle de la France au Rwanda. Larcher lui-même hésite, pense qu’il force le trait, mais s’intéresse à « la part de fiction qui se mêle à la vérité », et avoue que son doute est en partie stratégique. Or l’action de guerre avortée le 1er juillet est confirmée par un nouveau témoin : un aviateur nommé « Oscar » qui, sans vouloir témoigner publiquement, ne supporte pas de voir Ancel traité de menteur, et propose de s’en prendre aux premiers responsables : « On se déchire bêtement entre militaires ; comme s’il fallait couvrir les politiques qui nous ont ordonné de soutenir le régime rwandais ». Ancel, lui, livre de nouveaux détails sur la livraison d’armes et la bizarrerie des revirements inexpliqués de juin et juillet, qu’il interprète comme un « affolement du commandement » piégé par ses contradictions : malgré l’option humanitaire l’armée organise le repli des forces armées rwandaises et continue de diriger ses armes lourdes vers le FPR.
Ce dernier point est confirmé dans un petit film tourné par le colonel Éric de Stabenrath, commandant de Turquoise à Gikongoro, et que celui-ci donne à Larcher à la fin de leur échange. Autre moment majeur du livre, car ce film tourne à l’eurêka. Après la visite de Jean d’Ormesson aux soldats de Turquoise, « ravi d’être là » et ivre de connivence, le film montre un officier faisant le point devant une carte de la région. Or celle-ci indique en rouge la ligne de front entre l’armée rwandaise et les rebelles, mais aussi la position des Français, qui se tiennent derrière la première : venue arrêter les massacres, l’armée française assure les arrières des tueurs. À travers son « arrière-goût de film de vacances » montrant de sympathiques soldats parlant à de pauvres Noirs – invitant même un rescapé à narrer son histoire –, l’image dit des choses qui « échappent au réalisateur » : « la matérialité de l’opération Turquoise, sa texture, sa chair, sa composition ». Véridiction du détail, qui soudain rend palpable une situation historique que les paroles ont tendance à déréaliser et à abstraire.
On sait quelle politique du détail ont menée les historiens du génocide nazi – Raul Hilberg en particulier, Saul Friedländer d’une autre manière. Pour moi, la carte du film de Stabenrath s’apparente, mutatis mutandis, au détail dont parle Friedländer au début des Années d’extermination (Seuil, 2008) : sur la photo d’une soutenance de thèse prise à l’université d’Amsterdam le 18 septembre 1942, le jeune docteur, David Moffie, entouré des membres de son jury, porte une étoile juive marquée « Jood » : il est le dernier étudiant juif de l’université dans la ville sous occupation allemande, et il sera déporté peu après à Birkenau. Au cours d’une « cérémonie assez ordinaire », dans un cadre plutôt festif, dit Friedländer, un homme est déclaré apte à exercer le métier de médecin, mais aussi marqué pour la mort de masse très prochaine. Le détail cristallise la folie débonnaire d’un système criminel. L’historien en tire des conclusions méthodologiques : cette photo, dit-il, déclenche une incrédulité presque « viscérale », « de celles qui se produisent avant que la connaissance ne se précipite pour les étouffer ». Or ce « sentiment initial d’incrédulité », né de la « profondeur de la perception immédiate que l’on a du monde », n’a pas à être éliminé ni même domestiqué par la connaissance historique : celle-ci doit au contraire l’abriter.
À l’opposé de ce pouvoir de révélation, les propos d’Éric de Stabenrath l’empêtrent dans des contradictions sans issue, mais qu’il porte haut. Ce militaire plein du sens de l’honneur dit être revenu du Rwanda « avec un goût de cendres dans l’estomac », mais il reste un des plus vibrants laudateurs de l’opération Turquoise (il l’a été le 14 juin dernier au musée de l’Armée). Conscient du racisme à l’œuvre dans la politique française, il se dit dégoûté par le mot d’ordre d’Amaryllis (« Pas de Noirs dans les avions ! »), mais il préfère affirmer que « tous les Africains sont racistes » plutôt que de reconnaître que la politique d’Habyarimana l’était, et que la soutenir posait problème. Enfin, aristocrate lui-même, il se montre pourtant incapable de se dégager du stéréotype du grand féodal tutsi, et la gêne comique que provoque Larcher en le titillant là-dessus ne change pas sa vision. On apprend que Stabenrath avait suivi une formation militaire aux États-Unis avec Kagame, et que, fort de ces relations de « bons camarades », il lui fit parvenir des messages apaisants pendant Turquoise, ce qui ne l’empêcha pas d’ouvrir le feu sur une colonne du FPR s’infiltrant dans sa zone. Au Rwanda, Stabenrath est accusé d’avoir laissé faire les viols dans le secteur qu’il avait en charge et laissé sans protection les rescapés tutsis dans le camp de Murambi, livrés aux anciens militaires rwandais et aux miliciens parqués avec eux. Larcher se montre peu curieux sur ce point. Lorsqu’il l’interroge en revanche sur l’action de guerre avortée du 30 juin, Stabenrath répond que des « forces spéciales » se sont bien rendues à Nyungwe et Butare, mais qu’il ignorait et ignore toujours les ordres que ces hommes avaient reçus, alors qu’il était en charge du secteur (« C’est ça, les vraies questions ! »).
Les « vraies questions »
Les « vraies questions » sont celles par lesquelles le militaire renvoie à son supérieur, et derrière lui aux autorités politiques. La vraie question de Stabenrath concerne ici le créateur des Forces spéciales, l’amiral Lanxade, alors chef d’état-major des armées, longuement interrogé par Larcher. Tout en se répandant en déplorations sur l’Afrique et les massacres (« c’est l’Afrique, ça. Toute l’Afrique est comme ça, à cette époque », mais « il y a un pays qui est stable »), Lanxade, qui aime à parler des « forces tutsies » comme d’« infiltrés », botte en touche dès que la question suppose un jugement moral : « les choses ne se présentent pas comme ça », répète-t-il à propos de la « cause » juste ou injuste du FPR. Quant à Turquoise, qui aurait été « une très, très belle opération humanitaire », elle avait pour mission d’« arrêter les massacres, point à la ligne ! ». « Mais pas les massacreurs », ajoute Larcher. Ce à quoi l’amiral répond, droit dans ses bottes : « Et… et… et je dirais sciemment. Sciemment, parce que nous n’avions pas de mandat pour le faire ».

Kigali (avril 2019) © Catherine Coquio
Lanxade vient pourtant de reconnaître que ce mandat qui enchaînait l’armée française avait été dicté par la France – oui, certes, mais pas par lui, Lanxade ! Quand Larcher le questionne sur le général Varret, chef de la coopération militaire au Rwanda, qui, après avoir alerté les autorités du risque de génocide et dit son désaccord sur l’aide apportée au régime, fut remplacé par le général Huchon, proche de Quesnot et de Lanxade, ce dernier, cette fois, assume : « la Coopération se voulait un État dans l’État, comme la DGSE d’ailleurs ! Créer les Forces spéciales, c’était limiter les prérogatives de la DGSE. Il fallait bien régler ces problèmes ». Interrogé enfin sur la « raison d’État » parfois nuisible aux intérêts de la France, l’amiral renvoie à la « responsabilité » des présidents, et prend congé après s’être dit « très tranquille ». Larcher, lui, se dit « vidé ». Lanxade est pour lui un mystère : « Comment peut-on s’aveugler, se mentir à ce point ? Mais ment-il ? Peut-être pas. Ses yeux ont regardé, regardent encore… mais ils n’ont pas vu, ne voient toujours pas ». « Ils ont des yeux et ne voient pas » : Jérémie, 5, 21. On reconnaît là l’optimisme chrétien de Laurent Larcher, qui donne opportunément la version bambara du proverbe, entendue au Mali : « Ces étrangers ont des yeux, mais ils ne voient pas ».
Déguisé en chaleureux dialogueur et en interprète empathique, Larcher mène un minutieux travail de harcèlement sur le double plan de la logique et des faits. Il fait comprendre de quoi se nourrit la colère ou l’amertume du militaire piégé (Guillaume Ancel), du haut fonctionnaire évincé (Jean Varret), du journaliste-chercheur effondré (Patrick de Saint-Exupéry, Gérard Prunier), de l’humanitaire manipulé (Bernard Kouchner, Alain Boinet). Il montre le passage de l’assise perverse à la débandade chez des acteurs majeurs qui, poussés dans leurs retranchements, reculent piteusement devant l’évidence et esquivent. En les entendant, on découvre sous l’arrogance assise un potentiel de crétinerie insolite, auquel s’ajoute parfois une vulgarité débonnaire : sidérale chez le Père blanc, dont les « souvenirs hallucinants » sont une glissade ricanante dans le rien ou l’abject (« ils sont vraiment cons, ils savent pas faire l’économie des cartouches, hein ? ») ; plus soft chez Védrine ou Rufin, en cyniques pressés ou rigolos désinvoltes.
Les rires sont d’ailleurs des chiffres, sinon des clés. Leur surgissement est toujours significatif, mais doté d’un sens différent : le rire de l’aviateur amer qui rit d’avoir participé à des infamies pour « éviter d’en être broyé » ; le rire de Gérard Prunier évoquant les réactions de ses copains après sa rupture avec le Parti socialiste au sortir d’un échange avec le « Monsieur Afrique de l’Élysée » (« c’est ta province, c’est ton dossier, machin… mais tu crois pas que t’es un peu en train d’exagérer ? (Rires) ») ; le rire du Père blanc, à propos d’un jésuite belge qui avait entrepris de « parler » : « paf ! Il est mort ! (Rires) Pas de pot ! » ; les rires coincés ou nerveux d’Alain Juppé s’excusant d’un lapsus ou d’un calcul macabre ; les gloussements d’Hubert Védrine évoquant la « saison Ancel » ou « les chercheurs dans leurs p’tits bureaux » ; le rire jaune de Bradol commentant la satisfaction du précédent : « Il trouve que ça a bien marché, son plan ! C’est… Mais… mais les bras vous en tombent quoi… il fait vraiment penser au chirurgien qui dit : l’opération a réussi mais le malade est mort (Rires) ».
Interrogé à son tour, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Balladur, martèle la même chose que Lanxade : « nous n’avions pas de mission de police » ; mais, si pour l’évacuation sélective lors d’Amaryllis il peut dire qu’il n’était pas là, il lui est plus difficile de ne pas dire qu’il a rédigé le texte de Turquoise : « Oui, c’est nous qui avons décidé de la mission, dans le cadre des instructions de Balladur ». Son objectif, dit-il, était « simplement de protéger les populations. Rien d’autre. Et pas d’aller arrêter les génocidaires ou nous interposer entre les combattants ». Mais, réplique Larcher, « protéger les populations qui sont massacrées, c’est forcément s’en prendre à ceux qui les massacrent ». « Non, répond Juppé, cela consiste à faire en sorte qu’ils ne soient plus massacrés. […] Je regrette ». Et plus loin : « On a condamné le génocide. Donc on n’est pas neutres, par définition. Mais sur la vie des hommes, qu’ils soient hutu ou tutsi, on est neutres, bien sûr. On n’est pas neutres, c’est-à-dire qu’on les protège simultanément. À égalité. Bien sûr. » Et quand Larcher tente de traîner Juppé dans les contrées de l’éthique, l’échange devient moliéresque. « – [Juppé] Ce n’était pas notre mission. – [Larcher] Mais est-ce que ce n’était pas notre devoir ? – [Silence] Oui.. Euh.. peut-être. Mais euh… en politique, le devoir et la mission ne coïncident pas toujours. – Est-ce que ce n’était pas notre honneur ? – Pardon ? – Est-ce que ce n’est pas l’honneur d’un soldat d’empêcher un tueur… – Non. – … de tuer une femme et un enfant ? Quand il a la force avec lui. – Je n’ai pas d’autre réponse à vous faire que celle que je vous ai faite : la France n’était pas là à ce moment-là pour mener une opération de guerre contre… euh… euh… euh… les uns ou les autres ».
Qui dit comique dit chute, assurée ici par un lapsus à propos des populations hutues menacées : « Il ne s’agit pas de replacer ces événements à égalité avec le génocide, ne me faites pas dire ce que j’ai dit ». Mais le plus savoureux est de voir Juppé, interrogé sur le récit d’Ancel au sujet du bombardement programmé le 30 juin et annulé, déplorer que celui-ci ait obéi aux ordres : « il y a des moments où il faut désobéir aux ordres. Quand on parle de morale aussi, hein ! » Juppé dans le texte : les militaires qui ne savent pas désobéir aux ordres n’ont pas de leçon de morale à donner aux politiques.
Sur la morale, Hubert Védrine est plus clair : « Le réalisme pur et dur, c’est un débat qui est tout à fait légitime, qui n’a quasiment jamais lieu ». Plus « tranquille » que Juppé, il est d’une autre violence, plus urbaine et désinvolte, d’un foutoir glaçant qui au moindre embarras tourne à la girouette à moteur. Il dit qu’en 1990 il n’y connaissait rien et confondait les noms (« c’était pas mon truc »). Selon lui, le secrétaire général de la présidence qu’il était de mai 1991 à mai 1995 ne décide de rien même s’il « pèse sur des tas de trucs ». Mais le Secrétaire défend la ligne de Son Président, à sa manière et dans son style à lui. Quand on lui parle de livraisons d’armes en plein génocide, Védrine reconnaît, mais dit que les commandes avaient été faites plus tôt. Quand on déplore les soldats français présents aux barrages où les miliciens massacraient, il dit que les soldats sont de « braves mecs » qui évaluent sur le terrain, et demande qui était l’exécutif à l’époque (il s’embrouille souvent dans les dates). Quand on lui rappelle qui a tué qui, il « trouve ça un peu artificiel », dit qu’« il y a des trucs dans les deux sens » et recommande de lire Judi Rever, la championne canadienne de la thèse du « double génocide ». Quand on lui demande pourquoi persister à former des gens qui annonçaient une extermination, il répond : « Il faut les tenir ! La seule façon de les tenir, c’est de les financer, de les former, et caetera ». Quand on lui rappelle sa proposition de couper le Rwanda entre un « Hutuland » et un « Tutsiland » (formulée dans Le Point en 1996), il dit qu’il ne voit pas « ce que ça a d’atroce », que c’est comme les Israéliens et les Palestiniens, qu’il a « toujours été branché Proche-Orient, énormément » ; et qu’en plus à l’époque les Africains lui disaient en avoir « marre des frontières de la colonisation », que « c’est bourré d’ethnies coupées en deux, et puis y a des minorités qui sont maltraitées, bla-bla-bla-bla-bla… Donc ça m’est venu avec légèreté en fait ». Le propos de Védrine, en fait, c’est l’insoutenable légèreté de la raison politique, le « raisonnement de médecin de campagne » qu’il oppose aux inutiles « déconstructions » des chercheurs pour lesquels il éprouve un mépris haineux. Quand on lui suggère qu’il était légitime que les Tutsi exclus de leur pays veuillent y revenir, il s’exclame qu’il ignore « qui a le pouvoir de décréter ce qui est légitime ou pas ». Enfin, quand on interroge la position de Mitterrand, il dit que, homme des années 1930, celui-ci ne pouvait pas laisser un pays en déstabiliser un autre, « minorité armée, tous ces trucs… ».

Le Jardin de la mémoire, à Kigali (avril 2019) © Catherine Coquio
Mitterrand, le grand absent du livre, plane sur l’ensemble des entretiens : chaque renvoi à l’échelle supérieure le désigne implicitement ou explicitement comme l’ultime responsable : celui qui décide. Mais, au-delà du « scandale de la décision politique » et de l’identification des hiérarchies responsables, ces entretiens font explorer l’imaginaire partagé par tous ces acteurs en position de trancher. Ce que Bernard Kouchner, en un moment d’énervement lucide, appelle la « pensée gaullo-impériale » toujours en vigueur au Quai d’Orsay, faite d’un mélange de « conformisme incroyable », d’arrogance et d’incompétence, d’anti-américanisme primaire – à quoi s’ajoute, pour Mitterrand, « un signe de piste d’extrême droite » hérité de Vichy. Évoquant les érudits et énarques du Quai d’Orsay qui lui en ont fait « baver », Kouchner résume le problème avec trois formules différentes : « ce sont des enfants à qui on a donné un pouvoir » ; « ils ont tous un retard de trente ans, quarante ans » ; « il n’y a pas d’humanité ». Quant à Larcher, il résume ainsi les choses : « Je suis fasciné par l’aveuglement et l’arrogance de nos autorités dans cette tragédie. Après avoir écouté toutes ces voix, la France au Rwanda, pour moi, c’est une poignée d’hommes – militaires et politiques – qui ont en partage un sentiment de toute-puissance et une incapacité à douter ». La plupart ignorent tout de l’histoire complexe de l’Afrique, et sont « intervenus comme des apprentis sorciers ».
Parler aux vivants et aux morts et se voir demain
Lorsque je suis partie pour Kigali en avril, invitée à parler de la résilience et bien embarrassée à l’idée de traiter d’un tel thème, je venais de relire les deux volumes de témoignages recueillis par Florence Prudhomme [11]. Là, dans ces tout autres « témoignages pour l’histoire », un immense crédit a été fait à la parole humaine, mais une parole tout autre elle aussi : celle partagée au fil du temps au sein d’un groupe de femmes dans une « Maison de quartier » de Kigali. Ici, pas d’interviewer ni d’interviewé, mais des conversations poursuivies sur plusieurs mois ou années, qui, à l’aide de tiers devenus proches – Florence Prudhomme, Marie-Odile Godard, Naasson Munyandamutsa, Michelle Muller et Émilienne Mukansoro –, ont créé les conditions propres à faire émerger des récits de vie. À la fin de chacun, les survivants parlent à leurs morts, et ce fil des liens familiaux n’a pu se reconstituer qu’à travers ceux qui se sont tissés entre les vivants. Ces « cahiers » ont été conçus comme l’envers des veillées publiques, où, selon Florence Prudhomme, les témoins s’adressent à une foule sidérée et s’enferment dans la « spirale persécutrice du trauma », ne libérant rien ni personne. Émilienne Mukansoro écrit en préface : « Quand tu es devenu un serpent, un cafard, à la porte de la mort, quand on t’a coupé la langue en coupant la nuque de ton enfant, la main de ton fils, le ventre de ta fille, tu ne fais plus confiance aux mots, tu les crains. Or les craindre, c’est craindre l’humain qui habite dans les mots. […] Reprendre la parole aux tueurs c’est ne plus être leur proie. […] Reprendre la parole c’est se voir demain. […] Les auteur-es des Cahiers de mémoire ne se situent pas dans un face à face où ils seraient en place d’accusateur ne recevant en réponse qu’un mécanisme de défense de l’accusé. Ils/elles n’accusent personne, ils disent le malheur qu’ils ont connu ».
Ces récits cathartiques ne cessent de produire la « sensation d’incrédulité » dont parlait Friedländer. En faire des témoignages pour l’histoire, cela suppose que l’histoire soit « remise à l’endroit », négation à la traîne et non plus en tête, et qu’elle mène une autre politique du détail que celle qui accuse ou défend. Il est bon en tout cas de revenir aux Maisons de quartier de Kigali après avoir entrevu les cabinets ministériels et les cafés parisiens dans lesquels nous a emmenés Larcher, acharné à extraire du sens de ces bredouillants totems humains. Ces lieux bruissant d’une parole qui radote, bégayante ou policée, on s’en souvient comme d’un cercle de l’Enfer que Dante aurait oublié. Mais l’oubli, on le sait, est la forme la plus profonde que prend la mémoire. Cette parole aux abois, qui affole sa hantise à coups de déni, déroule toujours son radotage malade au cœur de la République. Si elle cherche si peu la sortie, c’est qu’elle sait qu’elle n’en a plus pour longtemps. Les Rwandais ont repris la parole aux tueurs, ils la reprendront aux Français : pas seulement pour dire leur malheur et désigner les coupables, mais pour reprendre confiance et se voir demain.
-
Le Monde, 12 juin 2019.
-
http://africultures.com/je-nai-eu-que-vingt-ans-pour-guerir-des-blessures-12204/
-
Retour à Kigali, documentaire, France, 2019, 75 mn, Les Films du Poisson / France Télévisions / Public Sénat.
-
http://www.fondationshoah.org/memoire/retour-kigali-de-jean-christophe-klotz
-
« Ce pays pourrait devenir une leçon pour l’humanité », texte repris dans Cahiers de mémoire, Kigali, 2014, sous la direction de Florence Prudhomme, Classiques Garnier, 2014.
-
Rwanda. Un génocide en héritage (2019).
-
À mots couverts (2014).
-
Voir Maria Malagardis, Sur la piste des tueurs rwandais, Flammarion, 2012. Sur les plaintes, voir le site du CPCR.
-
https://unbound.com/books/the-triumph-of-evil/
-
Association internationale de recherches sur le crime contre l’humanité et les génocides, créée en 1997 par Irving Wolfarth et moi-même, et que j’ai présidée dix ans. Les archives de ses activités, qui se sont déroulées entre 1997 et 2008, ont été déposées en mai 2018 à la BDIC, à Nanterre.
-
Florence Prud’homme (dir.), Cahiers de mémoire, Kigali, 2014, et Cahiers de mémoire, Kigali, 2019, Classiques Garnier, coll. « Littérature Histoire Politique », 2014 et 2019.