Mais que veut le critique (comme Freud demandait sur son lit de mort, dit-on : Was will das Weib) ? Et en quoi consiste au juste la critique ? Quelle est cette impulsion qui nous fait donner notre avis à tort et à travers, qui nous fait souhaiter que les œuvres soient un peu plus courtes, un peu plus longues, écrites ou filmées autrement, avec une fin plus heureuse ou plus morale, etc. ?
Florian Pennanech, Poétique de la critique littéraire. Seuil, coll. « Poétique », 620 p., 34 €
Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual, Esthétique de la rencontre. Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 168 p., 18 €
Quel est ce mystérieux café du commerce où chacun ferait mieux s’il était calife à la place du calife, où chacun s’arroge le droit de juger autrui tout en lui déniant généralement ce même droit (il suffit de voir la haine des lecteurs de presse contre la critique journalistique et leur amour simultané des « avis » Google) ? À un autre niveau, loin du jugement de goût, on peut se demander ce qui pousse l’universitaire amateur d’art ou de littérature à mettre en coupes réglées l’objet de son amour : serait-ce pour mieux le partager avec les autres – tel le melon dont Bernardin de Saint-Pierre nous enseigne que la Nature l’a créé en tranches pour qu’il soit mangé en famille –, ou bien par un instinct sadique dont les anticritiques ont bien raison de se méfier (« la critique est aisée… ») ?
Deux brillants essais répondent indirectement à ces questions que, par ailleurs, ils ne posent pas et qu’ils débordent largement. Le premier, Poétique de la critique littéraire, est un ouvrage qui suit la méthode genetienne : typologie et granum salis. Il est dû à Florian Pennanech dont on avait fort apprécié les Exercices de théorie littéraire coécrits avec Sophie Rabau (Presses de la Sorbonne nouvelle, 2016), dans lesquels les deux auteurs proposaient au lecteur-étudiant de forger ses propres concepts d’analyse littéraire. En autopsiant les modalités de construction de ceux-ci, ils montraient sinon l’arbitraire du moins le « jeu » ou le relativisme de toute théorie. Ici, il s’agit d’étudier le fonctionnement des différents types de discours de la critique littéraire, d’Aristote à Georges Poulet ou Jean-Pierre Richard en passant par Pierre Louÿs quand ce dernier propose de réattribuer certaines pièces de Molière à Corneille. Le second ouvrage, paru en octobre 2018, est un essai d’esthétique qui met les pieds dans le plat et part d’une expérience commune à la plupart des amateurs d’art contemporain : le fait d’être trop souvent resté de marbre – pas même irrité – devant des œuvres ou des dispositifs qui avaient réussi, c’est l’hypothèse des auteurs, à se rendre « indisponibles », neutralisant au passage la pulsion critique.
C’est précisément parce que les deux livres partent chacun d’un bout opposé de l’expérience esthétique qu’il peut être intéressant de les nouer, quand bien même ils s’appliquent à des champs différents et même s’il n’existe pas pour l’art contemporain de méthodes d’analyse (« close reading », en anglais) semblables à la critique telle que la décrit Pennanech. C’est que l’art non narratif échappe à la catégorie dite du « texte », qu’on peut appliquer à la littérature comme à la musique ou au cinéma : on sait ce que Christian Metz, pour ce dernier domaine, doit à Genette.
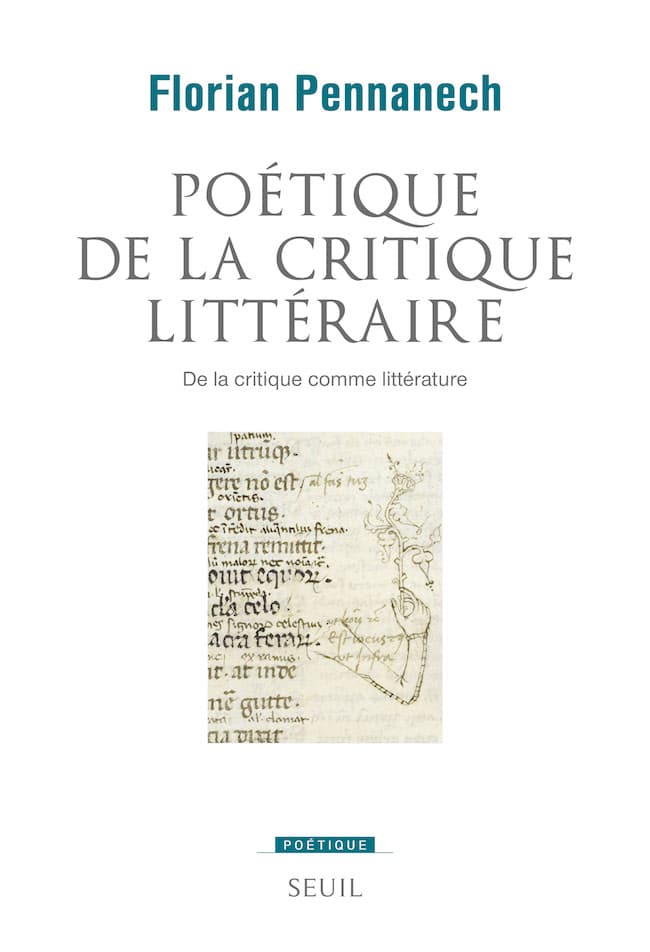
La démarche de Pennanech est motivée par un scandale assez simple : « La critique, au moins de nos jours, prétend s’attacher à la particularité de son objet, or la poétique de la critique va montrer comment le discours critique s’élabore toujours à partir des mêmes opérations générales. La critique se veut individualisante, or sa poétique sera généralisante, sinon universalisante. » Voilà de quoi déprimer tout prof de khâgne en train de plancher sur Rabelais ou Lucien. Voilà peut-être aussi de quoi percer le secret des textes d’art contemporain interchangeables qui ne font ni chaud ni froid aux narrateurs d’Esthétique de la rencontre, puisque, au lieu de particulariser une œuvre ou une relation, cartels et textes critiques ressassent la vulgate théorique du moment, rendant indiscernable tel artiste de tel autre. On notera à ce sujet que, sous le terme de « critique », Pennanech n’englobe pas les études culturelles et s’en tient à un corpus de type herméneutique. Sans doute parce qu’il règle le compte des studies dès le premier chapitre en les classant sous l’intitulé « prédication ». « On peut, si l’on veut, opéraliser n’importe quel prédicat, comme on le voit avec le développement des études culturelles, dont une part est consacrée à commenter des textes littéraires, sous l’appellation « X Studies », où X peut désigner n’importe quelle caractéristique. On peut de fait transformer n’importe quel prédicat en catégorie permettant de classer les textes ». « Opéraliser » signifiant ici transformer en « propriété spirituelle et abstraite ». Cette tendance à raconter n’importe quoi sur une œuvre n’est pas tout à fait un défaut cependant, on va le découvrir au fil de l’essai. C’est plutôt une malédiction inévitable. Barthes nous l’avait déjà appris dans le célèbre « Qu’est-ce que la critique ? » de 1963 : la critique ne peut qu’« ajuster […] le langage que lui fournit son époque (existentialisme, marxisme, psychanalyse) au langage, c’est-à-dire au système formel de contraintes logiques, élaboré par l’auteur selon sa propre époque ». D’où l’on inférerait volontiers qu’il existe deux types de mauvaise critique : la critique imbécile, qui croit dire la vérité sur l’œuvre, et la critique ratée, qui échoue à fournir, sinon les, du moins des conditions d’intelligibilité hic et nunc d’une création. (Et où l’on voit que le X de X studies vaut pour « existentialisme, marxisme, psychanalyse ».)
Pennanech va cependant beaucoup plus loin que Barthes dans cette voie, jusqu’à déraciner avec Richard Rorty la logique et l’unité du texte, sa « cohérence interne », qui n’est due qu’à la lecture critique, de même, écrit Rorty, « qu’un morceau d’argile a pour toute cohérence celle qu’il lui a été donné d’acquérir en passant par le tour du potier ». Mais attention, une fois le voile de l’unité ôté, il ne faut pas croire, précise Pennanech, que l’on atteigne la Chose dans son état pur : « il faut donc considérer que tout ce qu’on dit d’un texte relève d’une construction artificielle, qu’aucun prédicat quel qu’il soit ne peut être réputé allant de soi ». Cette règle de bienséance à l’égard de la création ouvre une autre voie : c’est qu’il n’existe pas d’appréhension des œuvres sans critique, contrairement à ce que prétend l’idéologie néolibérale anticritique. Elle explique aussi cette phrase que nous glissait jadis un ami écrivain : « On n’est jamais lu comme on voudrait ». Et elle permet d’ajouter : c’est d’ailleurs tant mieux.
La prédication, bien sûr, est un terme vague décrivant le moteur même de la critique. Les cinq autres grandes parties de l’essai de Pennanech proposent de la décomposer en opérations métatextuelles plus précises : référentiation, aspectualisation, substitution et combinaison. On ne va pas résumer chacune ici. On se contentera de saluer la sagacité de l’auteur et son humour, qui passe à la moulinette typologique aussi bien la famille structuraliste que Houdar de La Motte, Jules Lemaître ou l’extraordinaire Mark Akenside (1721-1770), auteur d’une notation des poètes qui n’a rien à envier à Allociné : il y attribue un 18 en « bonheur d’expression » à Homère et Shakespeare (Le Tasse n’a que 13) et gratifie Lucrèce d’un zéro pointé en « morale ». Pennanech n’est pas avare en exemples absurdes de ce type, propres à susciter le fou rire : comme Pierre Bayard ou Antoine Compagnon dans Le Démon de la théorie, il aime soumettre la critique à des crash tests rigoureux. Poétique de la critique littéraire n’est ainsi pas seulement une sorte de magistral Figures VI, c’est aussi le récit des multiples expressions de la folie critique, totalitaire et autotélique : on y voit comment les commentateurs ne reculent devant rien pour réduire textes et corpus à leur lit de Procuste. Soit qu’ils en coupent des morceaux, en ajoutent, en déplacent, soit qu’ils réécrivent carrément tout. Ils sont obsédés par la cohérence et l’unité, supposent qu’un auteur se répète nécessairement, mais ces principes ne sont pas appliqués toujours uniment car personne ne s’est encore avisé, note plaisamment Pennanech, qu’il y a quand même beaucoup trop de passages non zoliens chez Zola pour être honnêtes. Pour donner une idée du travail de déconstruction entrepris ici, on pourrait prendre l’exemple très simple des sacro-saints champs lexicaux et de l’isotopie. Plutôt que de décrire celle-ci comme « un ensemble de redondances donnant au texte sa cohérence », l’auteur propose plus raisonnablement de parler d’« isotopisation, c’est-à-dire d’opérations qui construisent des ressemblances entre des éléments (assimilation), permettant de construire des récurrences (itérativisation) et aboutissant à fabriquer une cohérence (cohésion) ».
Que veut donc la critique ? Peut-être est-elle issue « du croisement de la pulsion assimilatrice et de la restriction de notre univers », avance Pennanech. En cela, a-t-on envie d’ajouter méchamment, elle est indubitablement une science. Cela dit, si l’on franchit le vieux gué de la réception à la production, on fera aisément remarquer que la plupart des auteurs étant eux-mêmes des critiques de leur propre travail, il n’est peut-être pas si extravagant que ça de trouver des isotopies chez des écrivains qui ont construit leurs textes en partant d’un commentaire composé inconscient… Raison pour laquelle les cartels d’art contemporain ont également raison de tous répéter les mêmes clichés : les artistes eux-mêmes, soumis à la dictature des curateurs, s’astreignent à illustrer le « langage de l’époque » (relationnel, gender, etc.) de peur de ne pas trouver preneur.
C’est là qu’intervient efficacement Esthétique de la rencontre de Morizot et Zheng Mengual. En lisant Pennanech, on se dit que le critique est finalement un amoureux jaloux de la littérature. Une sorte d’Arnolphe secrétant son Agnès sans voir qu’elle lui échappe. Or il paraît que la relation amoureuse consiste à être changé par l’autre (plutôt qu’à l’emprisonner dans le désir). Là non plus, on ne reviendra pas sur l’intégralité de l’essai de Morizot et Zheng Mengual. Qu’il suffise de savoir que la première partie est salutaire : les chercheurs analysent cette « t.a.c. » (« tentation de l’art contemporain ») qui consiste à se refuser au visiteur d’exposition, de peur, supposent-ils, d’être digéré. Et de reformuler l’articulation historique moderne/contemporain à la lumière de cette hypothèse. Or l’indisponibilité de certaines œuvres n’est plus ici une « chance » comme celle qu’offraient les avant-gardes : c’est un simple « obstacle » improductif ; et la circulation du sens se réduit aux « seuls effets de complicité et de reconnaissance entre professionnels du monde de l’art ». Exemples : un tas de gravats dont le cartel indique qu’il fait allusion à la « nature intrinsèquement entropique de notre civilisation », ou tel accrochage de vêtements d’artiste supposés ouvrir des fictions et dont le curateur fournit pour commentaire : « C’est le blouson qu’elle portait tout le temps dans les années 80 ». Soit un bon vieil effet d’intimidation intellectuelle. Si l’art contemporain a sans doute de bonnes raisons de se rendre indigeste, la façon dont il le fait parfois est, en revanche, peu pertinente, jugent Morizot et Zheng Mengual, puisque cela conduit à des « non-rencontres » ou pire à de « fausses rencontres » avec l’œuvre ou le dispositif. Or, même si l’on peut relativiser ou discuter l’existence de ce qu’on nomme traditionnellement l’expérience esthétique, force est de constater que notre idée de l’art vient de ce qu’un jour, « lentement, presque derrière notre dos », une « œuvre a transformé un pan de nos manières de sentir, de percevoir, de concevoir, d’agir. Nous en sommes devenus un corps plus intelligent et plus sensible ».

Les auteurs ne le précisent pas, mais le fait que, la plupart du temps, une œuvre ne nous fasse rien ou que les conditions socioéconomiques privent la plupart des gens de cette expérience ne devrait pas nous faire conclure qu’elle est une simple illusion de bourgeois hégémonique. D’ailleurs, ils proposent précisément de penser la rencontre entre un sujet et une œuvre comme individuante plutôt que sous l’aspect d’une détermination : « les êtres qui se rencontrent sont déjà en partie individués mais ce n’est qu’à l’égard de ce qui n’est pas individué en eux, de ce qui est non résolu, qu’il y a à proprement parler rencontre ». C’est là qu’on retrouve le potier de Rorty et qu’on lui fait la peau avec James J. Gibson, en introduisant la notion d’« invite », qui, contrairement à la « valence », ne change pas en fonction des besoins de l’observateur : une œuvre contient des invites et c’est à elles que l’amateur d’art répond. On aura compris que dans la « t.a.c. », il n’y a plus d’invite : l’œuvre s’est rendue indisponible à la rencontre. Morizot et Zheng Mengual supposent ici que ce que l’individu, ayant en lui « une part d’irrésolu », « rencontre, ce n’est pas toute l’œuvre, ou l’œuvre en général » mais « une singularité en elle : une saillance » qui ne préexiste pas à la rencontre mais s’active par elle. « Une singularité dans une œuvre n’est pas néanmoins un trait qui n’existerait que pour ce spectateur, en tant que ce trait n’existerait que dans sa conscience (subjectif) ; mais il n’est pas non plus un trait physique déterminé de l’œuvre (objectif). » Une singularité est ainsi « observable par tous » mais elle ne fait saillance que pour certains et peut se manifester pareillement chez différentes personnes. Elle est « relationnelle » : « c’est parce qu’il y a rencontre qu’une invite de l’œuvre va être instituée comme saillance […]. La singularité existe rétrospectivement à la rencontre ».
Cette séduisante hypothèse pourrait donc contredire celle de la construction artificielle du prédicat chez Pennanech : c’est parce que la singularité ne préexiste pas à la rencontre qu’elle semble, à tort, inventée. Quant à la critique, elle trouverait d’elle-même sa justification : critiquer, c’est se mettre en état de relater la rencontre individuante, de la même façon qu’on raconte une rencontre amoureuse – avec le même empressement actualisateur. Laquelle rencontre, quand elle est esthétique, ne devrait pas être égoïste puisque, les singularités étant semblablement activables par plusieurs personnes (mais non par tous), l’œuvre d’art « est un catalyseur de collectif : un objet capable de faire communiquer la part d’irrésolu de toute une série d’individus, spectateurs comme artistes, et capable d’individuer de manière commune cette part d’irrésolu ». C’est à ce point qu’on peut poser une question essentielle (là encore, on simplifie, pour l’exposé, la pensée des deux auteurs) : d’où sortent les invites et les singularités qui sont en puissance dans l’œuvre ? Car ce n’est pas tout de supposer qu’elles existent et ne sont pas une hallucination du critique/lecteur/amateur d’art, encore faut-il savoir en quoi et pour quoi elles pourraient être activables dans une rencontre… « Ce que nous fait voir l’esthétique de la rencontre, ajoutent Morizot et Zhong Mengual, c’est que le phénomène de réception individuante d’une œuvre peut être pensé comme l’effet retardé d’une première expérience individuante que serait la création de l’œuvre pour l’artiste », où celle-ci aurait « émergé comme résolution de problèmes ayant reconfiguré son système de lui et du monde ». En quelque sorte, ces invites constitueraient une nécessité : c’est parce qu’un être humain, avant moi, s’est enrichi de résolutions de l’épineux problème de l’existence (non seulement Was will das Weib ? mais Qu’est-ce qu’on fout là ?) que ces traces qu’il a laissées sous forme d’invites dans le processus même de la création sont réactivables (et utilisables) par moi. Cette théorie permet évidemment de comprendre pourquoi tous les critiques sont des artistes ratés : c’est que l’activation d’une œuvre par le spectateur ou le lecteur n’est rien d’autre qu’une réactivation (reenactment) du processus de sa création. En quoi l’on revient par un autre chemin à la conclusion de Pennanech : la « littérature elle-même » (ou l’art lui-même, etc.) à quoi rêvent certains « n’est pour nous que la littérature moins la critique », c’est-à-dire un simple refus d’œuvrer.












