Pour la Toussaint, deux importants ouvrages viennent fleurir les tombes de nos défunts cet automne. Ils ne sont pas pour autant des livres de circonstance, mais forment comme un diptyque aussi étonnant qu’érudit ; l’un porte sur l’histoire de ce que la mort laisse après elle, c’est-à-dire le corps mort, tandis que l’autre s’intéresse à la mort imparfaite, celle qui n’a pas achevé son travail, laissant l’individu dans un entre-deux.
Thomas W. Laqueur, Le travail des morts. Une histoire culturelle des dépouilles mortelles. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Hélène Borraz. Gallimard, 928 p., 35 €
Anton Serdeczny, Du tabac pour le mort. Une histoire de la réanimation. Préface de Jean-Claude Schmitt. Champ Vallon, 400 p., 25 €
Le premier ouvrage est une énorme somme traduite de l’américain que l’on doit à Thomas W. Laqueur, grande figure de l’histoire culturelle, connu pour deux ouvrages qui firent date en matière d’histoire de la sexualité : La fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident (1992), puis Le sexe en solitaire. Contribution à l’histoire culturelle de la sexualité (2005), qui rend compte de l’enquête qu’il n’a cessé de mener depuis 1983. Le second ouvrage est l’impressionnant fruit d’une thèse de doctorat soutenue en 2014 qui prend l’angle de l’anthropologie historique et la méthode d’une micro-histoire appliquée au discours scientifique pour écrire l’histoire de la réanimation au XVIIe et au XVIIIe siècle. Si son auteur, Anton Serdeczny, cite Laqueur comme un des initiateurs d’une histoire de la médecine, qui n’hésita pas à convoquer « un facteur extérieur venant entrer en résonance, alimenter et en fin de compte constituer un pan de la médecine du XVIIIe siècle, par un processus qui échappait aux savants qui en étaient les acteurs », Du tabac pour le mort développe une approche très différente, et sans doute plus originale que celle de Laqueur pour son enquête sur les dépouilles.

Pour Anton Serdeczny, le point de départ est une sidération, le constat d’une distance culturelle colossale entre les années 1740 et aujourd’hui : tout commence en effet sur la rive d’un cours d’eau d’Europe occidentale d’où l’on vient d’extraire un noyé à qui, pour le réanimer, on introduit dans les intestins de la fumée de tabac ; c’est de cette pratique de faire « souffler du tabac » que l’historien s’attache à rendre compte en cherchant à retrouver sa cohérence et son sens, à quelque niveau qu’ils se trouvent. Aussi, suivant l’invitation de Dominique Pestre, Serdeczny réintègre l’histoire des sciences dans l’ensemble des questionnements historiques, « sans exception » et sans hiérarchie de sources. Son enquête, faisant une large place à l’anthropologie historique en déroulant le corpus des nombreux traités médicaux, parvient sur un terrain surprenant mais très éclairant, celui des pratiques populaires carnavalesques, chères à Mikhaïl Bakhtine. L’historien ne quitte jamais son objet et laboure avec une détermination sans faille : il retrace d’abord les débats écrits qui eurent lieu en Europe et dont les revues, comme Le Mercure suisse (Neuchâtel) ou encore De Philosoph (Amsterdam), furent le théâtre. Serdeczny piste les noyés et leurs commentateurs qui cherchent moins à réanimer qu’à définir les signes de la mort. Son objet est en effet l’émergence de ce nouveau discours et son inscription dans l’histoire de son temps. De ce point de vue, l’historien ne néglige aucune forme parmi les écrits qui peuvent lui servir d’indices. Il traque les gestes : en 1757, la peau de mouton fraîchement écorchée que l’on place sur le corps d’André Delaporte, réanimé à Passy après qu’ « un médecin lui fit souffler “une grande quantité de fumée de tabac dans l’anus, dans la bouche, dans les narines“ » ; ou la plus contestée « urine chaude à faire boire au noyé ».
Apparaît progressivement l’importance du protestantisme, non à travers le triomphe de sa modernité, mais comme « rééquilibrage des enjeux entourant la mort et le miracle ». Mais la clé d’intelligibilité de l’objet mort-à-réanimer que les savants avaient construit relève en réalité de l’oralité. L’auteur consacre ainsi de beaux développements aux contes populaires remontant au XIe siècle et aux figures ressuscitées grâce à des insufflations alvines. Le carnaval européen est ainsi « l’encrier dans lequel cette plume avait puisé » ; ce jeu rituel renversant les ordres et abolissant les frontières (homme/animal, vie/mort, femme/homme, riche/pauvre…) fut l’élément extérieur qui rendit possible la ré-animation.

Nicolas Poussin, « Les bergers d’Arcadie » (1638-1640)
L’ouvrage de Laqueur qui s’étend, quant à lui, sur une chronologie beaucoup plus longue, de la période médiévale jusqu’au XXIe siècle, propose une minutieuse traversée de la culture des vivants pour les morts : « celle de la façon dont ils nous habitent individuellement et collectivement ; de la manière dont nous nous les imaginons et dont ils donnent du sens à nos vies et structurent l’espace public, la politique et le temps. C’est l’histoire de l’imagination, de notre manière d’investir de sens les morts ». L’historien américain révèle cette imagination majoritairement par des sources anglo-saxonnes (et donc protestantes), livrant une histoire sensiblement différente de celle déjà connue en France, et battant froid les travaux précédents : par exemple, la fin du cimetière paroissial au XVIIIe siècle ne relèverait ni d’une sécularisation de grande ampleur, comme l’a écrit le « marxiste et anticlérical » (sic) Michel Vovelle (disparu le 6 octobre dernier), ni d’une épidémie de peur due aux thèses des médecins des Lumières comme l’avait indiqué Philippe Ariès — dont les travaux sont en outre jugés par Laqueur comme marqués par les croyances de son auteur, « un très conservateur et fervent catholique ».
C’est donc une relecture totale que propose Laqueur, en s’enfonçant dans l’énorme masse de sources en tout genre (registres, archives mais surtout œuvres d’art, photographies, monuments), à commencer dans l’introduction par l’auto-analyse de son propre travail des morts (de la tombe de son grand-père à Hambourg aux cendres de ses parents en Virginie). L’ouvrage se lit ainsi comme une remarquable encyclopédie de la culture funéraire, faite d’études de cas : ici, l’étude des deux versions du tableau de Poussin (1629/1637 ou 1638) Bergers d’Arcadie, annonçant par les récits qu’elles suscitèrent une modification de l’imaginaire funéraire ; là, l’analyse de l’affaire jugée devant la Cour consistoriale de Londres en 1820 relative au refus par les marguilliers de l’église St Andrew à Holborn d’accueillir la dépouille d’une certaine Mary Gilbert dans son cercueil de fer dans le cimetière paroissial ; cette affaire, à propos de laquelle le jugement donna raison aux marguilliers, montrait combien de nouvelles pratiques (ralentissant la putréfaction des corps) venaient se heurter à un droit coutumier voulant qu’une dépouille ne pût s’approprier un espace pour toujours. Plus loin, le récit de l’achat par un banquier dénommé John Dean Paul d’un terrain de 54 acres à Kensal Green à l’ouest de Londres pour y fonder le premier cimetière-jardin d’Angleterre.
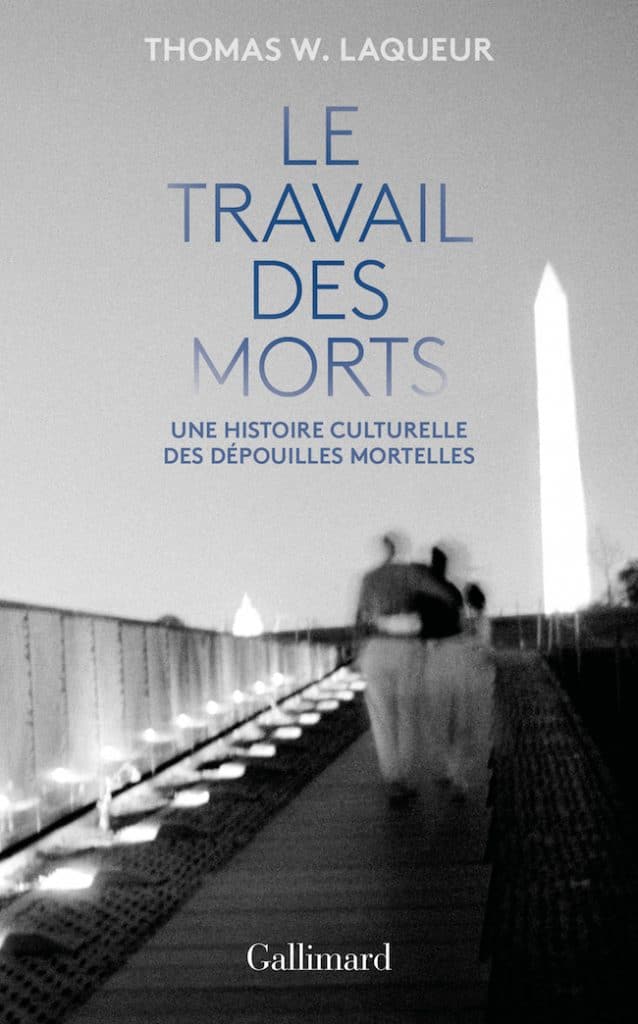
Le plus intéressant est l’ensemble des analyses qui définissent le nouveau cimetière au XIXe siècle, un espace géré en Angleterre par des sociétés par actions, devenu un véritable paysage avec une nécrobotanique nouvelle, dans lequel les tombes servent les morts dans l’intérêt des nouvelles divinités que sont désormais la mémoire et l’histoire. Autrement dit, « il représentait un nouveau genre d’espace dans lequel de nouveaux idéaux sociaux, politiques, culturels pouvaient revendiquer une place […] pour les classes sociales ». Laqueur montre comment tout un marché tenu par des undertakers (entrepreneurs des pompes funèbres) proposant une multitude de nouveaux produits, initiant une gamme de rituels de plus en plus vaste, tend à définir par défaut l’enterrement du pauvre. Laqueur tamise au plus fin son terrain et son regard se déplace ensuite sur l’ensemble des « dérangements » dont les dépouilles peuvent être l’objet après l’enterrement. Le nouveau rapport à l’histoire et à la mémoire est plus que jamais central ici, selon l’historien ; et Laqueur de reprendre le fameux cas de Thomas Paine, héros des révolutions américaine et française, auteur de deux textes célèbres, Le sens commun et Les droits de l’homme, dont les restes firent l’objet d’une exhumation pour être transférés dans un monument digne de son importance historique. Mais, le mausolée ne voyant jamais le jour, ses restes furent dispersés entre la vieille Europe et les États-Unis, un os ici, une relique là.
L’histoire culturelle que peint Laqueur trouve à nos yeux son aboutissement dans la partie qu’il consacre aux noms des morts et à ce qu’il appelle, pour le XXe siècle, l’ère du nécronominalisme. Reprenant pour cette enquête l’angle de la longue durée et le prisme des guerres et des morts sur le champ de bataille, il rejoint toute une anthropologie de l’écriture qui s’est notamment développée autour des monuments aux morts de la Grande Guerre, notamment à l’initiative d’Annette Becker. Le regard de l’historien se fait ici plus attentif encore au moindre détail, comme dans ces pages consacrées au Mémorial canadien de Vimy, destiné à honorer les noms des hommes tombés dans la Somme, vaste assemblage de noms fait sous l’œil des autorités militaires mais aussi des familles.
Le travail des morts et Du tabac pour le mort tentent l’un et l’autre d’historiciser des pratiques en mobilisant des ensembles de sources de natures très différentes ; sans s’opposer, les deux livres portent des conceptions de l’écriture de l’histoire au total assez éloignées. Pour Laqueur, il s’agit d’une histoire totale — la dernière partie de l’ouvrage porte sur la crémation (mais ne dit rien, et l’on peut s’en étonner, du poids terrible de l’usage qu’en firent les nazis sur les pratiques crématoires de l’après-guerre) — alors que l’anthropologie historique des sciences que propose Anton Serdeczny se veut plus modeste ; gageons que son travail ouvre indéniablement plus de pistes et de questions que la somme de Laqueur qui, bien que d’une formidable richesse, tend à être définitive. Or comme l’écrivait Michel de Certeau : « L’histoire n’est jamais sûre ».












