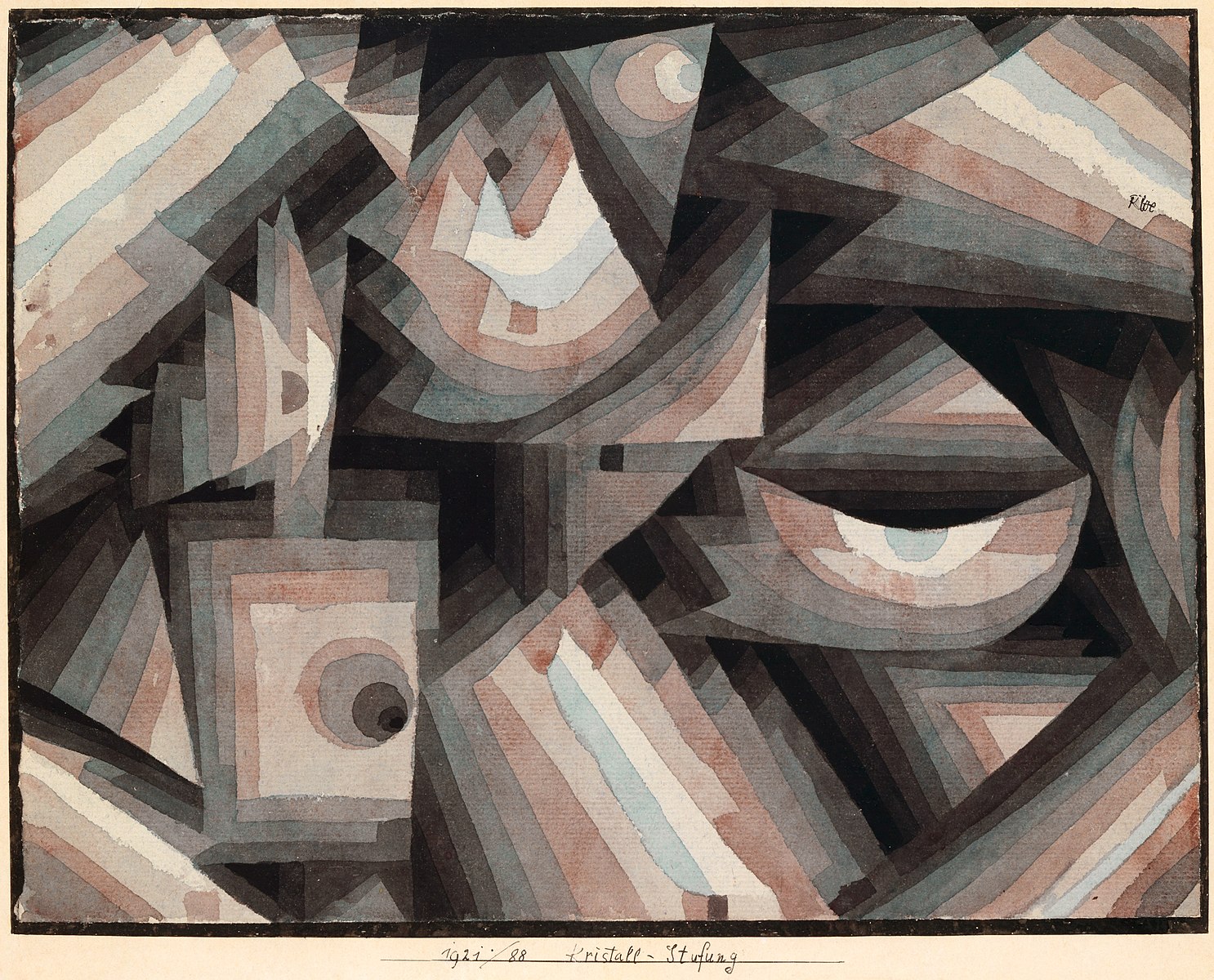Voici un roman qui nous parle de colonisation et de post-colonisation. Il y est beaucoup question d’Afrique, mais pas seulement. Le récit nous rappelle l’inventivité tout terrain de l’espèce humaine, qu’il s’agisse de partir à l’aventure, d’exploiter son prochain ou d’inventer des idéologies absurdes. Gauz nous raconte aussi bien les cérémonies qui rassemblaient rois locaux et colons français en Côte d’Ivoire que le quartier des prostituées d’Amsterdam, les écrits surréalistes de Kim Il Sung ou la fournaise dans une manufacture de Châtellerault.
Gauz, Camarade Papa. Le Nouvel Attila, 254 p., 19 €
L’auteur de Camarade Papa est Armand Patrick Gbaka-Brédé Gauzorro, dit Gauz, né en Côte d’Ivoire en 1971. Parmi d’autres activités, il a fait un film sur Thomas Sankara et dirigé un journal économique à Abidjan. Debout-Payé, son premier roman, publié en 2014, avait pour protagoniste un vigile ivoirien qui portait un regard terriblement juste et drôle sur la société française. Posté à l’entrée de boutiques Camaïeu ou Sephora, il était à l’endroit idéal pour étudier les relations entre Noirs et Blancs, riches et pauvres, Français et immigrés. Sans oublier les touristes chinois et saoudiens des Champs-Élysées.
Dans Camarade Papa, on retrouve l’intérêt de Gauz pour l’observation socio-ethnologique des paroles et des corps. On entend en alternance les voix de deux narrateurs. Maxime Dabilly, jeune Français qui se lance dans l’aventure coloniale des années 1880. Et Anuman Shaoshan Illitch Davidovitch, petit garçon né aux Pays-Bas dans les années 1970 et fils de parents gravement marxistes-léninistes. Il nous explique que « Camarade Papa refuse avec catégorie que je change de classe populaire parce qu’un bon révolutionnaire ne doit pas être coupé du peuple. C’est comme cela qu’on fabrique la bourgeoisie compradore ». Comme ses parents sont exclusivement occupés à préparer la révolution, le jeune garçon est bientôt expédié dans la famille en Côte d’Ivoire. Il faudra attendre la fin du roman pour découvrir le lien entre les deux narrateurs. En attendant, on suit les premiers pas de Dabilly en Afrique. Découverte du trousseau du parfait petit colon (costumes de toile blanche, casques de liège, chaussures de marche et chaussures de repos). Initiation aux codes de la société coloniale et des différentes ethnies du golfe de Guinée. Langues, rituels, cadeaux et tabous. Rencontre avec le roi de Krinjabo et son entourage, « les attitudes sont nobles, les postures gracieuses, pleines d’une morgue commune à toutes les cours royales du monde ».
Avec Dabilly, le lecteur croise Verdier, Louis Anno, le courageux Treich-Laplenne, dont l’Histoire a plus ou moins retenu les noms. D’autres personnages encore, fictionnels mais pas moins vivants, comme le redoutable cuisinier Cébon ou la belle et sage princesse Adjo Blé. Le jeune Dabilly commence à identifier les forces en présence. Négrophobes, pour qui le nègre « ne comprend rien sans coup de pied au cul ». Négrophiles, pour qui c’est un « enfant, il faut l’éduquer avec la justice et la fermeté d’un père ». Le vocabulaire. « Mon boy, mon interprète, mes Sénégalais… L’esprit du colonial se construit dans la possession ». Le business. « En échangeant défense d’éléphant contre verroterie et tissus de couleurs, le piroguier apolonien pense le marin idiot, qui de son côté est convaincu de traiter avec un crétin sans nom. Marché de double dupe. »
L’analyse de plus en plus lucide de Dabilly alterne, à un siècle de distance, avec le délicieux jargon du jeune Anuman, qui applique scrupuleusement la vision du monde paternelle à l’école ivoirienne: « Un directeur est un patron du savoir. Un élève est un ouvrier du savoir. Et un ouvrier ne doit jamais accepter le diktat du patronat. Une négociation syndicale s’impose. Je m’assois ». La langue baroque d’Anuman rappelle celles d’autres enfants de fiction, comme le Paddy Clarke de Roddy Doyle ou le Momo d’Ajar/Gary. Et c’est là, sans doute, que réside la plus grande force de ce livre : la justesse, sur le fil, des deux voix. Celle, naïve et rebelle, d’un enfant noir arraché à son Europe natale. Et celle d’un Français du XIXe siècle qui, à rebours de tout ce qu’il attendait, découvre en Afrique des gens qui lui ressemblent.
L’entremêlement des deux récits permet au roman de représenter une situation coloniale de manière à la fois intime et frontale, subtile et souvent drôle. C’est qu’à Abidjan, explique Gauz, « tu es obligé d’être intéressant. Quand tu racontes une histoire, tu dois capter l’attention et arracher des rires. Sinon, tu ne sers à rien ».

Gauz © Le Nouvel Attila
Que vouliez-vous faire avec Camarade Papa ?
D’abord, raconter une histoire de cette vieille rencontre entre le monde occidental et le monde africain, le monde de la forêt plus précisément. Ensuite, dans cette fresque coloniale, je voulais faire apparaître ce que ne dit pas l’Histoire. Il y a un nombre incalculable de textes autour de cette rencontre, mais beaucoup de choses ne sont pas dites. Quand on lit les rapports coloniaux, on voit des chiffres, des descriptions, parfois intéressantes, assez marrantes même, notamment quand leurs auteurs inventent une sorte d’ethnologie administrative. Mais ils ne disent rien d’eux-mêmes. Ils ne mangent pas, ne baisent pas, ne tombent pas amoureux, ils n’ont pas de copains. Quels que soient les auteurs, on a l’impression que ce sont des surhommes : ils se dépeignent comme héroïques, tout le temps.
Mais à force de lire ces rapports, on se rend compte que ce n’est pas seulement un système colonial qui rencontre un système ethnique ou tribal, ce sont des rencontres de personnes. Dans Trente-cinq années de lutte aux colonies, par exemple, Arthur Verdier raconte qu’il est parti de Grand Bassam après l’incendie de sa maison. Il a tout perdu, mais il s’est refait « grâce à l’aide de quelques amis africains ». Ce qu’il ne dit pas, et qui est évident pour moi, c’est que son pote africain lui a dit : « Mon gars, ne te décourage pas, voilà de l’or, reviens, on te fait confiance », comme ça arrive souvent. Et le gars revient blindé, il monte sa holding avec des fonds anglais et hollandais et installe son comptoir. Il a la priorité sur tous les produits parce qu’il est l’ami du roi de Krindjabo. Ça n’est dans aucun rapport administratif, et c’est pourtant le plus intéressant à raconter.
Quand avez-vous décidé de faire un livre sur la colonisation ?
C’est une idée très ancienne. Adolescent, quand je me suis dit que j’écrirais, j’imaginais une fresque coloniale à la manière de Ségou de Maryse Condé. J’ai commencé très tôt à lire des essais et des romans sur et autour de la colonisation. J’ai lu Voyage au bout de la nuit de Céline et Le soleil des indépendances de Kourouma en classe de première. Et puis j’ai amassé du matériel. À Abidjan, dans les « librairies par terre », on trouve des livres incroyables, qui ont passé des années dans des caves ou des valises et qui n’existent nulle part ailleurs. Un bouquin qui m’a beaucoup aidé, c’est la correspondance d’Albert Nebout, qui a vécu en Côte d’Ivoire entre 1894 et 1910. C’est le seul colonial que je connaisse qui soit revenu en France avec sa femme africaine et ses enfants. Ses six enfants ! Dans ses lettres à un ami notaire, Nebout confie ses inquiétudes, des choses très personnelles… Pour un lecteur d’aujourd’hui, ses propos pourraient paraître racistes. En fait, à l’époque, il n’a pas d’autres mots pour désigner les gens et leurs comportements. Il peut sembler raciste, mais il a emmené sa femme, « la belle Ago », et ses enfants en France. Cette correspondance m’a inspiré : c’est à partir de sa lecture que j’ai décidé de m’intéresser aux lettres plutôt qu’aux rapports administratifs. Ce livre m’a donné le son de la langue de Maxime Dabilly, la manière dont il écrit, dont il parle.

Comment avez-vous démarré le livre ? Par une image, un lieu ?
Par la plage. Les premiers mots que j’ai écrits, c’est une description de la plage et de la barre à Grand Bassam. Comme je ne savais pas encore où j’allais, j’ai commencé mon récit à la troisième personne… et ça ne marchait pas. J’ai pourtant envoyé du gros bois ! De la belle et grande description, des images poétiques… Mais en relisant, je me suis dit : c’est impressionnant ce que tu fais, mais ce n’est pas ça. Je n’avais toujours pas trouvé la voix de mon personnage. Et puis, un matin après mon footing, je me suis posé sur la plage de Grand Bassam et j’ai réalisé : c’est là qu’ils ont débarqué, c’est là qu’a eu lieu la rencontre. Il faut parler du point de vue du gars qui arrive par la mer et qui est derrière la barre. Est-ce que je peux être cet homme blanc du XIXe siècle ? Oui, bien sûr que je peux. J’ai la même culture que ce gamin de vingt ans qui débarque à Grand Bassam à la fin du XIXe. Il vient du village, j’ai la culture du village. Il a une éducation chrétienne, moi aussi. Il parle le français de quelqu’un qui a été scolarisé en français. Moi aussi. Ce désir d’ailleurs ? Je l’ai aussi, je suis parti en France motivé par la même chose que lui. On a la même culture, je n’ai aucun mal à me glisser dans sa peau. La couleur ? Je n’en ai jamais rien eu à faire. La couleur, c’est pour les dessins, pas pour les humains. Mes cousins qui sont nés en France, ce sont des petits Blancs. Ça n’a rien à voir avec la couleur. Quand ils arrivent en Côte d’Ivoire, ils commencent par faire les malins, mais il leur faut deux minutes pour se rendre compte qu’ils sont des petits Blancs. Ils se disent : « Ah non, je ne suis pas d’ici. Ma mère vient d’Abidjan et ça m’enrichit. Je suis lié profondément à ceux d’ici, mais je suis un gars de Belleville, ou de Sarcelles, et ce n’est pas grave ». Au village, on ne s’y trompe pas, on dit : « Alors Rosalie, c’est ton fils là, ton petit Blanc ». Et ce n’est pas grave, on est content de lui parler en bété.
Quelle est votre langue familiale ?
Le français. À la maison, on parlait français. Au village, on parlait bété. Sur le chemin de l’école, la femme qui vend des beignets parle dioula. Tu vas chez un copain guéré, ses parents parlent guéré. En Afrique, tout le monde comprend trois langues, minimum. J’ai la même culture que vous. Quand on se parle, on se comprend complètement, il semble qu’on ait les mêmes références littéraires. En cinéma et en musique aussi sans doute. Vous écoutez Miles Davis, on peut parler de Kind of Blue. Mais vous ne pouvez pas parler de Tima Gbahi, un poète chanteur bété, vous ne savez même pas qui c’est. Vous ne pouvez pas non plus parler de la musique de la brousse, ni de Negerplastik de Carl Einstein. J’ai votre culture, et j’en ai une autre en plus. À Paris, un Ivoirien peut parler comme un titi parisien et comme un Abidjanais dans la même phrase. Mentalités et accents différents. Ça fait de nous des Superman. Ou au moins des gens intéressants.
Le jeune Anuman, un de vos deux narrateurs, a une belle culture marxiste héritée de ses parents. C’est votre cas ?
Mon père a été député socialiste pendant presque dix ans, dans le parti de Laurent Gbagbo. Ma mère, c’est une proto-communiste. En avril 1994, elle est partie au Rwanda. Pendant qu’on se demandait ce qui se passait, elle s’est dit : les gens se découpent à la hache, ils vont avoir besoin de gens qui sachent soigner des plaies. Elle est infirmière. Elle est partie au Rwanda toute seule par « conviction populaire », elle est passée par le Burundi et le Zaïre et s’est installée à Goma. Quand elle est revenue, ce n’était plus la même. Avec des parents comme ça, quand tu parles de ton film sur Thomas Sankara, on va te dire : calme-toi, regarde ce que la mamma elle fait.
Vous avez grandi dans une famille plutôt intellectuelle, bourgeoise….
… ah non, pas du tout bourgeoise. Mon père était instit. Bon, c’est vrai, en revenant de France, il est devenu banquier. La classe moyenne donc. Les parents étaient plutôt intellectuels, on vivait entre leurs livres et les paroles des grands-parents. J’ai grandi en Côte d’Ivoire. Quand j’ai émigré en France, en 1999, j’avais vingt-huit ans et je le dis à tout le monde : je suis arrivé en France au complet, mûr intellectuellement et socialement. J’avais une maîtrise de biochimie. Je ne suis pas un produit du système d’éducation français. Je suis un pur produit du système d’éducation de la Côte d’Ivoire.

Le livre est dédié à René Ménil. Pourquoi lui ? Je ne demande pas : « Pourquoi pas Césaire ? », ce n’est visiblement pas votre truc. Mais pourquoi pas Thomas Sankara ou Frantz Fanon ?
Sankara et Fanon sont pour moi des références évidentes. J’ai découvert René Ménil il y a trois ans, quand Coline Ménil, sa petite-fille, m’a appris qu’il avait créé le Parti communiste martiniquais. Avec ses amis, ils ont aussi créé en 1932 la revue Légitime Défense. J’en lis une copie et je découvre une bande de gamins de 20 à 25 ans, qui rêvent de changer le monde. Pas par la revendication de la couleur. Mais par le ravissement, l’esthétique, l’intelligence, la poésie. Ils parlent de la beauté des masques, de la profondeur du jazz, de la lutte des classes. Ils sont loin de la négritude, les gars ! Ils dégagent la couleur, ils dégagent la peau de ce combat. Ils ont 25 ans maximum. Et je me dis, putain, moi, à leur âge, je buvais des bières ! Hélas, la négritude a dévoyé ça. Je ne veux pas juger Césaire, parce qu’il appartient à un contexte que je ne connais pas assez. Alors que la bande à Senghor, je la connais bien. Et c’est des sacrés troubadours. D’avoir prolongé ce truc de la négritude, de s’être caricaturés eux-mêmes, d’avoir justifié le regard exotisant porté sur les cultures africaines. C’est des putains de bourges ! Quand ils viennent en France, ils constituent une classe qui rêve de montrer aux Blancs qu’ils sont comme eux, qu’ils savent écrire comme eux. En fait, quand tu sors un bouquin en 1950 en Afrique, tu n’as personne pour qui écrire, sauf si tu as une vision historique comme Frantz Fanon ou Bernard Dadié. Ce que n’a pas la bande à Senghor. Ils exotisent leur discours. Il y a des poèmes entiers sur le soleil ! Un poète africain ne peut pas faire ça. La chaleur, les couleurs… Il n’y a pas de couleurs en Afrique, ça n’existe pas ! C’est vert ou gris. La couleur est exceptionnelle. Il n’y a pas de mot pour dire orange clair. Tu ne peux pas faire de la poésie comme ça. Ils portent une lourde responsabilité historique et intellectuelle sur tout ce que les négros sont devenus après, dans toute l’Afrique. Parce que nous, ensuite, on a étudié ça à l’école. Ça a fabriqué de l’apprenti bourgeois, celui qui veut devenir calife à la place du calife. C’est-à-dire Blanc à la place du Blanc.
Qu’est-ce qui a changé après le succès de Debout-payé ?
La voix porte, le tonneau est plus haut. Je peux monter sur un tonneau plus haut pour dire des choses plus loin et plus fort. C’est fini le temps où on disait, comme Amadou Hampaté Bâ : « quand un vieillard meurt en Afrique, c’est une bibliothèque qui brûle ». C’est terrible de dire ça. C’est horrible de se nier à ce point. Un vieux con, c’est un vieux con et un vieux sage, c’est un vieux sage. Amkoullel, l’enfant Peul d’Amadou Hampaté Bâ, c’est le bouquin d’un collabo, pour moi. Ce qui a changé, c’est que je suis capable de dire ça. Dans deux ou trois ans, j’aurai écrit d’autres livres et je pourrai aller plus loin. Il ne s’agit pas de déconstruire, je déteste ce mot. Qu’est-ce que tu peux déconstruire, une œuvre qui a été élaborée par des intellectuels occidentaux pendant des dizaines d’années ? Non, il faut faire Légitime Défense. Tu proposes une pensée nouvelle, tu construis un contrefeu fait de beauté et de ravissement. C’est ça qui changera la tête des gens, pas les théories.
Propos recueillis par Natalie Levisalles