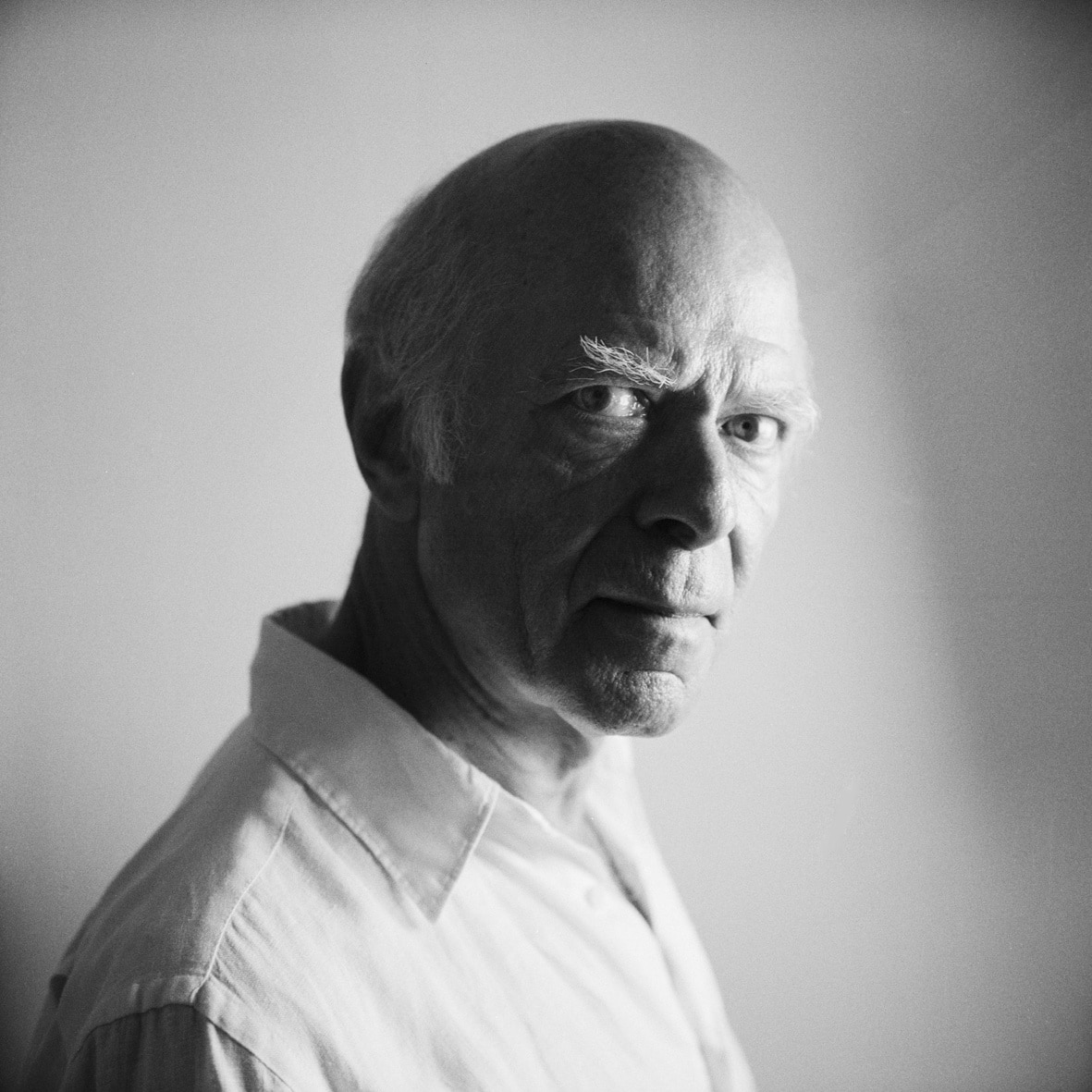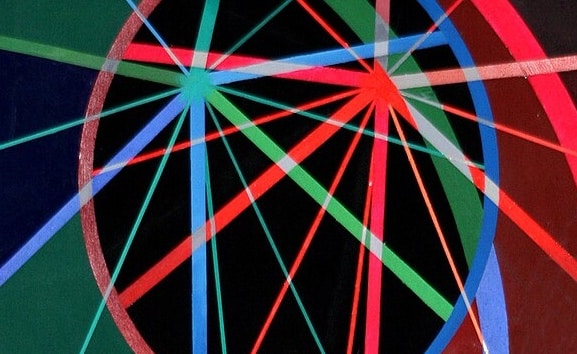Pas si tant, premier roman de Salomé Botella, est moins un récit de transfuge qu’une transfiguration et une déclaration d’amour à ce « foutu endroit » perdu dans la Creuse, où elle a grandi avant d’être diplômée des Beaux-Arts. Aucun fantasme d’un lieu ancestral et reculé figé dans le temps, mais une prose poétique grisante et sensible sur la réalité d’un village et d’existences multiples bien réelles et vivantes.
« Mon daron il a creusé des trous, il a jamais mis de piscine dedans / Il a mis des fosses septiques » : Salomé Botella attaque vif la matière de son roman. Pas de détour, pas de recours : la langue sera orale et moderne, ira au plus économique et fulgurant pour dire ce qu’il y a à dire. Et puis, quelques dizaines de pages plus loin, on apprend que « Mon daron il a creusé des trous / Il a mis le chien dedans ». Pas si tant avance en spirale provocatrice, par flashs qui se répondent et qui ne suivent pas indolemment une chronologie, produisant un ensemble d’instantanés qui révèlent la vraie « petite vie dure qu’on mène » ici. Puissamment évocateur, le texte se déploie tout en sensations et en synesthésie.
Le lecteur est propulsé au milieu de micro-événements qui se succèdent : s’il est initié, il reconnaîtra la « table Miko » des sorties au lac et se souviendra de la « chiée de quiches et de tapenade » qui orne les tables des fêtes ; s’il ne pratique pas, il pourra lui aussi sentir « les odeurs de parfums, de déodorants et de produits coiffants » qui sortent de la salle de bain partagée et entendre « NRJ qui passe un hit du top 50 en fond ». Au détour de cette collection de détails triviaux, Salomé Botella suggère des réalités immenses : il suffit d’écrire « la faïence tout amochée », de raconter que « la maison sert à tirer l’électricité » et que partout « des trous pour se nicher » cachent des souris, pour dire une réalité socio-économique ; une mention de la « pelouse du stade grillée chaque mois d’août » ou du « goudron du parking en ébullition » suffit à suggérer la sécheresse ; l’arrivée d’un beau-père est simplement évoquée par le partage d’une maison, d’un chat, d’une voiture avec un autre homme, la maladie par la « part de flan » apportée à l’hôpital. En en disant peu, l’autrice en dit long – voilà le pouvoir de cette prose poétique suggestive et expressive.
Paradoxalement, la superposition de ces petites saynètes permet, dans le même temps, de dé-simplifier les représentations souvent clichées de la ruralité, tout en simplifiant le rapport direct à celle-ci. Il s’agit de créer un espace, en littérature, d’identification et de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui vivent ou viennent de ces campagnes, loin des fantasmes et des archétypes éculés. Le récit s’ancre dans une géographie bien réelle, situable au kilomètre près, entre Bourganeuf, Guéret et Aubusson, dans un décor concret et reconnaissable avec « les pavillons au crépi mochement beige », « le city stade », « les tours à 5 étages », un « Carrefour dernièrement rénové ». Et puisque Pas si tant appartient à la récente et exaltante collection des Ogresses aux éditions de L’Ogre, c’est évidemment une « fiction vivante, joueuse et palpitante ».
Personnages, décors et pensées sont faits du même bois, et évoluent sous la plume pragmatique de Salomé Botella qui manie avec brio une langue du faire. Même si le hameau de La Vergne est flouté sur Google Earth, comme une zone blanche et délabrée, « on y pêche des écrevisses / On y plante des courges / On y entasse du bois ». Parce que, oui, à la campagne, on ne s’ennuie pas, ça vit, ça grouille de verbes et d’actions : on va au bar, on se baigne dans le lac, on fume des pétards, on joue à la Wii, on supporte les footeux et les enduros, on danse et on boit des bières au Havane, on partage des petits-déjeuners et des barbecues. Même si parfois la narratrice trouve son quotidien étriqué et la nature « chiante à crever », elle sait que même cette dernière est bien vivante, que « Dehors le maïs pousse, le purin pue, le bois se fait scier et les animaux aboient ». Hors de question de laisser gagner les stéréotypes construits par les normes gagnantes de la vie citadine et par ces « gens [qui] trouvaient cet endroit repoussant ».
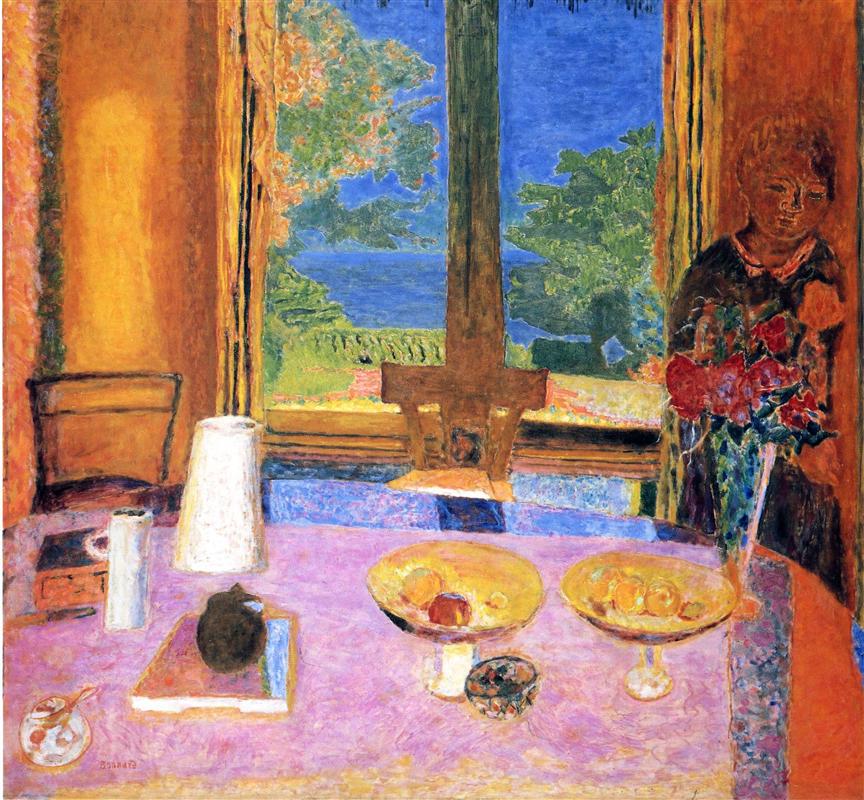
Réciproquement, cette langue utilitaire et réaliste sous-tend tout un monde silencieux où la parole est rare, où règnent les gestes, les odeurs et les bruits. Toute une galaxie de taiseux, où l’amour ne se dit pas puisque « la tendresse [n’est] réservée qu’aux animaux de compagnie / Et l’attention au compost ». Pas de compromis pour Salomé Botella : la douceur n’empêche pas d’écrire la réalité crue. Et, dans ce monde où la communication se résume à « tailler le bout de gras », à parler de la météo et des enfants des autres, la violence s’immisce et façonne les existences : les coups de poing pleuvent entre humains et sur les animaux, entre cousins « on casse les manettes de Wii en se battant avec », quand Fabrice, l’ami de la famille, est trop en colère, il « écrabouille une voiture sans permis à mains nues ».
Cette violence du quotidien résonne et est nourrie par la violence d’un mécanisme sociétal qui empêche de s’extraire de sa classe sociale et de ses pièges : dès le collège, le système éducatif brime les rêves en attribuant des vocations au ras des possibles comme « une curiosité pour la mécanique, un désir de boulangerie, une soif de salon de coiffure », des formules quasi oxymoriques qui signalent, avec ironie, l’empêchement de la jeunesse, et la volonté d’une école à former uniquement des « employés efficaces », de la chair à travail. Des jobs dans lesquels on ne s’épanouit pas, qui ne payent pas, qui avilissent et pour lesquels : « C’est 5h45 et plus 6 heures qui s’annoncent sur le réveil ». Il faut être malléable, comme le frère, « un mec facile » qui accepte l’errance « de boulot en boulot », l’accumulation de tâches ingrates – « La plonge, les surfaces, la cuisine pour 300 couverts, la pose d’une véranda ou le montage d’une cabine de douche » – qui ne sont que de nouveaux trous, « les trous où l’on croupit éternellement ». D’autres écueils s’ajoutent inexorablement à ce cercle vicieux et aliénant : pour adoucir un quotidien harassant, l’alcool s’invite et l’alcoolisme ordinaire se répand, on prend « son demi à 10h / Comme on prendrait un café ou un jus » – la drogue guette aussi, comme le gronde lapidairement l’autrice, qui pleure « le corps de [s]on frère, [où] on retrouvera beaucoup de THC et un cœur plus gros que les autres ». Un cri et une colère sourde débordent du texte, dans un sentiment éternel d’injustice face à « ce monde [qui] nous la met ».
Pas si tant est tout à la fois un chant d’amour pour la vie rurale et un récit social sans complaisance. Pas de scénario spectaculaire d’une destinée unique, mais le tableau d’une famille quelque peu dysfonctionnelle, comme toutes les autres puisque « à chaque famille sa dose de fous / Ou peut-être suis-je la plus secouée ». Des femmes-mères à qui l’on doit tout mais qui ne reçoivent que très peu en contrepartie, ces femmes-ombres qui « rembours[ent] un prêt la majeure partie de [leurs] vies » ; des hommes-pères – véritables « animaux blessés » – avec qui il faut toujours ruser pour ne pas s’attirer les foudres ; et des filles-déjà-adultes qui acceptent la loi du plus fort, se débattent seules avec les stéréotypes sexistes, et sont obligées d’« enfourcher sans selle » le cheval de l’adolescence et ses blessures inébranlables.
Mais, dans ce contexte tout aussi bancal que banal, on s’organise, on donne et on échange : on aime ses frères « surtout pour les adversaires potentiels qu’ils sont », on troque les bons plans en créant une enfance de la débrouille ; on a beaucoup d’affection pour ces pères qui vivent d’ingéniosité et d’astuces, qui ont le bronzage agricole, les « ongles longs et sales » et qui « épluch[ent] les patates pour le dîner » ; on admire la colère de ces mères, celles qui savent se faire entendre, même si « Des fois, on oubliait que maman aussi, / Fallait pas la faire chier ». La narratrice est fière d’être « Ascendant beauf » à l’image de Rose Lamy – elle n’a pas honte d’« adorer les frites », d’« aduler sa friteuse », d’être de « ceux qui mettent les Crocs pas seulement pour sortir les poubelles ». Il n’y aura pas de sauvetage par la montée à Paris, pas d’échappée d’un milieu dont on voudrait absolument se départir, pas de transfuge. Aller à la capitale pour faire des études, c’est s’inscrire dans « cette étrange chose », « ce ridicule fiasco » d’une vie dans l’étroitesse d’un appartement et des couloirs du métro, parfois encore plus étriquée que celle à la campagne. C’est, envers et contre tout, être submergée par la mémoire et ressentir beaucoup d’amour pour ses racines. C’est finir par confondre l’odeur de brûlé de Notre-Dame avec celle des merguez des barbecues en famille, c’est regarder avec nostalgie son enfance et accepter l’« impossibilité de se défaire du milieu auquel on appartient, surtout quand on l’aime ».
On commençait la lecture de ce roman par l’évocation de trous, et l’on constate que Salomé Botella a réussi son entrée en littérature avec ce premier roman sur son trou à elle, qu’elle a haï mais où elle songe à s’enterrer aujourd’hui pour « lui rendre tout ce que j’ai de plus beau ».