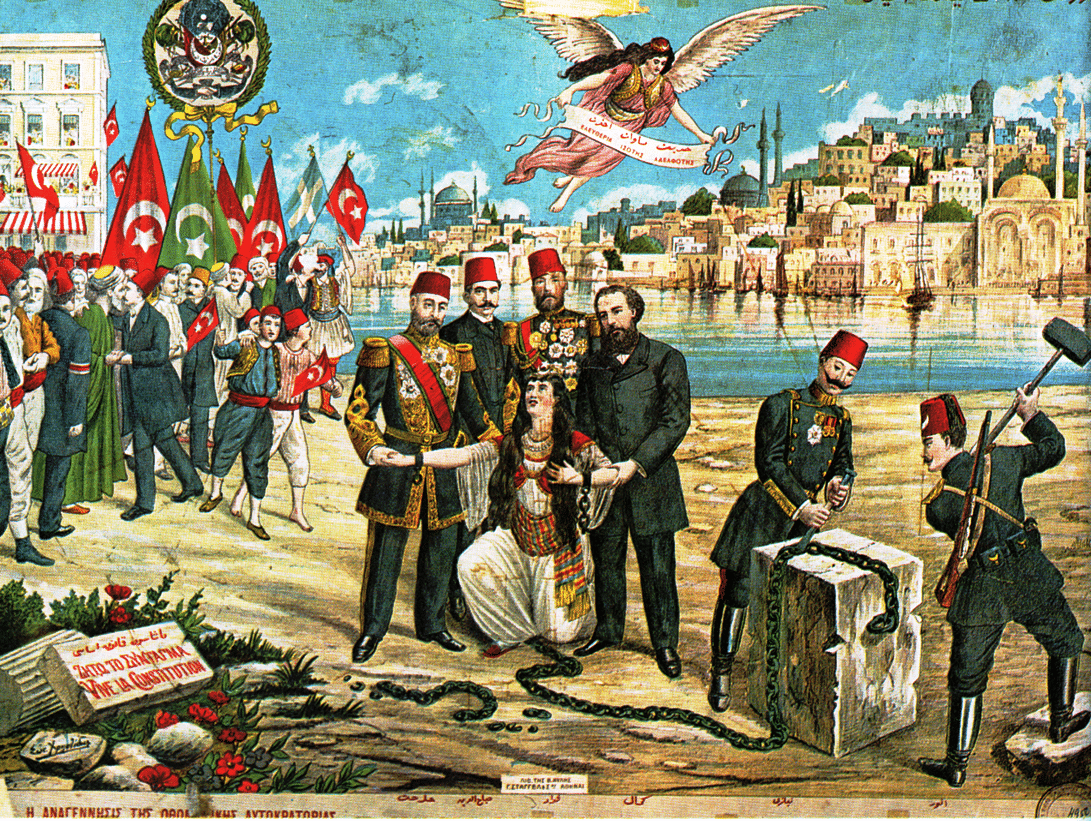Est-il vrai qu’à 300 km de la capitale on se sent tout aussi concerné par les attentats qu’à Paris ? En menant l’enquête en Lorraine, en juin 2016, auprès d’habitants encore bouleversés par les attaques de novembre 2015, Charlotte Lacoste rencontre une autre question, celle de la contribution inégale des femmes et des hommes à la mémoire collective. Dans le flot des publications liées aux dix ans des attentats, La charge mémorielle se distingue par sa portée théorique inédite. C’est un essai décisif.
La différence des sexes n’était pas l’objet initial de l’enquête menée par Charlotte Lacoste sur la mémoire des tueries du 13 novembre 2015. Spécialiste reconnue du témoignage et des études de genre, cette chercheuse en littérature et linguistique de l’université de Lorraine a intégré l’équipe interdisciplinaire du programme 13-Novembre pour y étudier la perception à distance d’un attentat parisien dont le récit médiatique disait communément, en 2015, qu’il avait bouleversé toute la France. C’est le premier apport majeur de son livre, qui donne corps et voix aux émotions politiques de celles et ceux qui se trouvent géographiquement éloignés des lieux des attaques.
Y ressent-on la même terreur, la même empathie, le même chagrin qu’à proximité des faits ? En interrogeant des dizaines d’habitantes et d’habitants de Metz et sa région, l’enquête met en lumière la manière dont l’événement résonne dans l’intimité de celles et ceux qui se trouvent loin de l’épicentre. Preuves de la violence du choc, les entretiens racontent la stupeur initiale, la panique, la sidération, et ce sentiment partagé qu’un monde s’effondre. Les participants à l’enquête ne connaissent personnellement aucune des victimes des attentats, ils n’ont rien vu d’autre que les images de la télévision et des réseaux sociaux, et pourtant, nombre d’entre eux veillent sur la mémoire des morts comme s’il s’agissait de leurs proches. Ou plutôt, nombre d’entre elles : au cours des conversations avec ces témoins indirects, Charlotte Lacoste prend conscience que ce sont des femmes, exclusivement, qui assurent ce travail mémoriel.
C’est là le deuxième apport théorique, majeur, de cet essai. En écoutant les participantes raconter la manière dont les attentats les ont affectées, Charlotte Lacoste forge le concept de « charge mémorielle », déclinaison dans le champ de la mémoire de la désormais célèbre « charge mentale ». On sait depuis les travaux de Monique Haicault, qui datent des années 1980, combien celle-ci alourdit de manière invisible la charge domestique des femmes. À elles les rendez-vous médicaux des proches dépendants, la gestion des activités extra-scolaires des enfants, les listes des courses quotidiennes, l’achat des cadeaux d’anniversaire, l’entretien des relations de voisinage ou la transmission des récits familiaux via, par exemple, l’élaboration des albums photo.
Mais à elles aussi, dévoile Charlotte Lacoste, la charge de poursuivre ce maillage du tissu social et mémoriel quand frappe la catastrophe historique. Veillant sur les vivants, elles téléphonent aux connaissances parisiennes pour vérifier qu’elles sont en sécurité, puis s’informent de manière approfondie sur les faits, et sur la meilleure manière d’en parler, pour être en mesure de répondre aux questions des enfants sans les traumatiser. Même si l’événement les accable, et qu’elles se refusent à l’expliquer, elles prennent sur elles pour domestiquer sa violence et trouver les mots qui l’introduisent à l’intérieur de l’espace familial.
Veillant également sur les morts, elles allument pour eux des bougies, se recueillent, dressent parfois de petits autels, archivent des coupures de presse, soucieuses pourtant de rester à la juste distance pour ne pas empiéter sur la douleur des proches des victimes. Prenant en charge la peine des vivants comme le souvenir des morts, elles s’attellent dans l’ombre à réparer les blessures et à prévenir d’autres désastres, en s’engageant dans des associations, ou même, pour certaines, en changeant de métier. Le care, cette « culture du souci » particulièrement manifeste au moment où survient le malheur, trouve ici une extension inattendue vers tout un corps social meurtri dont les femmes entreprennent, par de petits gestes qu’elles sont d’ailleurs promptes à dénigrer, de prendre soin.

On est stupéfaite, et souvent émue, en lisant les propos de ces femmes dont les voix, d’un entretien à l’autre, résonnent si fortement. Stupéfaite car la variable du genre est, à quelques exceptions près, la grande absente des études mémorielles, qui se sont fort peu occupées jusqu’ici de comprendre précisément en quoi elle pouvait influer sur la manière dont on se souvient d’un événement historique. Or la différence saute aux yeux dans les entretiens, dès la première question – « Pouvez-vous me raconter le 13 Novembre 2015 ? » – que les hommes et les femmes ne comprennent pas de la même façon. Aux premiers le récit des événements et l’analyse de ses causes géopolitiques, aux secondes la mémoire précise des circonstances dans lesquelles elles ont appris la nouvelle, des émotions ressenties, des gestes accomplis, dans des termes qui évoquent sans détour la peur et même le traumatisme.
Utilisant un logiciel d’analyse textométrique, Charlotte Lacoste objective la manière dont les hommes évitent toute expression personnelle de la douleur ou de l’inquiétude, préférant expliquer que « ça fait un petit choc », que les attentats « ont touché quelque chose », ou encore, à propos d’une cérémonie, que « ça tirait des larmes », quand les femmes décrivent à la première personne les pleurs, angoisses, difficultés à respirer ou insomnies qui les affectent pendant des jours, des semaines ou des mois. Avouant que l’événement a peu résonné dans leur vie personnelle, « sans doute à cause de la distance », les hommes témoignent en tant que professionnels ou citoyens informés et concernés, tandis que les femmes, « malgré la distance », s’inquiètent, même lorsqu’elles n’en ont pas, pour les enfants, tout en s’excusant de leur inquiétude. Même la mémorisation des images médiatiques semble différente suivant le genre, les femmes citant les monceaux de fleurs et de messages qui s’accumulent à proximité des lieux des attentats, les hommes le bouclier criblé de balles de la BRI et la vidéo des corps dans la salle de concert qui a circulé sur les réseaux sociaux. Un événement, deux manières (au moins) de se souvenir.
Largement informé par des travaux d’anthropologie historique et sociale (Daniel Fabre, Nicole Loraux, Véronique Nahoum-Grappe), le livre de Charlotte Lacoste fait l’hypothèse que les femmes réactivent ici des rôles qui leur étaient déjà dévolus dans les sociétés anciennes, notamment méditerranéennes : veiller sur les proches, accompagner le passage des « mauvais morts » en souffrance, accueillir et transmettre les souvenirs, tant pour en décharger les autres que pour s’assurer que l’on conserve la mémoire de l’événement et de ses victimes. Ce « care mémoriel », insiste l’autrice, est un vrai travail, lourd à porter, et plusieurs femmes évoquent leur soulagement à l’idée que l’enregistrement vidéo des entretiens, dans le cadre du programme 13-Novembre, leur permette de déposer en sécurité le fardeau de leurs souvenirs. Mais de ce travail méconnu, il faut reconnaître aussi la puissance d’enrichissement des liens, traçant des fils invisibles dans le corps social entre soi et les autres, comme entre passé et présent.
Face à lui, la capacité d’oubli, de recul réflexif et finalement d’inertie des hommes interrogés apparaît pour ce qu’elle est, une forme d’aliénation, de difficulté à accéder à ses propres émotions, ou à les assumer publiquement, comme à se relier à celles des autres. Il n’est pas réjouissant, précise l’autrice, de constater combien cette enquête sur la mémoire des attentats confirme des stéréotypes sur la différence genrée des tâches (« ils pensent le monde/elles pansent le monde ») qui sont, rappelle-t-elle, le produit d’un ordre inégalitaire. Mais cette différence, conclut la chercheuse, n’a rien d’essentialisant : il n’y a pas de mémoire spécifique des femmes, mais un nécessaire travail mémoriel que, pour l’heure, elles portent majoritairement, dont la charge s’ajoute à d’autres déjà lourdes et gagnerait, dans l’intérêt même des hommes, à être mieux distribuée.
Contribution décisive à la compréhension des émotions politiques, aux études de genre et aux études mémorielles, cet essai pionnier ouvrira sans doute la voie à beaucoup d’autres, qui s’attelleront à suivre les nombreuses hypothèses formulées dans cette enquête, si modestes que soient son terrain – quelques dizaines d’entretiens – et sa présentation, toujours très (parfois trop ?) prudente. Il n’est pas indifférent sans doute que, comme les femmes dont elle relaie la parole, l’essayiste reste rigoureusement arrimée aux données issues de son terrain, lors même qu’elle forge un concept théorique, la charge mémorielle, dont on peut parier qu’il fera date. La contribution des femmes à la mémoire collective des événements historiques contraste fortement, rappelle Charlotte Lacoste, avec le peu de traces qu’elles laissent dans les archives. On pourrait en dire autant, sans doute, de leur faible visibilité dans la production du savoir théorique. Il faut espérer que cet essai humble et magistral, jusqu’ici masqué par le flot des publications liées aux dix ans des attentats, saura déjouer cette loi.
Raphaëlle Guidée est professeure de littérature comparée à l’université Paris 8. Elle s’intéresse aux représentations de la violence historique et à l’imagination politique contemporaine. Dernier ouvrage paru : La ville d’après. Détroit, une enquête narrative (Flammarion, 2024).
Cet article a été publié sur le site de notre partenaire Mediapart.