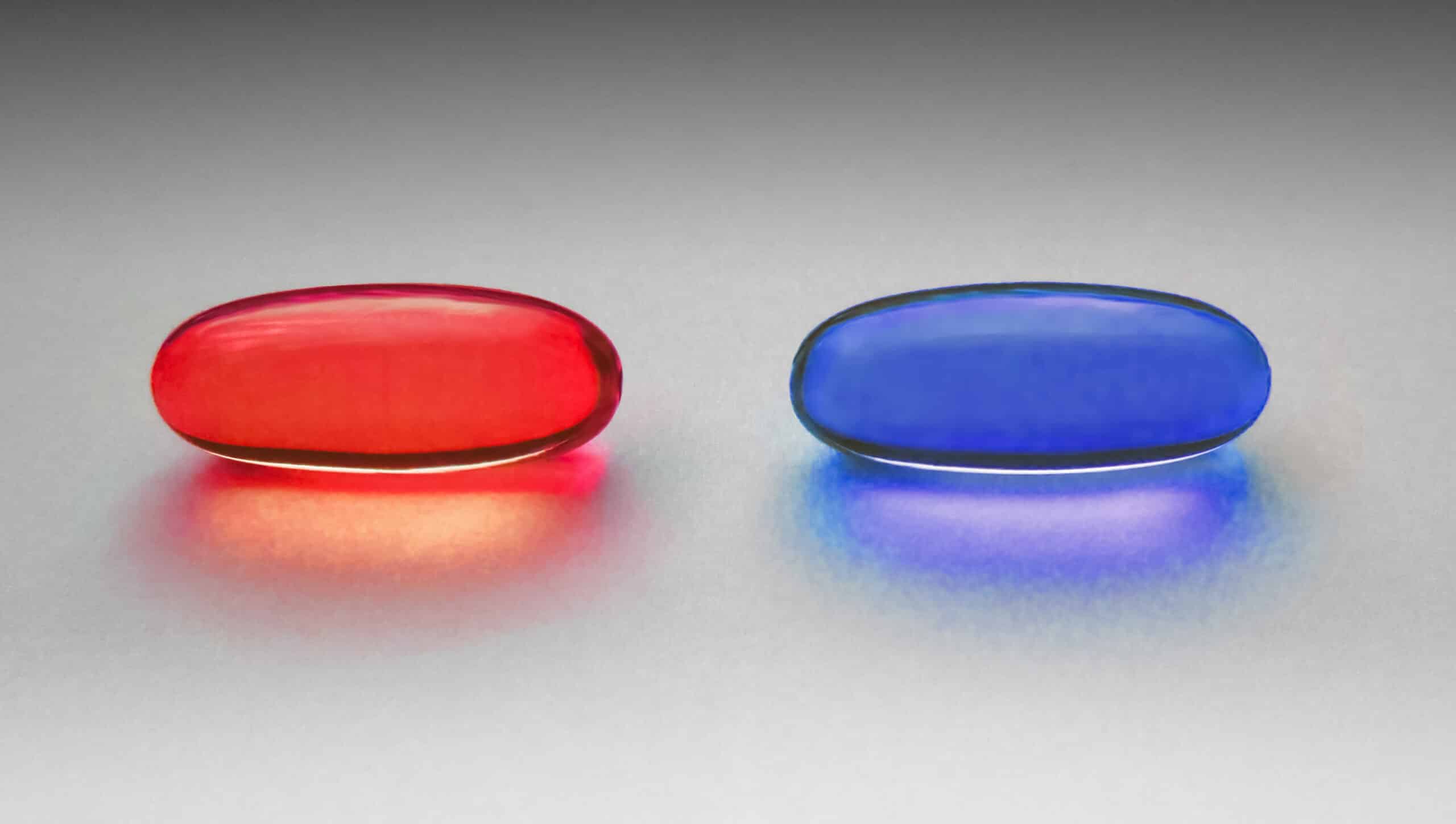Depuis une décennie, la promesse revient, portée par tous les vents : le solaire et l’éolien seraient désormais moins onéreux que le charbon et le gaz. Moins chers à produire, assurément – mais pas nécessairement mieux rémunérés. Les courbes se sont croisées, les graphiques en portent la trace, les rapports de l’Agence internationale de l’énergie en font foi.
De là découle une promesse implicite : la transition énergétique ne serait qu’une question de patience. Le temps que le marché fasse son œuvre, que les investisseurs arbitrent en faveur du moins coûteux, que la rationalité économique achève ce que les sommets climatiques peinent à imposer. Mais alors, pourquoi les gouvernements continuent-ils à subventionner massivement les renouvelables ? Pourquoi crédits d’impôt, tarifs de rachat garantis et contrats de long terme demeurent-ils indispensables ? Et pourquoi, dès qu’un État menace de réduire ces aides – comme on l’a vu en 2025 en France avec le gel de certains dispositifs –, l’investissement privé se retire-t-il presque instantanément ?
C’est ce nœud, à la fois économique et politique, que le géographe britannique Brett Christophers, professeur à l’université d’Uppsala et auteur de Rentier Capitalism (2020), entreprend de démêler dans The Price Is Wrong. Paru aux éditions Verso en 2024, salué par Adam Tooze et Andreas Malm, largement discuté dans la presse anglophone, le livre n’a pas encore d’édition française. Il mérite pourtant qu’on s’y arrête, car il renverse, avec une netteté rare, l’un des récits les plus tenacement entretenus sur la transition climatique.
Sa thèse tient en une phrase, qu’il répète, décline et creuse tout au long de ses quatre cents pages : le capitalisme ne suit pas les prix ; il suit les profits. Peu importe que le coût de production d’un mégawattheure solaire passe sous celui d’un mégawattheure au gaz : ce qui oriente les flux d’investissement, ce n’est ni le coût marginal ni la beauté des courbes descendantes, mais la promesse de rendement. Et cette promesse, dans l’univers des renouvelables, se révèle trop faible, trop instable, trop soumise aux aléas pour rassurer un capital qui n’avance qu’avec garantie de retour.
Le geste théorique, Christophers le concède volontiers, n’a rien d’inédit. Il s’inscrit dans le sillage d’Andreas Malm, dont Fossil Capital (2016) avait déjà montré que la victoire du charbon sur l’eau au XIXe siècle ne relevait nullement d’une supériorité de prix. L’énergie hydraulique coûtait moins cher, mais le charbon offrait aux industriels une maîtrise du temps et de l’espace – et donc du travail – que les rivières ne pouvaient garantir. Ce n’est pas le coût qui a fait la révolution industrielle, c’est le profit. Un siècle et demi plus tard, Christophers applique ce raisonnement à la transition inverse : si les renouvelables peinent à s’imposer malgré leur compétitivité proclamée, c’est que le prix n’a, en réalité, jamais été le cœur du problème.
Pour étayer sa démonstration, Christophers choisit un terrain précis – l’électricité – et s’y tient avec rigueur. C’est à la fois la force et la limite assumée de l’ouvrage : il ne prétend pas expliquer pourquoi « le capitalisme ne sauvera pas la planète » dans toutes ses dimensions, mais il montre, preuves à l’appui, pourquoi il échoue précisément là où la transition est censée être la plus avancée.

Au centre du dispositif analytique, se trouve un mécanisme au nom technique – la « cannibalisation » – qui renvoie à une réalité d’une redoutable simplicité. Plus les panneaux solaires se multiplient, plus l’électricité solaire afflue simultanément sur le réseau, plus son prix de marché s’effondre exactement aux heures où elle est produite. Le coût de production recule, mais le revenu recule plus vite encore. L’investisseur, raisonnant en rentabilité anticipée, voit ses perspectives de rendement se dérober à mesure que la technologie progresse. Paradoxe cruel : le succès des renouvelables sape les bases économiques de leur propre déploiement.
À cela s’ajoute la volatilité intrinsèque des marchés électriques libéralisés, où le prix spot peut connaître des variations brutales en quelques heures, rendant toute anticipation des revenus profondément aléatoire. Et le risque politique : un changement de gouvernement, une subvention supprimée, un cadre réglementaire durci. Face à cette triple incertitude – technique, marchande, politique –, le capital réclame des garanties. Sans elles, il s’abstient.
Christophers donne chair à son raisonnement par des cas concrets, dont le plus frappant reste celui du parc éolien de Fosen, en Norvège. En 2014, quatre grandes compagnies énergétiques, parmi lesquelles Statkraft, contrôlée par l’État norvégien, s’allient pour développer ce qui doit devenir l’un des plus vastes parcs éoliens terrestres d’Europe. Les études sont engagées, les turbines commandées, le calendrier arrêté. Puis, en juin 2015, coup de frein brutal : Statkraft annonce la suspension du projet. Les prix de gros de l’électricité se sont effondrés ; les modèles financiers ne tiennent plus. « Updated analyses show that the projects will not be profitable », déclare le PDG à la presse – autrement dit : à ce prix-là, ça ne marche pas.
Le projet ne ressuscite qu’un an plus tard, à la faveur de l’entrée d’un fonds d’infrastructure au capital – et surtout de la signature d’un contrat de long terme avec l’industriel Norsk Hydro, qui s’engage à acheter une partie de l’électricité pendant vingt ans, à prix fixe. Ces contrats – les Power Purchase Agreements ou PPA – sont devenus la clé de voûte du financement des renouvelables à l’échelle mondiale. Google, Amazon, Microsoft y recourent pour alimenter leurs centres de données en électricité « verte ».
Mais ce que Christophers met en lumière, c’est que ces dispositifs ne sont pas une solution de marché : ce sont des machines à fabriquer de la prévisibilité là où le marché n’en offre pas. Ils tendent à déplacer le risque du producteur vers l’acheteur, souvent via les tarifs, parfois via la fiscalité.
On pourra regretter que Christophers s’en tienne au terrain qu’il maîtrise – flux financiers, contrats, rendements – et parle si peu des conflits que la transition génère sur le terrain. Les Sámi de Fosen, qui ont contesté le parc éolien devant les tribunaux au nom de leurs droits ancestraux et obtenu gain de cause en 2021, n’apparaissent qu’en arrière-plan. Mais cette retenue fait aussi la solidité du livre : il ne prétend pas tout embrasser, il démontre une chose, et il la démontre bien.
La conclusion politique qui s’en dégage n’est nullement ambiguë. Si le capital privé ne peut pas – structurellement, et non par défaut de bonne volonté –financer la transition au rythme requis, alors la charge doit en revenir à la puissance publique. Non par un surcroît de subventions, mais par l’action directe : en construisant elle-même, en devenant propriétaire et opératrice des infrastructures de production.
Christophers s’appuie sur un exemple américain récent : le Build Public Renewables Act, loi adoptée dans l’État de New York en 2023 après deux années de mobilisation. Ce texte habilite l’opérateur public new-yorkais à développer ses propres parcs solaires et éoliens là où le secteur privé renonce, faute de rentabilité suffisante. L’un des promoteurs de la loi en résumait l’esprit : on ne peut pas confier la transition à l’espérance de profit.
Le livre ne sombre pas pour autant dans l’utopie. Christophers sait combien l’appropriation publique de l’énergie se heurte à des résistances puissantes, y compris au sein de la gauche américaine, où le texte a longtemps été entravé par des élus démocrates proches des intérêts privés. Il sait également que l’État n’est pas, par essence, un gestionnaire exemplaire. Mais son diagnostic demeure tranché : tant que la transition reste arrimée à un capital exigeant des rendements que les renouvelables ne peuvent offrir, elle n’adviendra pas – ou adviendra trop tard.
Reste une question, que le livre laisse ouverte, et qui prolonge les réflexions menées à l’automne 2025 dans ces colonnes à propos de Greenbacklash : si l’État doit construire les éoliennes que le capital refuse de financer, qui décidera de leur implantation ? Et qui assumera les coûts – économiques, paysagers, sociaux – que le marché rendait invisibles en les diluant dans les prix ?
Le « greenbacklash » analysé par Laure Teulières et ses coauteurs – cette résistance croissante aux politiques écologiques – ne procède pas uniquement des climato-sceptiques ou des lobbies fossiles. Il émane aussi de ceux qui pressentent, confusément ou lucidement, que l’addition finira sur leur table. Christophers a le mérite de montrer pourquoi cette addition existe, et pourquoi le marché est structurellement incapable de l’effacer. Reste à savoir qui la réglera et comment éviter que ce soient, une fois encore, les mêmes.
Stéphane Lalut est l’auteur de Anthropie. Ordre ici. Dette ailleurs et de Dette publique. Qui paie vraiment ? (2025), deux essais consacrés aux mécanismes d’externalisation des coûts économiques, sociaux et écologiques.