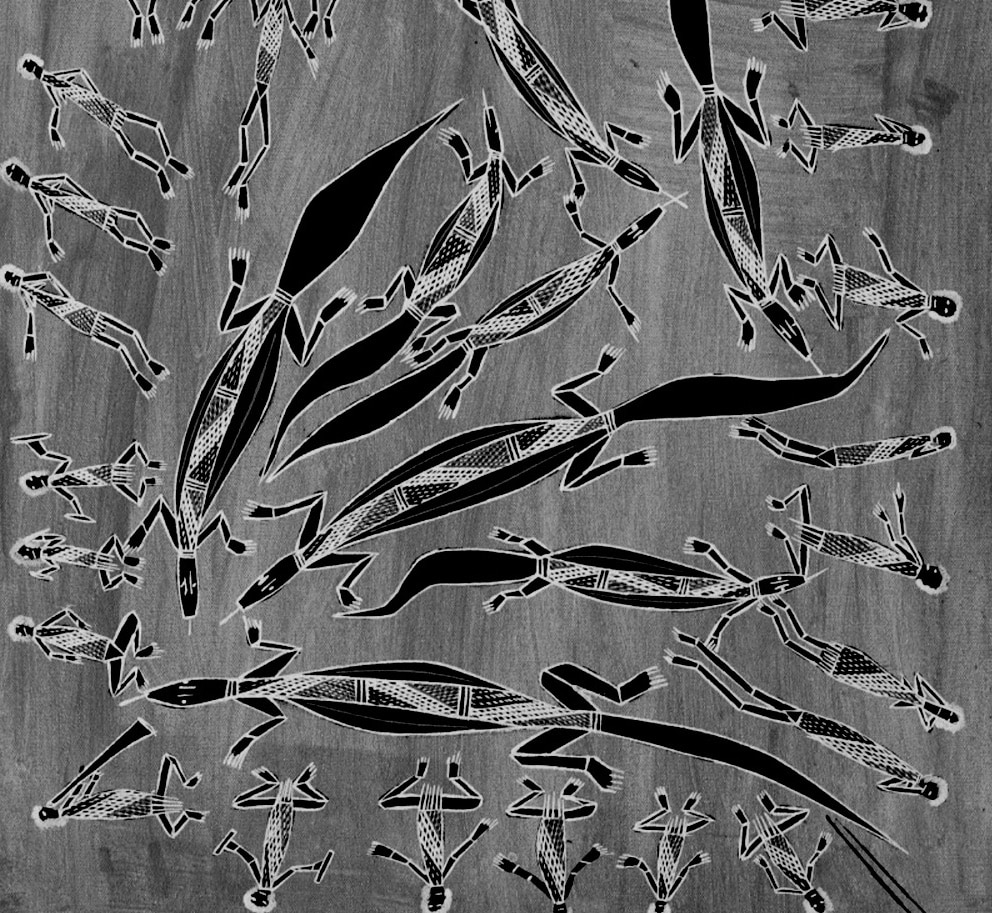Sorti en 1983 et considéré comme un classique aux États-Unis, Comment torpiller l’écriture des femmes n’avait encore jamais été traduit en français. Le livre peut être lu au premier degré comme un manuel, qui nous apprend, non pas à torpiller l’écriture des femmes, mais à repérer tous les mécanismes qui y mènent, afin de rester vigilants. Naviguant entre sa propre expérience de critique, d’autrice, et des exemples édifiants tirés de la littérature anglo-américaine, Joanna Russ fait une démonstration implacable en énumérant et analysant les différents stades de torpillage de l’écriture des femmes dans l’histoire de la littérature.
Au premier niveau, on est proche de l’interdiction pure et simple qui se résume à des « obstructions informelles très puissantes ». Parmi elles, le manque d’argent, de temps, et l’inaccessibilité d’une instruction poussée pour les femmes. Pour celles qui dépassent ces obstacles et arrivent tout de même à écrire, une suspicion plane : ont-elles réellement écrit seules ? Un frère ou un mari n’a-t-il pas contribué à ces textes ? S’il est difficile d’associer un mâle à l’autrice, alors il est fait appel à une accusation encore plus étrange : c’est sans doute la partie masculine de l’écrivaine qui a « réussi » à écrire.
Les femmes qui parviennent à écrire sont donc vues comme étant anormales, trop masculines et promises à la tristesse et à la solitude. Quant à celles qui se sont tenues loin de l’écriture, des aventures, qui se contentaient d’être belles, de se marier et d’avoir des enfants, elles pouvaient à la limite être des muses, des personnages dans des poèmes écrits par des hommes. La mauvaise réputation des créatrices est une autre technique qui éloigne un bon nombre de femmes de l’écriture et mène à une impasse : « les femmes vertueuses n’ont pas assez vécu pour bien écrire et […] celles qui ont assez vécu pour bien écrire ne peuvent être vertueuses ».
Plus on avance dans le temps et plus les moyens de torpillage gagnent en sophistication. Quand il est devenu impossible d’ignorer totalement les écrivaines, il a bien fallu les intégrer (en très faible pourcentage) aux anthologies littéraires et aux programmes universitaires. Johanna Russ les passe alors en revue et remarque que, bien souvent, on met en lumière un seul de leurs travaux, et pas forcément le plus pertinent ou le plus brillant. On leur concède donc d’écrire dans certains genres littéraires (littérature jeunesse, science-fiction, littérature gothique), mais il n’est pas question qu’elles s’attèlent à des sujets trop sérieux ou qu’elles construisent des œuvres trop importantes. Certains territoires leur demeurent inaccessibles, ce qui n’empêche pas de les accuser de ne pas écrire sur les « bons » sujets. Leur expérience, qui est pareillement et réciproquement inaccessible aux hommes, Joanna Russ nous le rappelle, est systématiquement dévalorisée et les thématiques sur lesquelles elles travaillent sont jugées mineures.

L’une des illustrations les plus absurdes de cette mauvaise foi est peut-être celle qui montre que Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë a été reçu de manière très différente quand on le pensait écrit par un homme (première édition sous pseudonyme) et quand on a fini par connaître sa véritable autrice. Sous pseudonyme, le roman avait pour « thème principal, selon l’avis général, la représentation de la cruauté, de la brutalité, de la violence… » et son auteur était « prodigue en matière de haine et de grossièreté ». Signé Emily Brontë, le roman devient une « histoire d’amour » et l’autrice « un oisillon se heurtant les ailes aux barreaux de sa cage ».
Cet exemple reflète parfaitement l’incapacité de beaucoup de critiques à oublier la femme derrière l’autrice et à employer le deux poids deux mesures ou le « double standard » pour juger les écrivains et les écrivaines. Ainsi, ils pouvaient estimer qu’un roman était « le meilleur écrit par une femme » sans jamais réellement mettre cette femme au niveau des romanciers hommes. « L’astuce est de valoriser l’expérience d’un groupe, estimée plus importante que celle d’un autre groupe. »
Les minorités sont sans cesse rappelées à leur minorité. Ce qu’on attend d’elles, c’est qu’elles se conforment à la façon de faire dominante, pour ensuite les juger de manière injuste sur des critères qui n’ont pas bougé durant des siècles. Or, la marge que représentent ces minorités peut faire avancer les choses en un sens totalement nouveau : « on ne pourra pas faire entrer dans le canon littéraire des œuvres écrites par des minorités en supposant qu’elles parlent des mêmes choses ou qu’elles ont recours aux mêmes techniques que les œuvres majoritaires, car cela ne sera probablement pas le cas. Il se pourrait très bien que ces œuvres ne ressemblent à rien de connu ».
Cela n’est pas vrai que pour les femmes, mais pour toute personne racisée ou discriminée. Des parallèles avec les écrivain.e.s noir.e.s sont parfois esquissés dans l’essai, mais sur ce point la postface a un air de mea culpa de la part de l’autrice, elle y avoue ses propres impensés et la prise de conscience des manquements dont souffre le livre (et sa propre culture) en ce qui concerne la littérature écrite par les femmes noires. Elle se lance alors dans une exploration et une étude assidue qu’elle finit par intégrer au livre sous forme d’une sorte de journal de citations d’autrices noires.
En arrivant à la fin de l’essai, on s’interroge sur les motivations d’un si puissant rejet de l’écriture des femmes, et l’autrice avance des hypothèses : « habitude, paresse, confiance en l’histoire ou en une critique déjà corrompue, ignorance (sans doute le plus excusable de ces motifs) ». On peut s’arrêter un instant sur ce dernier point, pour constater qu’il est difficile aujourd’hui de prétendre ignorer l’importance de ces œuvres, les mouvements féministes ayant fait et faisant encore un grand travail de visibilisation. Pourtant, d’autres questions nous taraudent : de tous les procédés de torpillage cités, y en a-t-il qui ont prospéré ? Y en a-t-il de nouveaux à contrer pour être enfin lue sans a priori en tant que femme ? Joanna Russ qualifie son essai de « monstre », ne sait pas trop comment le conclure, et ne cesse « d’accumuler les preuves, tant le monde continue d’en fournir à foison ». Elle nous propose alors à nous, lecteurs, lectrices, de le poursuivre. La mission n’a malheureusement rien de bien difficile puisque l’actualité nous donne encore trop d’exemples effarants à ce sujet. On pense aux voix qui se sont élevées en France pour s’offusquer de l’attribution du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, elle qui ne fait pas selon eux de la « vraie » et « grande » littérature. Plus récemment, au sujet du procès de Mazan, certains critiques ont mis en cause la lecture féministe de l’affaire dans la plupart des livres qui lui ont été consacrés, alors que ce procès a eu un énorme retentissement dans la société, précisément à cause des questions de violences patriarcales. Preuve que les sujets, les angles et les points de vue choisis par les autrices sont, encore aujourd’hui, jugés selon des biais sexistes.
En parlant de ce qu’a constitué pour elle la découverte et l’exploration du champ de la littérature de femmes noires, Joanna Russ écrit : « Il est très difficile de retranscrire ce soudain éclair de lucidité, ce choc sourd, qui redéfinit à tout jamais votre vision du monde. » Comment torpiller l’écriture des femmes a tous les atouts pour provoquer un même choc salvateur.