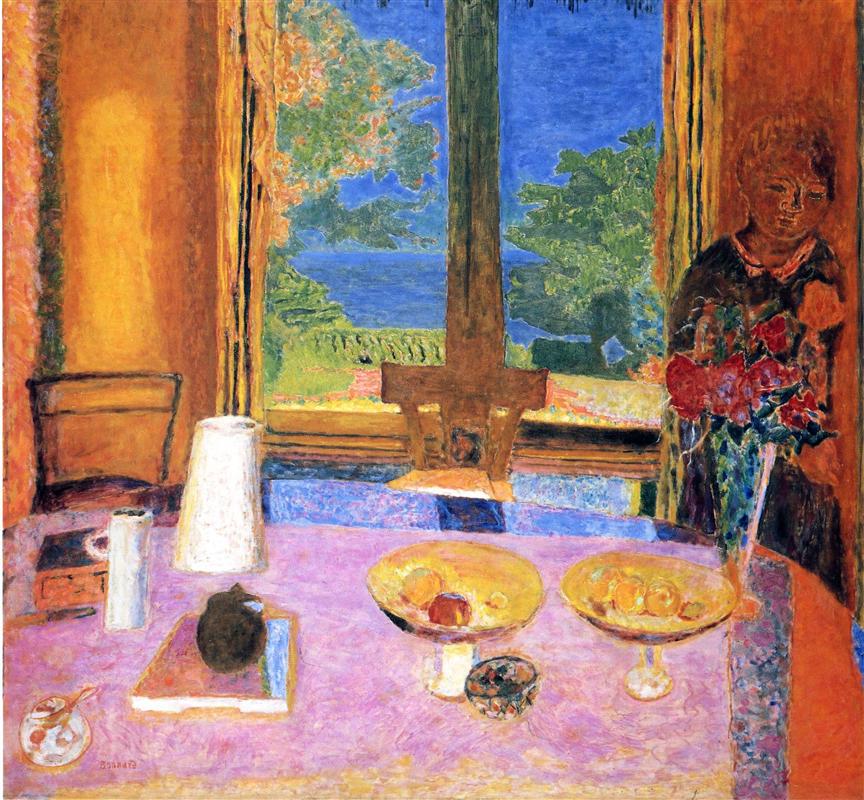Il y a diverses manières de raconter sa vie. Robert Evans, qui fut le « prince d’Hollywood » dans les années 1970, écrit ses mémoires. Plus inattendue, Amélie Durand se met en scène en s’inspirant d’un célèbre cartoon. Plus indirecte, Léa Arthemise réveille un vieux scandale. Quant à Vincent Kaufmann, il se demande comment on devient critique littéraire. Tandis que l’identité religieuse, souvent à l’origine de conflits, nous dit Caterina Bandini, peut, en Israël-Palestine, faire partie de la solution.
Parue primitivement chez A Contrario en 1995 et devenue introuvable, The Kid Stays in the Picture, l’autobiographie de Robert Evans (1930-2019), qui fut l’un des producteurs emblématiques du Nouvel Hollywood, vient d’être rééditée par les éditions Séguier, sous le titre de Mémoires, augmentée de quelques pages inédites en français.
En 1956, le jeune Robert Evans, qui partageait son temps entre la création de textes radiophoniques et la promotion d’une entreprise de prêt-à-porter féminin dirigée par son frère, entama une carrière d’acteur qui culmina avec le film de Henry King adapté du roman d’Hemingway : Le soleil se lève aussi, avec Erroll Flynn, Ava Gardner et Tyrone Power, dans lequel il interpréta un torero. Mais seul Erroll Flynn accepta le jeune inconnu, les autres pensant que le film, par sa faute, serait un désastre ; alors Darryl Zanuck, producteur du film et directeur de la Twentieth Century Fox, imposa celui qu’il avait découvert auprès de toute l’équipe, et d’Hemingway, par ces quelques mots : « the kid stays in the picture » (le petit reste dans le film). Impressionné par le pouvoir de Zanuck et n’ayant que très peu de facilités et de désir pour le métier d’acteur, Bob Evans décide, après ce tournage, de devenir producteur. Il achète alors les droits de plusieurs romans et signe des contrats avec la Fox pour des adaptations cinématographiques, jusqu’à ce qu’alerté par un article du New York Times qui vante les mérites de ce jeune producteur, le nouveau patron du studio Paramount, l’embauche avec cette injonction : « Find beautiful girls, make pictures » (trouvez des jolies filles, faites des films).
Bob Evans va obéir, à sa manière, à cet ordre, durant une vingtaine d’années. Dans ses mémoires pleins d’énergie et de contentement de soi, il montre que pour produire des films dans les années 1970, il fallait inventer des histoires pouvant plaire au plus grand nombre, être invité dans toutes les soirées privées, avoir du flair pour trouver de nouveaux talents et ne pas oublier de s’amuser. En appliquant ces règles et après avoir convaincu le studio de faire un film comme Love Story, persuadé avec raison que son incomparable mièvrerie allait lui rapporter beaucoup d’argent, il va devenir le prince du Nouvel Hollywood, en produisant des films comme Rosemary’s Baby et Chinatown de Roman Polanski, Marathon Man de John Schlesinger, Serpico de Sydney Lumet ou bien encore, excusez du peu : Le parrain de Francis Ford Coppola. La suite est plus chaotique et il ne rebondira que très brièvement dans les années 1980. Le récit de sa vie est souvent drôle, empli d’anecdotes et de personnages surprenants comme celui de Kissinger dont Bob Evans se targuait d’être l’ami, et dresse le portrait d’une époque révolue, celle des derniers feux du cinéma hollywoodien. Jean-Yves Bochet

Amélie Durand, autrice à la biographie variable, publie son troisième ouvrage sous la forme de ce livret inspiré par un célèbre cartoon dont l’un des deux protagonistes, un canidé sauvage, passe son temps à pourchasser l’autre, un volatile particulièrement véloce qu’il aimerait bien croquer. Hélas pour lui, le carnivore court toujours à l’échec, étant souvent victime de ses propres pièges diversement loufoques, ce qui ne l’empêche pas de récidiver dans l’épisode suivant. Il y a donc du Sisyphe là-dedans, avec ce que le comique de répétition est susceptible de contenir comme dose de tragique. Amélie Durand entrelace subtilement ces deux fils tout au long du texte, d’autant plus que le poursuivant est ici incarné par « le Monsieur et moi » et le poursuivi par « l’Amour », situation aux péripéties éternellement d’actualité.
Ce « divertissement conjugal mal conjugué » reprend les codes du dessin animé américain du siècle dernier avec, en ouverture, générique clinquant et cercles rouge-orange formant une sorte de cible, puis titre, L’amour carrée (sic, Amélie Durand se qualifiant de « féministe assez mal embouchée »), et interminables mentions obligatoires où l’autrice, forcément omniprésente, fait encore preuve d’autodérision. Ensuite, l’histoire peut enfin commencer, dans un environnement mêlant des éléments du décor de cartoon, un désert jaunâtre parsemé de rochers de toutes tailles, où le sprinter à plumes soulève invariablement un nuage de poussière sur son passage, et ceux d’une ville où les deux poursuivants, sortis de leur chambre, s’aventurent sur les traces de « l’Amour enfui, amor fugit » avant de se plonger dans « un Livre qui parle, justement, de ce qui [les] intéresse : S’aimer ».
Le tout est écrit dans une tonalité tragicomique qui, comme on le sait, constitue l’une des plus délicates à trouver : « À force, nous restons là, le Monsieur et moi, Couplus congélatus. C’est un effet spécial de surplace. Nos jambes effrénées dessinent un nuage de mouvement immobile » – soit nos héros pédalant dans le vide mais miraculeusement indemnes, quelques secondes avant leur chute finale dans un canyon aussi vertigineux que les affres amoureuses. Et, après cette débâcle annoncée, le livre se referme malicieusement sur la fameuse formule That’s All Folks ! – à la prochaine ! Bruno Fern
Si vous aimez les histoires de trésor et de pirates, lisez Le chercheur d’or de Jean-Marie Le Clézio. Plutôt qu’à un roman, Une île à l’envers ressemble à un règlement de comptes. La première phrase prévient : « Peu importe, au fond, que ce récit soit véritable. » De la couleur locale il y en a, à foison, mais l’autrice comprend mal le créole, et le climat austral. Une chaleur « moite, suffocante » en juillet, c’est rare. « Un pied de riz », ce n’est pas un riche Blanc, mais une femme dont le salaire dispense son époux de travailler, comme le chante un séga des années 1970, « Moin la trouv’ un pied de riz. Moin l’a largué mon place chauffeur taxi. Mi sa rouler dan’ tit l’auto fantaisie. »
L’histoire de Jo, chasseur de trésors amateur, qu’on marie pour la mater à Léone, une tornade sauvage, s’entretisse avec la quête d’un historien, non fictif celui-là, Charles de la Roncière, sur les traces du trésor légendaire d’Olivier Levasseur, dit La Buse, que Jo va chercher pendant trente ans en creusant la rocaille. À sa mort, son fils prend le relais. Le lien entre tous les protagonistes, c’est le regard amer concentré sur les cicatrices d’êtres et de lieux sinistrés. Premier coupable, l’État français et son cortège de profiteurs. L’État s’était évertué à éradiquer la dénutrition et le paludisme, première cause de mortalité, à doter l’île d’établissements scolaires et d’hôpitaux dernier cri, mais peu importe, il a tout faux. D’après la nénène des enfants, et la quatrième de couverture : « L’État français s’applique à vider le ventre » des femmes. Or l’État n’était pour rien dans l’affaire évoquée, qui a fait du bruit jusque dans un article du Nouvel Obs.
En 1970, Témoignages, journal du Parti communiste réunionnais, et Croix-Sud, hebdomadaire catholique, dénoncent la pratique d’avortements et de stérilisations dans une clinique de l’île. Ces opérations auraient été non consenties, alors que des femmes déjà mères de nombreux enfants les sollicitaient, souvent en cachette de maris entretenus par l’argent braguette des allocations familiales. Première cible, la politique du BUMIDOM lancée par Michel Debré pour tenter de réduire le chômage endémique en envoyant des jeunes chercher un emploi en métropole. Le scandale des enfants transplantés dans la Creuse, qui faisait partie d’un programme pour repeupler la France rurale, n’a été médiatisé qu’une quarantaine d’années plus tard, après un dépôt de plainte en 2002. Selon la commission d’enquête constituée en 2016, « il semble aujourd’hui évident de dénoncer comme une hérésie l’implantation d’enfants de La Réunion à plus de 9 000 kilomètres de chez eux » alors qu’à l’époque « la très grande majorité des esprits n’est choquée ni à La Réunion ni dans l’Hexagone. La dénonciation de la transplantation n’a finalement pris corps qu’avec la prise en compte des apports de la pédopsychiatrie ». Léa Arthemise, née à Meaux en 1987, n’a pas vécu ces épisodes mais son père réunionnais a pu être un de ces exilés malheureux, et lui transmettre sa colère. Dominique Goy-Blanquet
Pourquoi devient-on critique littéraire ? Vincent Kaufmann, qui l’est, se pose la question dans ce récit à mi-chemin entre essai et autobiographie. Est-ce son penchant pour l’ironie qui le rend aphone ? « Je ressens très vite un besoin irrépressible de prendre mes distances, de m’en sortir par quelque propos ironique ou par une plaisanterie. Tout se passe comme si j’étais toujours resté à côté de ma voix… » Chez Kaufmann, on divague, on s’éloigne, on suit la pensée de ce professeur à l’université de Saint-Gall comme les routes alpines : pour aller nulle part, et lentement.
L’immobilité mène à la mélancolie : « Avons-nous perdu la mélancolie, l’avons-nous oubliée, sommes-nous définitivement des junkies de l’animation, incapables de nous trouver dans le sublime ennui du désanimé ? Sommes-nous désormais assignés au 0-1 du numérique, à des oui et des non, à des principes d’action-réaction qui ne laissent aucune place ni à l’indécision, ni au temps qui passe pour rien, ni au vide ? »
Kaufmann accueille le vide ; au lieu d’évoquer ses lectures, il parle de ses lacunes : « Les livres sont là, dans ma bibliothèque, comme des trophées de chasse, et ils ne bougent plus, j’y veille. Les autres, ceux que je n’ai jamais pris le temps de lire, ont cessé de me tourmenter par leur présence silencieuse et leurs reproches muets… »
Trop de lectures produisent-elles des extinctions de voix ? Kaufmann se moque des intellectuels animés par une voix empruntée, notamment chez les adeptes de Lacan : « Grâce à lui on pouvait tourner en bourrique les obtus, les obscurantistes, les gauchistes, les sémioticiens, les formalistes et d’autres petits esprits indécrottables. C’était très efficace de balancer par surprise que la femme n’existait pas, comme si on savait quelque chose… »
Lorsqu’ils disent « Sade et Kant, c’était la même chose », Kaufmann est perplexe ; il achète les œuvres complètes de Kant dans une édition de poche qui prend trente centimètres de sa bibliothèque : « Longtemps j’ai traîné ces trente centimètres avec moi, d’un domicile à l’autre, d’un continent à l’autre, sans jamais en lire la moindre ligne. Puis je m’en suis débarrassé, acceptant ainsi l’éventualité de plus en plus certaine que je quitterai ce monde sans avoir lu Kant. » Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore trouvé leur propre voix, on vous conseille d’écouter celle de Vincent Kaufmann. Steven Sampson
Comment, de part et d’autre du mur qui sépare l’État d’Israël des territoires palestiniens occupés, des individus et des groupes se mobilisent-ils au nom de leur appartenance religieuse pour sortir d’un conflit dont l’autrice souligne d’emblée le caractère colonial et donc territorial ? Alors que le référent religieux est le plus souvent associé à la violence, à la guerre, à l’exclusion de l’autre, la sociologue Caterina Bandini s’est intéressée à ces minorités cognitives, formées autour de corps de connaissance déviante, qui considèrent que, la religion faisant partie du problème, elle doit également faire partie de la solution.
Trois grands groupes s’y distinguent. Bandini en montre la genèse et les visages multiples. Se dessinent ainsi les grandes lignes du mouvement de la théologie de la libération palestinienne, qui au cours des années 1980 réunit protestants, catholiques et grecs-orthodoxes, et s’oppose au sionisme chrétien qui monte en puissance aux États-Unis, avec l’élection de Ronald Reagan et la naissance de la New Christian Right. Ce mouvement va évoluer en mettant l’accent sur l’autochtonie du christianisme palestinien et en prônant le dialogue entre chrétiens et musulmans au sein même de la société palestinienne.
Dans le courant du judaïsme réformé qui s’oppose à celui des orthodoxes et se caractérise par une orientation explicitement universaliste, le respect des droits humains est vu comme une obligation religieuse. Parmi ces groupes, l’un des plus actifs est celui des Rabbins pour les droits humains. Depuis 2018, le premier soir de la Pâque juive, ces groupes organisent à Hébron, où les colonies sont présentes à l’intérieur même de la ville, un seder (repas rituel de commémoration de la sortie d’Égypte) en solidarité avec les Palestiniens, en guise de message de liberté et de dignité.
Il y a enfin tous les groupes créés à l’initiative d’Israéliens qui, pour résoudre le conflit, promeuvent le dialogue. La plupart des Palestiniens y voient un déni de la réalité de l’occupation. « Tu étais à Tel-Aviv en train de boire un café avec un Israélien, et sur le chemin du retour, on te crache au visage. » Certaines de ces organisations ont été créées par des colons religieux désireux d’établir une coexistence pacifique entre les deux sociétés. Caterina Bandini montre que dans le cadre de ce qu’elle analyse comme une colonie de peuplement, ces interactions entre colons et Palestiniens s’inscrivent toujours dans des rapports de pouvoir et de chantage économique.
C’est quand il s’agit d’imaginer la possible sortie du conflit que se révèle la tendance générale à reproduire les rapports coloniaux de pouvoir entre population juive et population palestinienne. « La paix est aussi un bras de fer pour la définition d’un rapport de force politique », écrit Caterina Baldini, qui montre, avec ce livre, qu’un travail de recherche lucide et rigoureux peut renouveler la réflexion politique. Sonia Dayan-Herzbrun
Une chronique coordonnée par Jean-Yves Potel