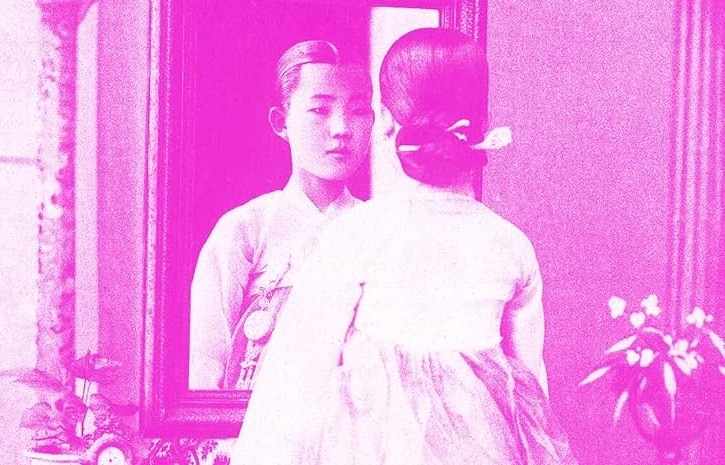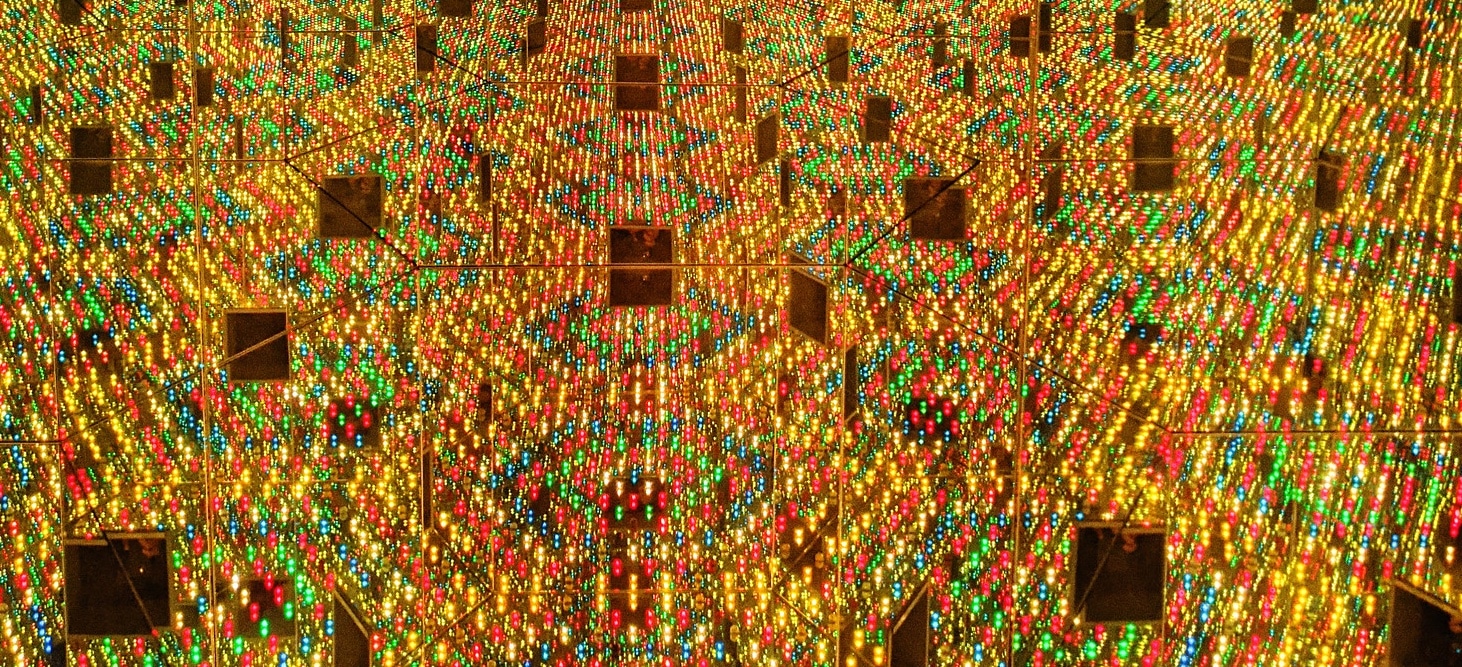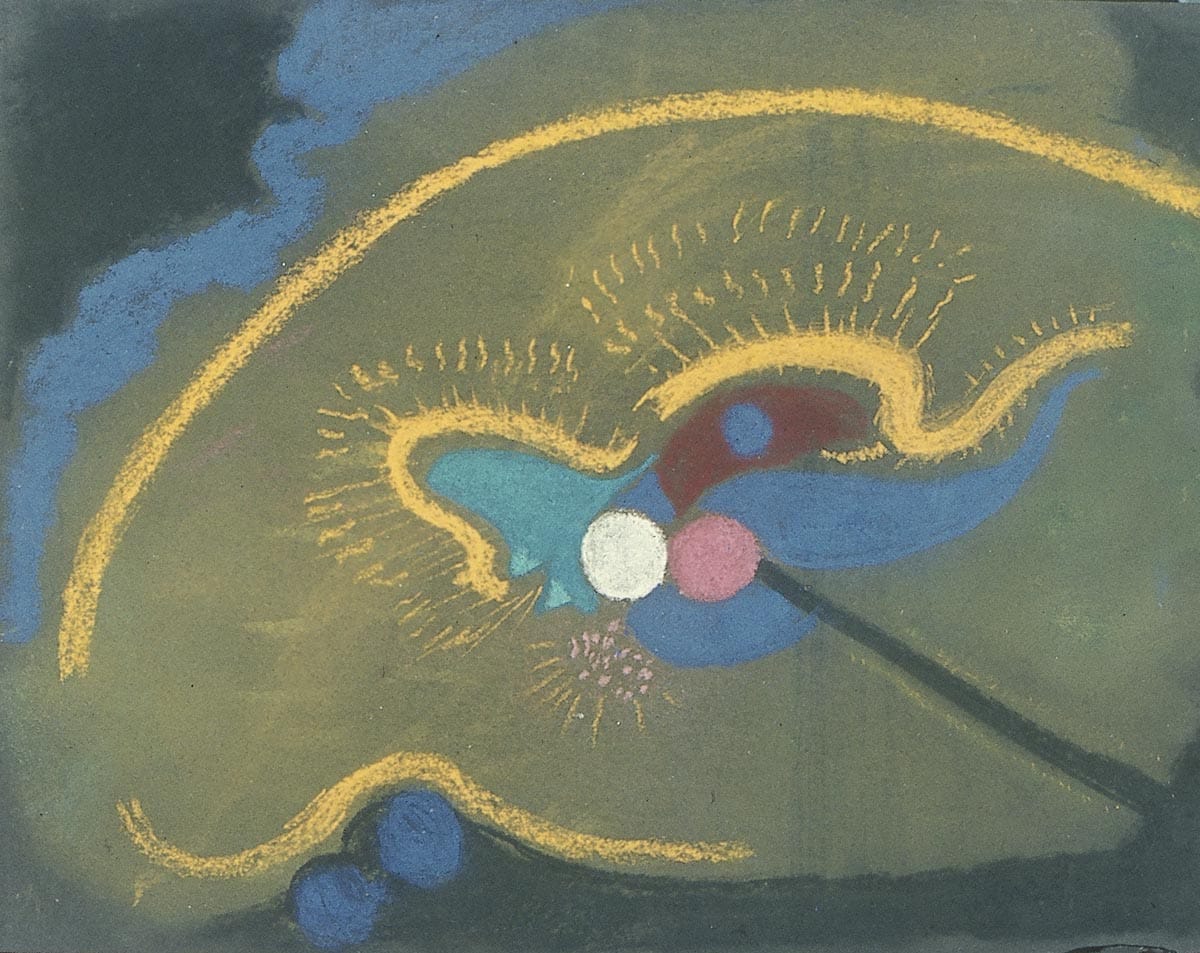« À l’écoute » consacre cette fois un ensemble à un éditeur. En cinquante ans, Arfuyen a réussi à constituer un catalogue de premier plan. C’est l’occasion d’enrichir cette chronique. Chaque livraison sera illustrée par un ou une collagiste qui répondra à sa manière à cette question : qu’est-ce qu’un livre de poèmes… ou de poésie ? Nombreux sont ceux qui pensent que le collage entretient des liens particuliers avec la poésie.
Le cinquantième anniversaire des éditions Arfuyen
Dirigées par Anne et Gérard Pfister, les éditions Arfuyen fêtent, en cette année 2025, leur cinquantième anniversaire. Les collections, constituées au fil du temps, fonctionnent en binômes : Les Cahiers d’Arfuyen et Neige (poésie), Les Carnets spirituels et Ombre (spiritualité), Les Vies imaginaires et Le Rouge & le Noir (littérature), Ainsi parlait et La faute à Voltaire (sciences humaines). Leur point commun est l’expérience intérieure, pour peu qu’elle soit originale et authentique.
Cette activité éditoriale fait partie intégrante de l’œuvre de pensée et de vie que Gérard Pfister a construite depuis de nombreuses années, avec ses propres écrits (poésie, littérature, essais) et ses traductions de l’allemand (en particulier, Maître Eckhart et Rainer Maria Rilke), de l’italien, de l’anglais et du turc. Toute son écriture, à la fois sensible et spirituelle, porte la marque d’un dépouillement intérieur – d’où son intérêt pour la mystique rhénane – et d’une interrogation constante de la langue et de son fragile dialogue avec les choses. La forme qu’il préfère est celle du chant, la plus apte à épouser les courbes du temps et de l’espace, horizontalité et verticalité, s’élevant et descendant au fil des courants aériens de sa pensée la plus intime : une musique de l’être, dans l’étonnement et le bonheur d’être là, à l’instant, pour célébrer l’indicible présence au monde. Le Verbe, rendu à son éclat premier par un travail d’orfèvre, devient un miroir où la beauté du monde, surtout la nature, se reflète. Alain Roussel
Laurent Albarracin entraîne son lecteur dans une quête cocasse de vérités paradoxales, au fil d’un triptyque mêlant joyeusement poésie lyrique et didactique : tant il est vrai qu’on ne peut pleinement savourer ce Message ni cette réisophie sans lier les trois volets d’une œuvre hautement pataphysique, que les éditions Arfuyen proposent désormais dans son intégralité : Res rerum (2018), Manuel de réisophie pratique (2022) et ce Message réisophique, comptant 303 aphorismes numérotés.
Et par quels détours, cette quête ? Pongien, par exemple : « Nous voyons dans la pomme la main qui la cueille ». Ou franchement ubuesque : « Réunis en congrès, les réisophes ont convenu que le fil à couper le beurre était la ligne Maginot de l’imagination en même temps que l’horizon absolu de leur attente. » On arpente à ce gré le champ idéal de la réisophie ou sagesse des choses, dont l’outil privilégié est la tautologie : « Le plongeon que fait la chose dans la chose est toute la chose », déclare le poète. En écho au philosophe, pour qui « montrer implique de laisser l’apparence apparaître de telle manière qu’elle accomplisse sa pleine apparition » (Jean-Luc Marion, Étant donné).
En somme, il s’agirait d’une phénoménologie fantastique de la fermeture de l’objet sur lui-même, développée avec le plus grand sérieux par Laurent Albarracin, et allant jusqu’au renversement de la notion d’intentionnalité : « L’œil appartient définitivement à la chose vue » – non sans allusions capricieuses à l’illuminisme, au situationnisme… Et qui, au terme d’un parcours « hantologique » (Derrida) où se devinent, jamais nommés, les spectres de Nietzsche, Husserl, Wittgenstein, Heidegger, Sartre, Barthes, Derrida, Rosset et autres Marion, nous ouvrirait la clairière mystérieuse où, éteints les échos du monde, murmure seulement l’infini du langage, le jamais-dit qui gît au cœur de la poésie. Jean-Marie Perret
Pour qui prend conscience de son exil dans le langage, il n’est guère que deux manières de traiter avec le monde : soit en le parcourant à grandes enjambées, ce que font Rimbaud, Segalen ou Claudel ; soit en restant chez soi, assis sur une chaise pour mieux le laisser venir – et il vient toujours.
Roger Munier (1923-2010) a manifestement opté pour la seconde solution. Du monde, en effet, il ne semble rien connaître au-delà des limites de son jardin. Encore le dehors n’apparaît-il que sous les espèces sporadiques d’une rose, d’une averse ou d’un arbre – cet érable, par exemple, qui fournit un titre au septième volume de l’Opus incertum[1].
Comment le monde vient-il à nous ? Et comment, d’un même mouvement, nous ouvrons-nous à tout ce qui – éclats, éclairs, sentiment immédiat de la beauté… – nous en approche si intimement ? Par touches, ou notations hésitantes, comme d’une phrase qui s’interrompt, dévie, se reprend et s’achève sur un doute ou une question. Telle est en effet l’écriture de Roger Munier, qu’on sent mal assurée (incerta) et cependant haletante face à la tâche immense qu’elle s’est fixée. « Je n’ai, dit-il, pas de prise ferme sur ce que je consigne ici – et que, pour cette raison, souvent je consigne. »
Peu de pensées sont comme celle-ci travaillées par l’idée du néant. De tout côté, « le Rien » s’active, dénonce les apparences, creuse l’épaisseur du visible. Ici, il congédie le langage (« Sentir les choses sans le langage ») ; là, il ruine le sujet (« Qui peut vraiment dire “je”, parler à la première personne ? Les “personnes” ne sont personne ») ; ailleurs, il dévalue le monde (« Le monde est sans valeur… »). Partout il se fait l’allié d’une parole tendue vers une vérité émaciée qui, à travers le langage, transcende le langage même.
Projet évidemment surhumain et par essence inachevable (l’auteur y travailla jusqu’à sa mort), mais qui rappelle d’autres entreprises proches. Celles des mystiques, d’abord, dont Roger Munier fut le traducteur : Maître Eckhart et Angelus Silesius. Mais celles aussi d’auteurs très éloignés de toute mystique, hantés pourtant, chacun à sa manière, par un sentiment aigu de la finitude : Valéry, Chateaubriand ou Cioran. Peu de références, au reste, dans ces pages d’où les événements eux-mêmes sont presque totalement exclus. L’immense lecteur qu’est Munier ne devient écrivain qu’en s’affranchissant de quelques paroles contraignantes – celle de son ami Heidegger, entre autres. À cette seule condition, sa propre écriture peut entrer en résonance avec l’universel. « Tel acte de moi, telle pensée qui me vient s’inscrivent dans l’univers. Sont acte et pensée de l’univers ». Mais les quelque trois cents pages de cet Opus incertum sont écrites sous le regard de puissances surnaturelles encore autrement écrasantes, nommées tantôt Dieu, tantôt l’univers… Elles en portent le poids avec un art du retrait, de l’effacement et de la légèreté qui offre, à la lecture, l’effet d’une grâce désespérée, d’un très fervent congé donné au monde. Christian Doumet

Il n’est pas anodin que le dernier livre de Gérard Pfister s’ouvre sur une citation d’Épicure. Dans son testament, celui-ci demandait en effet qu’un banquet soit organisé chaque année en souvenir de lui, le jour anniversaire de sa naissance. Gérard Pfister s’inscrit dans cette lumière, cet esprit ouvert, comme le voulait le grand philosophe, à l’amitié, la liberté et la quête du bonheur. La référence à Épicure éclaire la voie à suivre. Elle sert d’exemple, mais ce n’est pas en son honneur, sinon par allusion, qu’il se rend dans la montagne pour ce déjeuner entre amis, à la mémoire d’un ami disparu dont on sait si peu de chose : « N’ayant rien à nous dire, nous connaissant à peine, communiant seulement dans l’humble solennité de ce jour. Sans nulle attente, dans le seul souvenir de celui que nul d’entre nous n’a connu ». De quelle montagne s’agit-il ? Aucune précision n’est donnée. On sait seulement qu’il faut cheminer sans hâte par ses sentiers jusqu’à la clairière où a lieu le repas, pour le seul bonheur d’être ensemble, « le pur plaisir d’exister » sans hiérarchie, dans l’amitié et le partage.
À chaque instant, dans l’ascension, lors du banquet, au retour, il faut être pleinement présent, dans « l’étroite immanence », goûter le simple plaisir d’être avec soi, les autres et la nature. Aussi le pèlerin donne-t-il l’impression, tous les sens aux aguets – le goût plus aiguisé encore lors de l’humble repas –, de marcher dans l’harmonie du monde, où « la grande luzule côtoie la callune et la bruyère, la bétoine se mélange aux campanules, les digitales aux verges d’or ». Plutôt qu’à une cérémonie fastueuse, c’est à un rituel sobre, libre et joyeux que sont conviés les commensaux – il y a même des enfants jouant le rôle de hiérophantes –, sans autre but à atteindre que simplement d’être là. Pas de discours, pas de leçon, toute prétention au Savoir étant désarçonnée d’un grand rire collectif. De ce banquet, de ce « moment de pure existence », chacun reviendra pourtant comme transfiguré : « À chaque instant, nous assistons à la naissance en nous d’une vie nouvelle ». Alain Roussel
Une silhouette de montagne émerge du blanc sur la couverture du livre d’Antonia Pozzi (1912-1938), un journal s’étendant de 1933 à 1938, intitulé Un fabuleux silence, traduit et présenté par Thierry Gillybœuf. Cette montagne, petite au regard de la page mais s’élevant éternellement, introduit à merveille une poésie qui attend et élève son regard vers le dévoilement d’un autre horizon. Avec, en arrière-plan, un gouffre de silence, la pudeur d’une maternité non vécue et blessée, et la mort ; car il est difficile de lire le texte sans penser au suicide de son autrice et à la brièveté de sa vie.
Ce livre bilingue permet donc, et c’est particulièrement précieux, d’entendre la voix de la jeune femme dans sa langue. Cette voix de résonance qui, malgré la douleur, chante : « solitudine e pianto / solitudine e pianto / dei làrici ». Elle fait corps avec ses sensations vives, à l’affût des échos avec le monde, créant une circulation fluide et rapide d’un vers à l’autre, entre extériorité et intériorité, comme ici, à propos d’une église : « la paix / de son grand visage / s’accumule dans mes yeux / pour regarder le soir ». Elle ne se donne pas à lire tous les jours, mais donne à voir les saisons, allant d’un paysage à l’autre, nous offrant à voir régulièrement montagnes (elle pratiquait l’alpinisme), brumes, solitude, neige, soleil souhaité, abandon Elle offre un espace d’entre-deux, entre sommeil et rêve, vie et mort, où elle semble à la fois embarquée et exilée, comme sur une barca, leitmotiv chargé de symboles dans la langue de Dante.
On est ainsi émus par la forme même du journal, où l’écriture ne triche pas, où le poème est manière d’habiter le jour, de se livrer à la page comme au vide et de baliser l’instable et l’intense. « Poésie, je me confesse avec toi / qui es ma voix profonde […] ô aide-moi à retrouver / mon haut pays abandonné ». On sort étourdis, entre légèreté et gravité, ouverts aux questions fondamentales sur le temps de son autrice, « quand au seuil extrême de l’attente / naît une aurore ». Hélène Fresnel
Si l’on devait, en quelques mots, dire pourquoi lire Alain Suied, je dirais : « Autre », « Parole », « Amour ». Et j’ajouterais : « Poésie ». L’autre, car tout poème de Suied est adressé, parle à quelqu’un. C’est-à-dire à tout ce qui est, être ou planète, autre ou soi-même. Il n’y a pas de différence. Car tout parle, car tout répond, selon Suied. Tout résonne vers nous, et en nous. Et nous ne sommes pas seuls au monde. D’où il parle, Alain Suied questionne aussi bien l’origine de ce qui est que le terme de ce qui n’est plus, et même ce que la mort peut dire, en répondant aux vivants.
Des passerelles, c’est ce que tisse sa voix. Et on saura gré au poète de dresser, ainsi, vers le ciel, sa voix comme une tour de Babel, comme une échelle de Jacob, sans autre maintien qu’elle-même. Elle parle. Nous l’écoutons. D’emblée, elle nous interpelle. Et l’autorité qu’elle impose nous fait tendre l’oreille au vent, à l’air, à l’ombre, à l’énigme qui est devant nous, et que nous remarquons si peu. Sa parole humaine est primaire, au sens qu’elle est originelle, avant toute chose, et qu’elle ressuscite, dès lors, par sa posture d’avant le monde, toute chose qui est sur terre.
Amour, aussi, car il n’y a pas, en poésie, de parole vraie ou de voix juste qui ne soit amour du vivant, de l’être, de tout ce qui vit sous nos yeux, et même de ce qu’on ne voit pas. Suied parle à tous ceux qui sont, comme à ceux qui ne sont plus, ce qui existe ici-bas, qu’on ne voit pas, mais dont on pressent la présence. L’invisible, dont il voit le seuil, et qu’il guette indéfiniment, pour mieux comprendre. Ou l’impalpable, l’immatériel, dont il interroge sans cesse les contours, les formes inquiètes, en les questionnant sans cesse. Et la poésie est ici, présente, indéniablement. Dans ses derniers livres, c’est d’ailleurs elle qu’il essaie de ressaisir, comme autre, comme parole, comme amour. Et Suied lui rend hommage, comme il l’incarne magnifiquement. Dans tous ses mots. Christian Travaux
L’œuvre poétique de Dylan Thomas a paru coup sur coup, en deux forts volumes, aux éditions Arfuyen (en 2024 et en 2025). Ce travail remarquable a été couronné du prix Nelly-Sachs de traduction. Hoa Hôï Vuong, le maître d’œuvre de cet énorme chantier, avait déjà traduit Hart Crane pour Arfuyen en 2015. De Crane en Thomas, il est une cohérence, une logique profonde, une semblable sensibilité. Que cela soit rendu possible par les éditions Arfuyen est, là encore, tout naturel. On trouve également dans cette maison les traductions fort solides de Gerard Manley Hopkins par Jean Mambrino. Crane, Hopkins, Thomas – ces poètes ont en commun d’acculer la langue à elle-même et, partant, d’en renouveler la charge expressive ou, pour mieux dire, la puissance d’arrachement.
On ne fait pas la poésie à moitié chez Arfuyen. L’œuvre poétique de Dylan Thomas est livrée en version bilingue. De même pour Hopkins et Crane ; c’est d’ailleurs une ligne systématiquement adoptée par cet éditeur. Une traduction de poème sans son texte de départ n’étant en somme qu’une moitié de poème.
Si la traduction est appelée à voler de ses propres ailes, c’est toujours dans l’élan du poème qu’elle prétend restituer. Elle s’autodétermine, même si c’est librement, dans l’originel. La traduction consiste en un acheminement du poème, et l’édition bilingue encourage le retour au texte premier, dans un nostos éperdu.
« Pas un pet de mot à peaufiner. » On no work of words. C’est un travail audacieux qui est ici proposé, d’une envergure colossale. Il existait déjà différentes traductions de Dylan Thomas en France. Hoa Hôï Vuong a eu, contrairement à ses prédécesseurs, la chance (il a su trouver cette force), de pouvoir traduire l’ensemble des poèmes de Thomas. C’est désormais selon cette totalité toute neuve que l’on peut revenir à la poésie de Thomas en France. Mathieu Jung
[1] À la demande de l’auteur, les éditions Arfuyen ont assuré la publication d’Opus incertum à partir du volume V (2008).