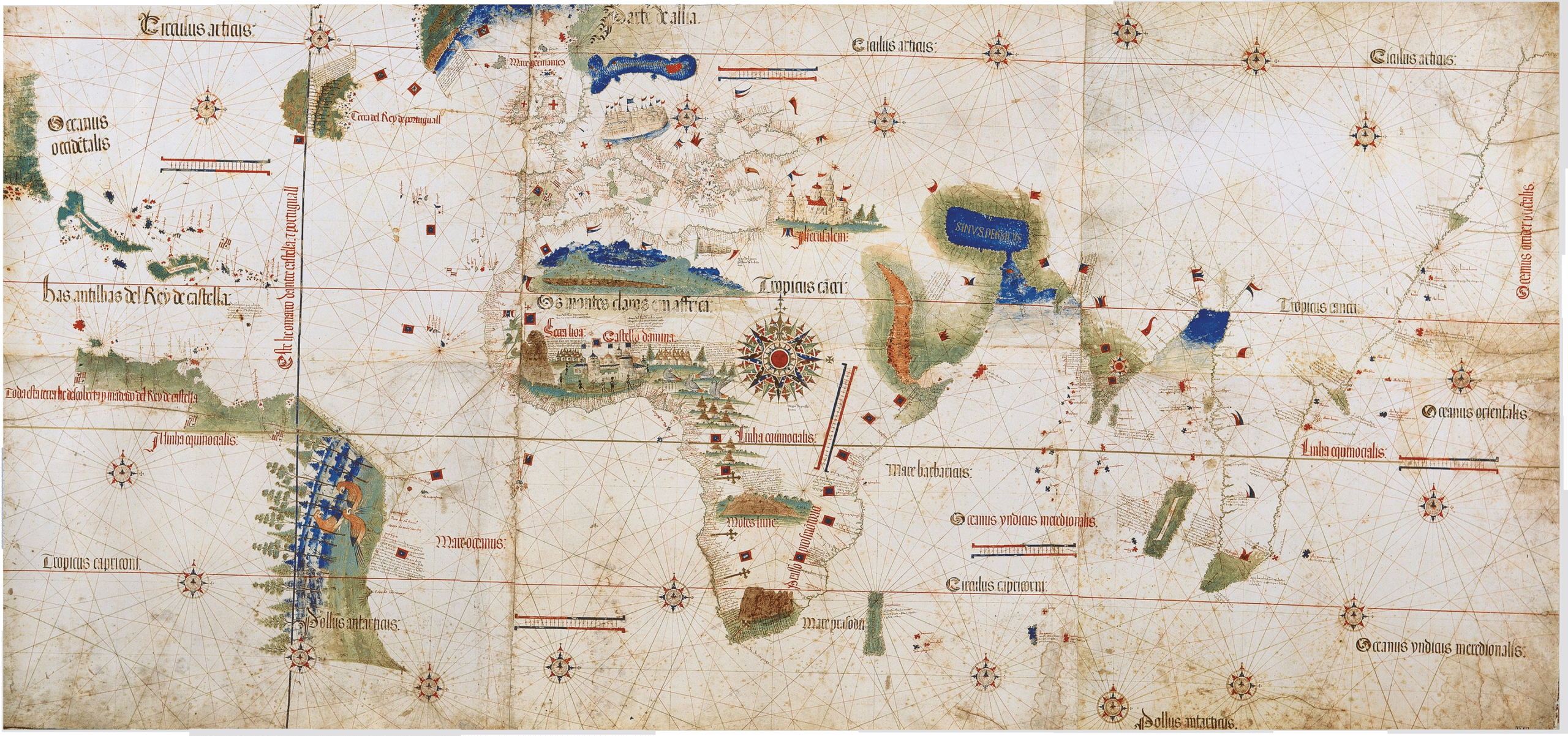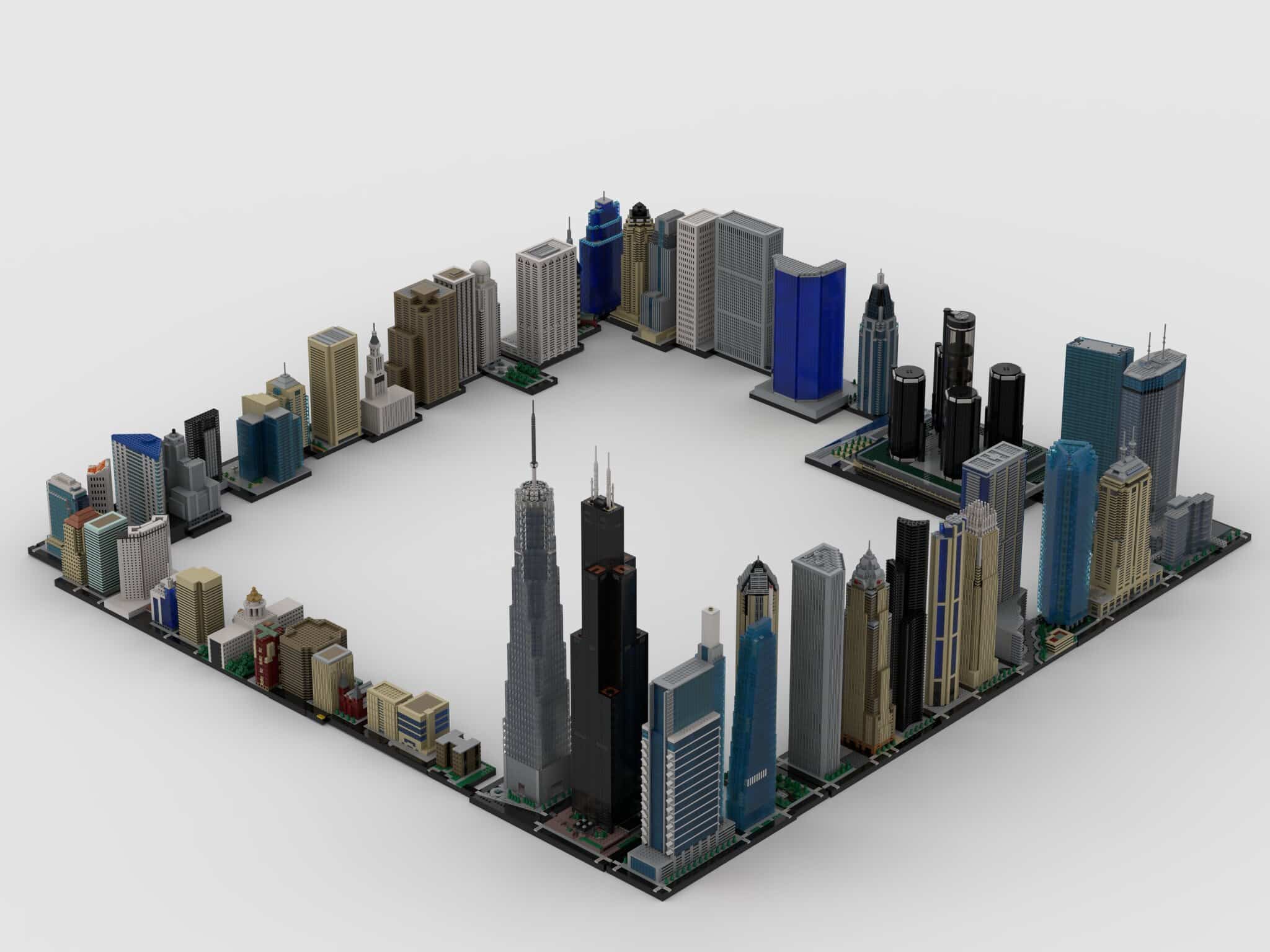Les reconfigurations des frontières, le contrôle migratoire et les modalités de la violence d’État dans l’Iran post-révolutionnaire sont au centre des recherches de l’anthropologue Chowra Makaremi. Depuis son livre Le cahier d’Aziz (Gallimard, 2011), elle cherche aussi des façons multiples de produire et de diffuser de la connaissance à travers des formes d’écriture variées : films documentaires, anthropologie visuelle, bande dessinée… avec Femme ! Vie ! Liberté !, elle décrit la révolte iranienne de l’automne 2022 sous la forme de chroniques successives. Une méthode qui conduit à un récit dense, informé et savant, cohabitant avec l’analyse personnelle. Observant à distance l’évènement qui se construit, Chowra Makaremi tente d’identifier les traces d’une préhistoire du mouvement, d’analyser les éléments infra-politiques menant à la révolte et de comprendre le basculement révolutionnaire. Ce travail total et tous azimuts d’anthropologie de la politique des affects, répondant à l’urgence de raconter et de se remémorer, est tout autant un manuel pratique des révoltes en général qu’un précis d’histoire de l’Iran réfractaire des quarante dernières années. Dans cet entretien, quarante-cinq ans après la Révolution, elle retrace sa démarche d’anthropologue-citoyenne franco-iranienne.
Boris James — Votre livre adopte la forme de la chronique plutôt que celle de la fresque socio-historique. Pourquoi ?
Chowra Makaremi — Certains ont qualifié le livre de journal, ce qu’il n’est pas. Cela rappelle par exemple l’ouvrage de l’anthropologue Michael Taussig, Law in a Lawless Land: Diary of a limpieza [University of Chicago Press, 2005], sur le nettoyage d’un territoire revendiqué à la fois par les FARC et des narco-trafiquants en Colombie. C’est une des œuvres d’anthropologie de la violence les plus reconnues de cet auteur qui, par ailleurs, a écrit de nombreux articles et ouvrages scientifiques très intéressants, notamment sur la violence de la colonisation. Il y produit, sous forme de journal, une ethnographie du conflit en Colombie. C’est dans la même perspective que j’ai cherché une forme qui me permette d’écrire ce que j’avais à écrire à partir d’une certaine posture épistémique correspondant à une démarche et à une méthode particulière.
Parce qu’elle permet d’écrire dans le désordre, la forme de la chronique me laissait ruser et rendre compte d’une multitude de genèses et de racines du soulèvement iranien de 2022 en travaillant la question de la mémoire des résistances, de la transmission des luttes. Il s’agissait d’observer à distance et de produire une recherche empirique à travers les réseaux sociaux. J’ai commencé à prendre des notes sur ce qui se passait. Il me semblait important d’explorer les réseaux sociaux car c’est en partie là que les soulèvements se déroulaient, dans le sens où ils étaient à la fois une caisse enregistreuse des évènements, mais aussi et surtout un espace public alternatif en mode mineur qui présente à la fois ses forces, ses paradoxes et ses apories. La question était celle de la volatilité et de la fragmentation de la mémoire de ce qui pouvait avoir eu lieu. Car sur les réseaux sociaux chacun a son propre « mur », son propre monde. Il y a autant de formes d’organisation des données qu’il y a d’identités digitales. Finalement, tout se partage, mais on ne partage pas une réalité du récit. Or il me semblait important de faire un récit de ce soulèvement. La question s’est beaucoup posée pour le Liban, le Chili, l’Irak : une fois que le soulèvement est terminé, qu’en reste-t-il ? Quand ce qui était présenté comme une révolution n’a pas forcément abouti dans un renversement du régime en place, quid des traces et de la mémoire des luttes ?

Pourriez-vous revenir sur la genèse de ce livre ? Quel est son objet ?
Depuis longtemps, je travaille sur la façon dont un pouvoir s’est construit en effaçant les traces de ce qui est autre que lui-même : les mémoires contraires de la révolution iranienne de 1979. Parmi les traces que j’étudiais et qui venaient compléter ou contredire le récit de la révolution, il y avait des ouvrages, publiés à cette époque au début des années 1980. C’est le travail mené avec Hannah Darabi, Rue Enghelab. La révolution par les livres [LE BAL/Spector Books, 2019]. Elle avait collectionné les jaquettes blanches, les livres interdits, les mamnue, publiés entre 1977 et 1983, dont certains étaient très précieux car ils donnaient une analyse à chaud, collant aux évènements, entrant dans la micro-événementialité de ce moment révolutionnaire. Des ouvrages nés des circonstances qui sont aujourd’hui assez difficiles à trouver, qui sont devenus des archives de seconde main. Mon but avec Femme ! Vie ! Liberté ! a été de produire une sorte d’archive. De produire à mon tour une source secondaire pour étudier et cartographier le souffle de ce soulèvement-là, depuis même sa préhistoire. De voir comment ce souffle a circulé au sein d’une société iranienne transnationale.
J’ai donc appliqué à cette situation nouvelle des outils que j’ai développés depuis des années pour étudier l’Iran post-révolutionnaire. Ces façons d’observer la situation à distance nécessitent de considérer ce qui est produit sur les réseaux sociaux comme des archives. C’est-à-dire de le contextualiser et de savoir comment cela a été produit. J’ai donc accès à un corpus, à des sources – images, récits, témoignages. Mais je prends soin de garder une approche ethnographique, de ne pas être dans une démarche d’investigation. Il n’est pas question de travailler à établir des faits. Ne pas être dans ce rapport-là au vrai. Il s’agissait d’être attentive aux rumeurs, aux imaginaires, à la circulation des émotions et des affects. C’est ce qui permet de ramener une matérialité, une dimension sensible de la révolte. II faut donc trouver sa forme d’écriture. Les formes les plus académiques et scientifiques ne permettent pas de rester au plus près de ce qui se passe dans les sociétés. Par exemple, je traite la rumeur dans la chronique du 15 octobre et lorsqu’il est question de l’empoisonnement des écolières, des vols et ventes d’organes. Ces évènements mobilisent tout un imaginaire du néolibéralisme cannibale. Les familles des victimes qui ont été tuées et kidnappées rappellent sans cesse le fait qu’il y aurait des cicatrices témoignant d’un vol de leurs organes. Essayer de saisir ces imaginaires et ces rumeurs pour comprendre quel espace politique ils dessinent, quelle est la réalité sensible, l’expérience vécue de ce soulèvement.Il faut développer une forme d’écriture qui donne plus de liberté, qui ait une dimension narrative et permette de faire des liens plus facilement.
Pour y parvenir, il faut probablement une méthode d’écriture.
En général, je pars d’un micro-évènement. Par exemple, la chronique sur les mouvements de mères part d’une vidéo postée par la mère de Satar Beheshti, cette vieille dame, Gohar Eshqi, qui se dévoile. Si j’avais à faire une chronologie de la révolte, je ne pense pas que j’y inclurais cet évènement. J’avais besoin d’ancrer cette chronique dans un évènement. Je me suis beaucoup inspirée des méthodes de montage en cinéma pour écrire ce livre. Le cinéma nécessite une économie de la longueur des plans et d’insertion des informations. On évite de répéter une information ou on crée des renvois et des appels pour que les évènements fassent référence les uns aux autres à l’intérieur d’un récit. J’ai donc mis à plat et j’ai listé tout ce dont j’avais envie de parler, en rétablissant tous les liens que j’avais observés et que je souhaitais transmettre afin de donner un contexte plus large à ce soulèvement. C’est pourquoi ces chroniques sont totalement réécrites. Par exemple, l’empoisonnement des écolières intervient de manière massive au printemps 2023, alors que les premières rumeurs à ce propos débutent au 25 novembre 2022, à un moment où je n’y fais pas vraiment attention. En outre, j’avais décidé de terminer les chroniques le 11 février 2023 [date anniversaire de la proclamation de la république islamique en Iran] et je souhaitais évoquer les politiques d’effacement de la mémoire et la circulation des rumeurs dans la chronique du 25 novembre. La technique du montage permet de construire pour le lecteur une mémoire dans le récit. Il y a une progression narrative au jour le jour et des évènements font référence les uns aux autres. Il y a une mémoire qui se crée. On va se promener dans ce soulèvement. Le découpage thématique ou chronologique n’aurait pas pu fonctionner (les femmes, les minorités ethniques, l’exclusion économique, etc. ou l’Iran dans les années 1990…). Il était important de faire une expérience de lecture qui permette de suivre des idées qui se déroulent en partant de faits qui s’ancrent de façon très sensible, qui renvoient à une matérialité du politique.

En écrivant ce livre, j’ai eu l’impression de faire un travail qui s’apparente à l’écriture des Mille et Une Nuits. J’écrivais beaucoup la nuit. Tous les jours, on écrit une histoire qui se clôt. Puis on recommence. Shéhérazade raconte pour séduire le pouvoir et pour s’acheter une durée de vie. Les chroniques du livre sont des récits adressés à une forme de pouvoir qui est le pouvoir de l’opinion publique, de la société. Aussi, je tentais d’acheter une durée de vie à ce soulèvement et de participer à sa vitalité. Il y avait également l’idée de construire une sorte de manuel de lutte, avec sa dimension pratique et une réflexion sur la temporalité des techniques et le rapport à l’espérance.
Quels sont les ressorts du mouvement qui émerge en automne 2022, leur nature aussi ?
Depuis plusieurs décennies, il existe en Iran des mouvements de contestation, de natures différentes, qui sont le fait de groupes sociaux différents : mouvements étudiants de 1999 dans une perspective réformiste, le mouvement vert cantonné à la classe moyenne contre la réélection frauduleuse d’Ahmadinejad. Le régime avait pu se maintenir grâce à sa base politique traditionaliste attachée aux martyrs de la révolution de 1979 et de la guerre Iran-Irak, ainsi qu’au projet politique de la république islamique et bénéficiant souvent des programmes d’aide. Il est étonnant qu’à partir de 2017-2018 ce sont ces mêmes milieux populaires et traditionalistes qui paraissent à l’origine de nouveaux mouvements de contestation au régime qui s’inscrivent surtout dans une demande de justice sociale et économique. Au sein de la société civile, aussi, les mouvements féministes portés par des personnes issues des classes moyennes éduquées ont été brutalement réprimés à partir de 2008. Ces activistes se sont par la suite réinvesties dans d’autres formes de militantisme en rejoignant les mouvements écologistes et étudiants, souvent dans une perspective réformiste (par exemple, la campagne Un million de signatures), ou encore la campagne en faveur du leader du mouvement vert, Mir Hussein Moussavi. Pour autant, ces différents mouvements ne reprennent pas les revendications féministes. Il faut attendre 2022 pour que ces doléances, dont étaient déjà imprégnés les militant.e.s depuis 2008, soient aussi mises en avant. Il faut ajouter à cela ce qui se passe au Kurdistan avec une longue histoire de mobilisation sociale. Les villes kurdes ont largement rejoint les mobilisations de 2019, à Bukan, Mahabad et dans d’autres localités. C’est pourquoi les commémorations de ces soulèvements de 2019 ont suscité en 2022 un très fort engagement.
En 2021-2022, l’émergence d’organisations proto-syndicales, sur fond d’hyper-libéralisation, a permis la mise en place de grèves pour protester contre la dégradation des conditions de travail, les arriérés de salaires, la précarisation et le démantèlement du droit du travail. Puis les soulèvements ponctuels des Kolbars [1] dans les régions kurdes. Toutes ces formes de contestation, de ras-le-bol, de gouttes qui font déborder le vase, apparaissaient et montraient un bouillonnement sans se rejoindre. La société iranienne restait fragmentée et certains groupes sociaux pouvaient même devenir des relais de la domination étatique, notamment à travers la xénophobie à l’égard des travailleurs migrants de l’intérieur ou des minorités nationales, et par le biais des usages patriarcaux des lois d’apartheid de genre.
Tout à coup, on a basculé hors de cette fragmentation, dans des formes de convergences et de contestations où les différents groupes se soulevaient en même temps sous des slogans distincts qui constituaient les faces d’une même pièce. « Femme, vie, liberté » était l’équivalent de « À bas la dictature de Khameneyi ». La volonté de changement de régime qui passe par l’affirmation de valeurs contraires plaçait les contestataires dans des formes de subjectivité politique positive et désirante, permettant de dépasser la fragmentation et de construire des solidarités pour un projet commun. C’est la demande commune qui fédère, et donc la bascule révolutionnaire qui modifie la donne. Ils se sont dit à eux-mêmes que le renversement était possible, envisageable et souhaitable.

Vous parlez dans votre livre de toutes les phases de silence orchestré où la société iranienne a semblé oublier la sauvagerie du régime et se tourner vers sa normalisation. Le régime de la république islamique est-il normalisable ? La « parenthèse » réformiste est-elle refermée ?
J’ai passé dix ans à essayer de comprendre les ressorts du succès de la république islamique. Elle se construit à travers la solidification de la révolution au cours de la première décennie de terreur. La guerre avec l’Irak permet de faire coïncider république islamique et identité nationale iranienne, grâce à des politiques de l’effacement. Un pouvoir fasciste né d’une révolution. C’est la dimension productrice d’ordre social de la violence que j’observe. Ça a pris du temps de le construire, notamment le pacte électoral, pilier de la légitimité du régime. En 2017, année où même moi je suis allée voter, on commentait encore la vitalité de la démocratie iranienne.
Plusieurs chroniques, mais surtout celle du 3 octobre sur l’attaque contre les étudiants du l’université Sharîf et aussi celle du 18 octobre concernant les mouvements de mères ainsi que celle du 9 février sur le communiqué de Mir Hussein Moussavi, me permettent de revenir sur le mouvement étudiant de 1999 et sur le mouvement vert de 2009, et du même coup sur les multiples trahisons des réformistes. Le projet du réformisme est intimement lié à la reconfiguration dans les années 1990 des rapports entre État et société, à travers ce processus de construction des lignes rouges dont je parle au début. Dans la phase de reconstruction après la fin de la guerre Iran-Irak, un espace public s’est rouvert, une société civile a commencé à se constituer et c’est là que la voie du réformisme a commencé à se développer. Il y a les réformistes comme groupe politique et il y a le réformisme comme façon de faire de la politique, de délimiter l’espace politique dans cette république islamique extrêmement caractérisée par ses lignes rouges. Pendant plusieurs décennies, le réformisme a été la seule façon d’exister politiquement en Iran. C’est pourquoi je parle de l’hégémonie idéologique du réformisme comme seule forme de contestation possible. C’est un paradoxe car les réformistes sont les architectes de la première république islamique : Mohamad Khatami a été le ministre de la Propagande au cours des années 1980, Mir Hussein Moussavi, Premier ministre lors du massacre des années 1990, Abdolkarim Souroush, architecte de la révolution culturelle de 1981. Tous, constatant l’aporie du régime théocratique, reviennent avec l’idée d’une conciliation nécessaire entre islam et démocratie.
Dans la chronique du 18 janvier au sujet de la grâce accordée aux prisonniers politiques, je montre que le réformisme est héritier de la politique de la terreur. Dans l’ingénierie des valeurs avec lesquelles jouent le régime et les réformistes, la modération, la prudence, la patience, les slogans de campagne de Khatami, présentés comme des valeurs positives sont opposés au courage et à la persévérance qui deviennent des valeurs négatives. Ils sont arrivés à faire passer l’idée que leur projet est celui de la non-violence, le refus de la radicalité et de l’antagonisme. J’essaie de rappeler cet ordre-là, cette économie des relations entre État et société, cette économie des formes de participation, des modalités de contestation. C’est tout cela qui s’effondre en 2022. À partir de 2017, les gens dans la rue disent : « Réformistes, conservateurs votre temps est fini ». Cela ne veut pas forcément dire que c’est la fin du réformisme. La société iranienne veut un changement de régime, mais cette société qui fait face à une répression dispose des outils du réformisme en tant que stratégie concrète d’action politique à travers des modes de négociation, des façons de subvertir, de se déporter à bas bruit, de se déplacer dans l’infra. Elle peut mobiliser cette boîte à outils-là au service d’un objectif qui n’est pas réformiste. Ce n’est pas Iran année zéro. La société iranienne a hérité de ces formes de lutte propres au réformisme et les a développées par le bas.
Un des slogans emblématiques du mouvement de l’automne 2022 « Femme, vie, liberté ! » est inspiré par le mouvement politique kurde en Turquie et d’autres parties du Moyen-Orient. L’Iran compte une importante composante kurde. Comment interpréter cet emprunt ?
J’évoque cela dans la chronique consacrée à l’enterrement de Jîna Amînî. Les conditions de possibilité du soulèvement se trouvent aussi dans le fait que Jîna est kurde. Non seulement parce que son corps supplicié est le lieu de croisement de différentes formes de violences d’État (contre les femmes, contre les minorités ethniques nationales et contre les personnes exclues économiquement), mais aussi parce que l’enterrement a lieu au Kurdistan, devenant une sorte de meeting politique embrayant sur une manifestation. Les manifestants ont commencé à scander « Jin jiyan azadî ! » comme ils l’avaient fait quelques semaines auparavant pour Sheler à Sanandaj et comme ils ont l’habitude de le faire depuis quelque temps. Comme si la mémoire des réseaux de résistance, des pratiques, les syndicats enseignants, les mouvements de femmes, les sphères d’influence du PJAK [la branche iranienne du PKK], tout cela avait dessiné une nervure, le système nerveux qui était susceptible d’être activé. Parce qu’il existait au Kurdistan cette histoire longue de résistance des colonisés de l’intérieur, ce microcosme de la société civile était déjà présent. Quelle est la place du féminisme là-dedans ? Qu’il existe, au sein d’une société aussi extraordinairement patriarcale et viriliste qu’est le Kurdistan, un mouvement de femme aussi puissant est tout à fait énorme et relève du paradoxe. C’est la dimension laboratoire qui m’intéresse ici dans le Kurdistan. Ce laboratoire d’idées politiques et de formes d’organisations politiques présentes au Kurdistan est parvenu à circuler jusqu’au centre de l’Iran, à tel point qu’on a traduit le fameux slogan (Zan, zendegî azadî) ; ce que l’on peut interpréter comme une forme de reconnaissance.

Je traite la question complexe [du nationalisme iranien et de la diversité ethnique] dans la chronique du 22 octobre sur les manifestations de Berlin à propos du drapeau, mais aussi dans la chronique du 29 septembre sur l’histoire de la contre-insurrection au Kurdistan. Tamamiyate arzî (l’intégrité territoriale), c’est le dernier pan du discours réformiste, alors que tous les autres piliers sont tombés. Il reste donc cette peur brandie de l’atteinte à l’intégrité territoriale pour délégitimer le mouvement. L’opposition frontale à la république islamique consiste forcément à faire œuvre de violence, alors que dans les faits les armes à feu n’ont pas été utilisées au Kurdistan et au Baloutchistan en dépit des milliers d’armes en circulation dans ces régions. Au moment de la coupe du monde de football, le 29 novembre, les opposants manifestent pour réclamer leur Iran qui est aux mains d’une clique. « On se battra, on mourra mais on récupérera l’Iran. » Mais de quel Iran s’agit-il ? Quel est cet Iran imaginé ? La question de la solidarité interethnique et nationale émerge, avec divers slogans mettant en avant par exemple la kurdité de Mohamad Mehdi Karimi, l’un des exécutés. Il y des choses qui bougent, notamment au sujet des réfugiés afghans. La fragmentation sociale est vraiment une technique essentielle de gouvernement du régime. Quoi qu’il en soit, il est très difficile dans un contexte de répression aussi immense de répondre à la question de la place du nationalisme dans le projet politique alternatif des opposants iraniens puisque ce projet ne s’exprime pas. Est-il même légitime de demander une feuille de route à cette opposition massivement incarcérée ou en fuite ? La chronique du 10 février évoque la déclaration des vingt groupes, syndicats et associations qui mentionne dans ses douze points le respect et la reconnaissance des droits culturels et linguistiques des minorités nationales et le libre choix de l’appartenance nationale et ethnique. Les choses restent floues. Ce qui se passe en 2022, c’est surtout l’ouverture de la pensée d’un après-république islamique. En occident, par exemple, le verrou du régime néolibéral capitaliste de prédation environnementale n’a pas encore sauté. On est incapable de penser sérieusement que ça s’arrête un jour et qu’il y a un après. Il s’est ouvert en 1979 en Iran, avec tout un tas de futurs rêvés et inaboutis des révolutionnaires. Les imaginaires politiques se sont refermés pendant quarante ans et se sont rouverts d’un coup en 2022. Donc, cela va prendre du temps pour dépasser l’autocensure, l’impossibilité de se projeter et la peur de la surveillance, pour trouver des modalités de fonctionnement, dans des formes de coalition à la fois radicales dans leurs demandes et pragmatiques dans leurs approches.
Le 17 octobre, c’est le jour de la commémoration de l’exécution de votre tante Fataneh, assassinée par le régime en 1982. Les récits politiques sont donc souvent en Iran des destins familiaux et intimes. Comment cette configuration travaille-t-elle l’infra-politique ?
La chose n’est pas du tout spécifique à l’Iran. Si tu regardes le comité Vérité pour Adama, c’est à travers une mobilisation familiale demandant la justice pour l’un des siens que les gens se sont rassemblés, ont problématisé la question des violences policières et du racisme d’État en France. Ce sur quoi je travaille depuis la publication du Cahier d’Aziz [Chowra Makaremi, Le cahier d’Aziz. Au cœur de la révolution iranienne, Gallimard, coll. « Folio essais », 2023], c’est surtout de savoir comment les relations familiales, les vécus personnels intimes, deviennent des points d’application d’un pouvoir dans sa tentative de soumettre une société à un ordre étatique. Ce témoignage me donne un récit qui permet d’ethnographier de manière fine l’institution de la république islamique à travers ses politiques répressives et comment elles déstructurent le tissu social et reconfigurent les affects et les valeurs. En 2022, quand cet ordre-là se brise, je suis aux premières loges pour pouvoir l’observer. Ma tante Fataneh a été exécutée en 1982, mon grand-père [Aziz] raconte dans son cahier, lorsqu’il apprend sa mort, comment les familles des prisonniers qui attendent à la sortie de la prison se détournent de lui parce qu’elles ne veulent pas avoir de contact visuel avec lui ou lui exprimer leur sympathie. On a le départ des politiques d’atomisation et de production de l’indifférence qui sont une constante du tissu social iranien permettant la mainmise de l’État républicain islamique. Le régime crée des zones grises entre consentement, obéissance et adhésion. Les exécutions récentes des manifestants morts en 2022 montrent que tout cela a basculé. Cette politique des affects a changé. Les façons de compatir avec les familles des exécutés montrent un dépassement de l’indifférence. Il se passe quelque chose de très profond et de très collectif. « Maman l’a su », un tag inscrit sur les murs des villes, reprend les mots de Mohamad Mehdi Karami qui dit à son père « ne le dis pas à maman » lorsqu’il apprend sa condamnation à mort. Ça veut dire que chaque manifestant, chaque contestataire s’invite dans la vie de cette famille. On est à un moment de renversement. On n’est pas encore revenu à l’atomisation. De la même manière, l’attribution du prix Nobel de la paix à Nerges Mohamadî et le texte qui l’accompagne et souligne les sacrifices immenses qu’elle a consentis pour sa lutte, à savoir l’éloignement de ses enfants, tout cela fait référence à cette façon dont les affects et les relations intimes sont mobilisés à la fois dans les politiques de répression et les politiques de résistance.
La première chronique que j’ai écrite, la chronique du 18 octobre qui concerne les mouvements de mères, la plus longue, elle fait plus de vingt pages, est la chronique matricielle du livre. J’en ai fait un centre de gravité pour acter une lecture féministe d’un mouvement révolutionnaire féministe. Pour moi, le soulèvement révolutionnaire en Iran est féministe, de par son slogan, de par les populations qui sont mobilisées, de par la demande d’égalité femmes-hommes qui est posée comme inconditionnelle. Mais il s’agit également d’un soulèvement que les outils de la pensée théorique féministe nous permettent particulièrement bien de lire.
L’historienne Nicole Loraux montre comment les mobilisations collectives s’ancrent dans des affects et elle analyse la part de la circulation des émotions dans les soulèvements. Comment les manières de se ressaisir des émotions à un niveau collectif permettent d’embrayer sur un processus politique. Le deuil fait partie de ces émotions. Il intervient en Iran dans un champs politique et discursif où il est surinvesti et sursaturé par l’idéologie d’État. Il s’agit donc de se le réapproprier politiquement. Cette articulation entre la demande de justice et la mémoire des violences était devenue le lieu d’exil d’une contestation radicale du pouvoir. Avant 2022, cette radicalité (l’incompatibilité totale avec le régime) était inaudible : la radicalité de ceux qui avaient perdu la vie dans l’opposition au régime et la radicalité de celles qui liaient leur demande de justice à cette mémoire. C’est là que le soulèvement devient révolutionnaire. Pour revenir à Foucault, on constate que la résistance part toujours du point d’application du pouvoir. Dans la première partie de mon travail, Le cahier d’Aziz, j’ai étudié la répression jusque dans l’intime comme point d’application du pouvoir. Et depuis 2022, j’observe la résistance qui part de ce même point et la politique des affects comme forme de contestation en mode mineur ; c’est-à-dire un retournement des valeurs et des affects et une contre-proposition en termes d’identité nationale qui marquent l’effondrement des piliers de la république islamique.
[1] Ces ouvriers journaliers traversant illégalement, parfois au péril de leur vie, la frontière entre Iran, Turquie et Irak, pour alimenter divers trafics – cigarettes, alcool, appareils électroniques, etc.