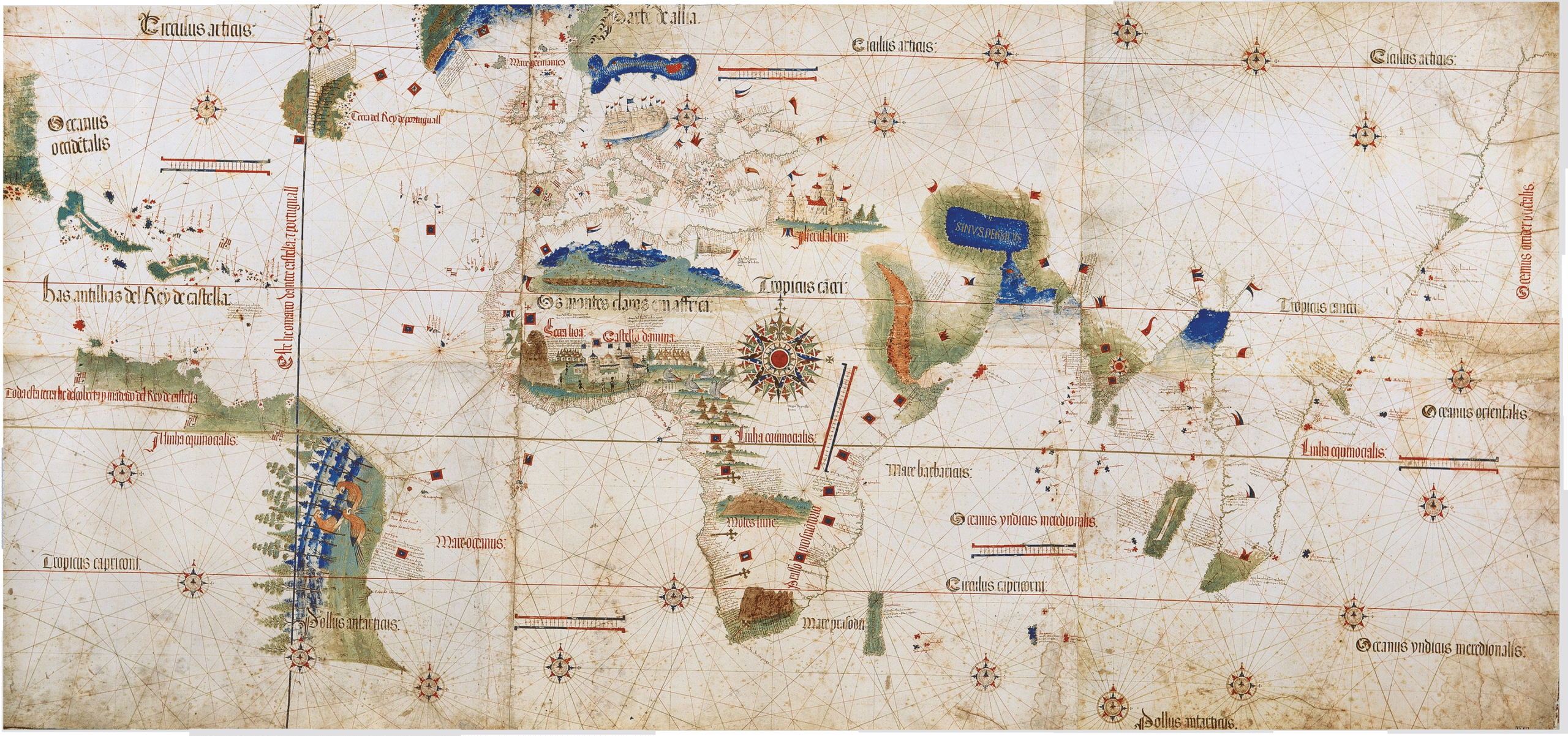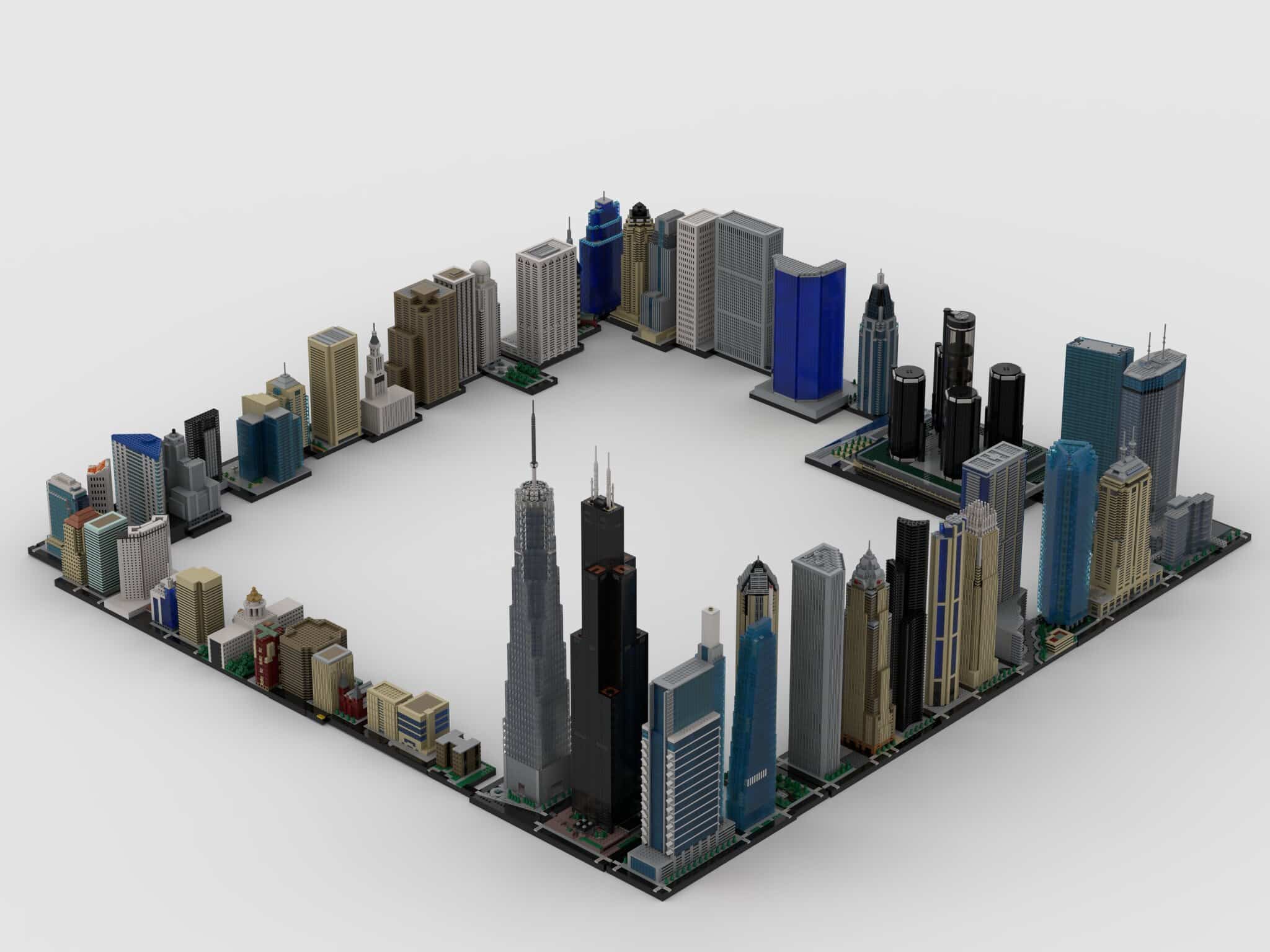Le livre de Vincent Bontems renonce d’emblée à définir son sujet. Il constate que, depuis la révolution managériale du dernier quart du vingtième siècle, le mot « innovation » a détrôné « science », « éducation », ou « recherche », dans les grands programmes d’investissement nationaux et internationaux, alors que ceux-ci avaient un sens très précis, peaufiné au cours des siècles, et que l’on peine à définir l’innovation.
En sociologue et en philosophe, Bontems se demande si le concept n’est pas d’autant plus opératoire que son contenu est vague, et il décide de traiter l’innovation comme un nom. « Le nommage », dit-il, « joue un rôle décisif dans le fonctionnement de la magie sociale, car il confère une autorité légitime à des discours qui devraient paraître arbitraires, voire futiles, s’ils ne bénéficiaient du halo symbolique dont les pare le prestige de la nomination de telle ou telle nouveauté au rang d’innovation ».
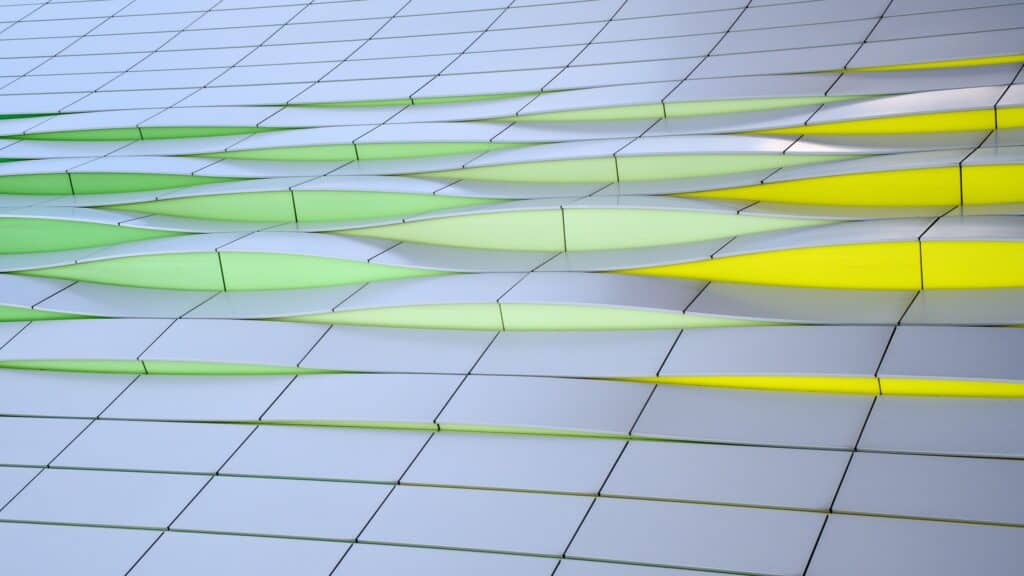
En somme, l’innovation serait la foi des temps modernes. On sait que le croyant a beaucoup de mal à définir ce en quoi il croit, et qu’il s’en remet à des rites collectifs ou à des personnalités qui ont l’air de savoir de quoi elles parlent. Une critique aussi radicale (et que je crois justifiée) laisse présager un livre aussi radical, qui exhumerait ce que recouvre ce nom et l’objet réel des différents rites qui l’entourent. Malheureusement, il n’en est rien. Le livre est une analyse du management de la recherche, tel qu’il est pratiqué dans de grandes organisations scientifiques internationales, comme le CERN ou la NASA. Ce type de recherche, centré sur la physique, est entré définitivement dans l’ère industrielle, ne serait-ce qu’en raison du capital énorme qu’il nécessite (télescopes spatiaux, tokamaks). Dans la pratique, les investissements sont dirigés par trois critères, qui sont autant de manières de concevoir l’innovation: faire mieux, faire plus vite, faire moins cher. Comme d’habitude, on ne peut pas faire les trois à la fois, il faut choisir, et le livre propose des analyses de cas qui montrent qu’ils ne conduisent pas au même résultat, et il rapporte les discussions stratégiques que ces choix impliquent au sein des organismes de recherche.
En refermant le livre, on n’en sait pas davantage, et pour cause, sur ce qu’est l’innovation, ni pourquoi le mot est devenu le sésame de notre temps. On voit bien comment la pratique managériale s’est étendue du CERN ou de la NASA aux grandes entreprises internationales comme Bayer ou Pfizer, leur permettant de négocier d’égal à égal avec les États, et de rivaliser avec la recherche publique. On voit aussi comment celle-ci, sous la contrainte de l’État, s’aligne sur ce modèle, et se transforme progressivement en suppléant de la recherche privée. On s’interroge enfin sur le management par objectifs, dont l’imagination débridée consiste à prolonger le présent. Car enfin, si l’innovation consiste à faire ce qu’on sait déjà faire, mais mieux, plus vite ou moins cher, il y a lieu de s’inquiéter sur ce que le mot recouvre. Ce ne sera certainement pas un saut dans l’inconnu.