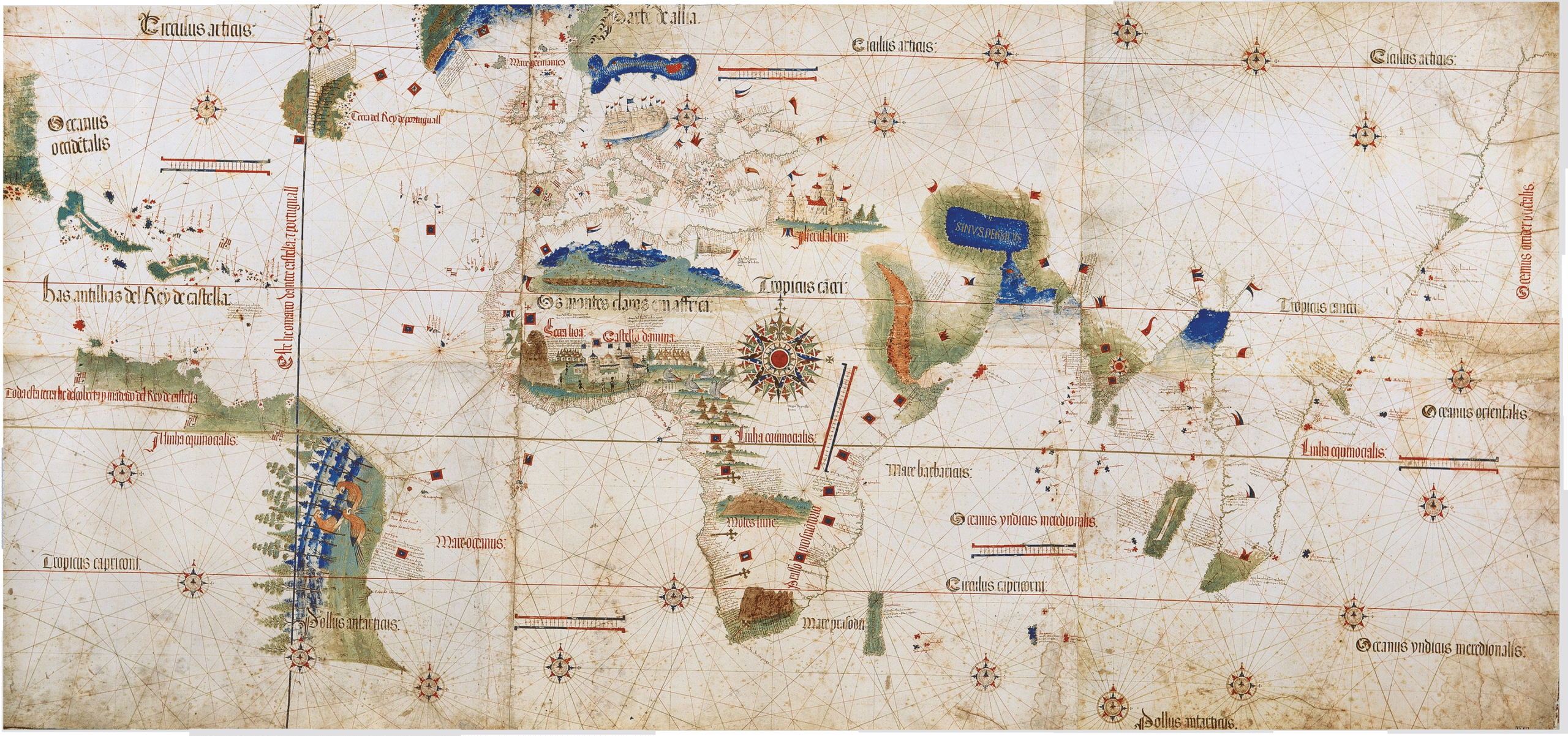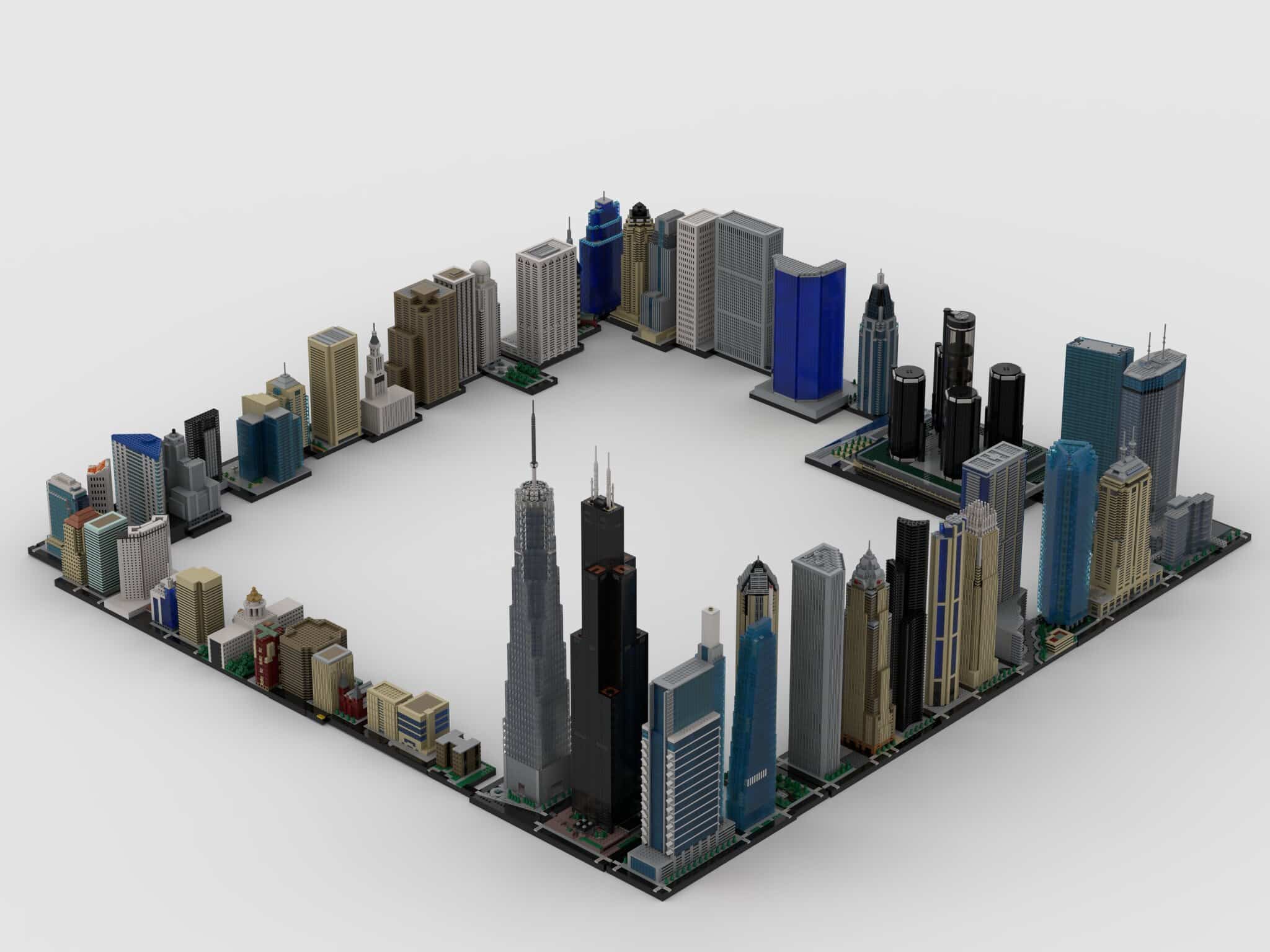Dire du pari de Bernard Lahire, tenir compte des enseignements de l’histoire des sciences pour renouveler la sociologie, qu’il est ambitieux relève de l’euphémisme. Il s’agit ni plus ni moins dans Les structures fondamentales des sociétés humaines que d’inventer un autre chemin pour les sciences sociales, quitte à bousculer ce qui était tenu pour définitivement acquis. Il ne serait dès lors guère surprenant que les gardiens du temple refusent un examen serein des riches propositions de l’auteur, tant la discipline semble se complaire dans la répétition du geste initial (et fondateur) de rupture avec la biologie (et avec la psychologie).
Un autre chemin que d’autres auparavant avaient emprunté, dans une volonté d’arrimer les sciences sociales aux sciences de la vie, mais que l’histoire de la sociologie a marginalisé. Il est vrai que la pente est escarpée : nombreux furent ceux qui ont cherché dans les lois de l’évolution le sésame explicatif de celles du social. Mais, alors que les durkheimiens, Célestin Bouglé surtout, ferraillaient (légitimement) contre la sociologie biologique et sa naturalisation des inégalités sociales, Alfred Espinas avait, peu de temps avant (en 1877), proposé une analyse intitulée Des sociétés animales. Étude de psychologie comparée dont l’enseignement fondamental, le fait social est un trait biologique très général (donc, qui vaut aussi bien pour les premiers groupements de cellules que pour les sociétés humaines), est au principe du projet de Lahire. Comment, se demande-t-il, à l’instar d’Espinas, pourrions-nous découvrir les lois de la vie sociale par la seule observation de l’homme, indépendamment de toute comparaison avec les autres manifestations de la vie sociale dans le reste de la nature ? Mais, à la fin du XIXe siècle, il ne fallait pas, afin, pensait-on, de sauver l’autonomie de la sociologie, que la question fût posée.

C’est la perspective comparatiste qui permet de dégager l’une des grandes spécificités humaines, spécificité qui, loin d’alimenter la thèse de l’exceptionnalité, se fonde sur ce qui caractérise le développement ontogénétique de l’espèce, ce que Lahire nomme, à la suite du zoologiste Adolf Portmann (en 1956), altricialité secondaire pour désigner notre naissance prématurée et la lente croissance extra-utérine du bébé humain. Cette lenteur de la croissance entraîne une longue période de dépendance, à l’origine des rapports sociaux fondamentaux, ceux de dépendance/domination (qui ont structuré les rapports économiques, politiques, religieux, amoureux, etc.). L’idée rappelle, sans se confondre avec elle, celle de l’anatomiste hollandais Louis Bolk qui, en 1926, avait parlé de néoténie pour insister sur la prématuration et la lenteur du développement humain. Mais, étrangement, Bolk élaborait à partir de cette réalité une hiérarchie fondée sur des critères raciaux, hiérarchie absente chez Portmann et, évidemment, chez Bernard Lahire.
Prendre en compte des propriétés biologiques pour comprendre leurs conséquences sociales ou leurs corrélats sociaux, ce que Bernard Chapais, auteur largement cité dans l’ouvrage, nomme « la structure sociale profonde », ou ce qu’Alain Testart, lui aussi souvent convoqué, qualifie de « science générale de la société », voilà un choix épistémologique fort rare en sciences sociales. Et, pour justifier l’entreprise, Lahire n’hésite pas à parler d’invariants. Il place sa réflexion sous les auspices d’Alexandre Grothendieck, longuement cité en exergue du chapitre 2 : « S’il est une quête incessante qui a marqué toute mon œuvre, c’est celle de l’unité, à travers la multiplicité infinie des choses mathématiques et des approches possibles vers ces choses ». Et il poursuit : « Découvrir cette unité au-delà de la diversité […], reconnaître les traits communs au-delà des différences, et aller jusqu’à la racine des analogies et ressemblances pour découvrir la parenté profonde, telle a été ma passion, ma vie durant ». Comme le précise encore le mathématicien, les « différences ont fini par apparaître comme les branches […] d’un même arbre […], et chaque branche, chaque rameau me montrent le chemin vers le tronc qui leur est commun ». Ce qui vaut pour les mathématiques vaut pour l’anthropologie : faire l’inventaire des variations doit servir à découvrir les mécanismes de la variabilité (« les bases invariantes de la variation », écrit Lahire), comme l’énonçait, dès 1974, Dan Sperber.
C’est donc largement contre l’épistémologie dominante dans les sciences sociales contemporaines, constructiviste et nominaliste, que Bernard Lahire élabore, grâce à une impressionnante connaissance des travaux les plus récents dans des domaines fort éloignés de sa compétence première, une fresque dont il faudra dire, quelles que puissent être les inévitables remarques critiques sur tel ou tel point, pourquoi l’on s’en émancipe (comme Robert Nozick le recommandait aux lecteurs critiques de la Théorie de la justice rawlsienne). Il y a néanmoins fort à parier que les adversaires de l’entreprise préfèreront le rejet sans examen.
Certains reprocheront sans doute à l’auteur la distance prise avec ses amours anciennes. Ainsi, on mentionnera le recul critique à propos des principes épistémologiques de Jean-Claude Passeron, recul qui est pourtant la conséquence logique de l’armature conceptuelle de l’ouvrage. Comment Lahire pourrait-il, aujourd’hui encore, approuver la mise en garde de Passeron selon laquelle toute tentative de formulation de lois sociologiques est vouée à sombrer dans « une vaine quête des essences ou des instances ultimes » ? Non seulement des lois peuvent être dégagées, en particulier par la comparaison, entre les différentes sociétés humaines et entre celles-ci et les sociétés non humaines, mais cette recherche n’est pas celle d’une quête des essences, tout simplement parce que les lois décrivent des processus et donc s’inscrivent dans une perspective dynamique.
L’importance des structures biologiques n’occulte aucunement celle de l’accumulation culturelle. Car s’il est incontestable que le social ne caractérise pas l’espèce humaine (d’innombrables travaux documentent les comportements sociaux des animaux non humains : exogamie, division du travail, procédures de réconciliation…), la cumulativité culturelle (le fait que chaque génération bénéficie des acquis des précédentes) est, dans notre espèce, incommensurable (bien que des phénomènes de transmission culturelle soient observés dans d’autres espèces). Le psychologue et primatologue Michael Tomasello parle à ce sujet d’« effet cliquet ». La cognition humaine se déploie à la fois dans le temps phylogénétique (où notre espèce apprend à développer une manière spécifique de comprendre ses congénères), dans le temps historique (où elle crée des artéfacts matériels et symboliques) et dans le temps ontogénétique (où les bébés humains absorbent tout ce que la culture met à leur disposition et développent des modes spécifiques de représentation cognitive).
Bernard Lahire s’inscrit dans la même perspective que Tomasello : contribuer à une définition de l’humain à partir d’un ensemble de traits qui, si aucun ne lui est spécifique, autorisent à parler d’une rupture au sein du vivant. Rupture qui doit évidemment non pas placer l’humanité hors de la nature mais en son sein.
Dans ces conditions, il devient possible de parler de nature humaine. L’expression est souvent, tout particulièrement dans les sciences sociales, l’objet d’un fort soupçon. On peut le comprendre : il est rare que l’invocation de la nature humaine n’ait pas servi à justifier l’exclusion de composantes de l’humanité. Il nous semble pourtant possible de justifier l’emploi de ce concept, à condition de l’historiciser. C’est exactement ce que propose Lahire : « Replacée dans la très longue durée de l’évolution, qui se compte en centaines de milliers d’années plutôt qu’en siècles, la “nature humaine” existe bel et bien, avec ses grandes propriétés biologiques et sociales, structurée par des lignes de force qui lui sont propres et soumise à des lois sociales générales ». De surcroît, si l’on insiste sur son caractère virtuel, et donc sur le fait qu’elle s’actualise culturellement, on comprend que plusieurs manières d’être humain sont toujours possibles. Les caractères distinctifs de notre espèce font certes l’objet d’un programme inscrit dans un génome, mais ce programme se limite à définir « un ensemble cohérent de virtualités en attente d’effectuations » [1]. Parler de nature humaine ne revient donc pas à oublier que le destin de notre espèce est d’avoir pour mode d’existence la culture et l’histoire.
L’une des questions que soulève l’entreprise de Bernard Lahire, et qui explique que nombreux sont ceux qui s’en tiendront éloignés, est celle de la conciliation entre l’existence d’invariants sociaux et la perspective de l’émancipation. Pourtant, il semble aisé de combattre cette réticence. Spinoza distingue libre arbitre (qu’il considère comme intenable) et liberté. Pour lui, la connaissance de ce qui nous détermine nous permet de moins subir, de ruser avec ces déterminismes et d’accomplir notre nécessité propre. La liberté ne s’oppose donc pas à la nécessité (elle est la nécessité comprise et agie en connaissance de cause), mais à la contrainte. Est libre l’être agissant selon la nécessité de sa propre nature ; contraint, celui qui est déterminé à agir par une nécessité extérieure à la sienne (voir Lettre à Schüller et Éthique III, proposition 2). La connaissance de la réalité apparaît donc comme une condition de l’émancipation : « S’il est important d’établir des lois, ce n’est pas pour glorifier leur caractère éternel ou baisser les bras devant le spectacle des multiples inégalités […], mais pour pouvoir imaginer comment s’en dégager, comment les maîtriser et ne pas en être les victimes inconscientes ».

Bernard Lahire n’ignore évidemment pas que le recours aux sciences du vivant suscite une méfiance, instruite par des tentations réductionnistes récurrentes. L’une des plus fameuses est celle de la sociobiologie, laquelle, comme son nom ne l’indique pas explicitement, est fondée sur le déterminisme génétique et ses supposées conséquences sur les comportements humains. Mais Lahire se tient totalement éloigné du paradigme génétique et fonde son projet, pour l’essentiel, sur la biologie de l’évolution et sur l’éthologie. Il ne prête d’ailleurs nullement le flanc à l’accusation de réductionnisme car il ne prétend pas expliquer les faits sociaux par le biologique. Le recours à celui-ci sert seulement à délimiter le champ des possibles. Il cite d’ailleurs un auteur injustement oublié, l’anthropologue Alexandre Goldenweiser, et son intéressant principe des possibilités limitées : si les coutumes de la tribu A peuvent ressembler à celles de la tribu B, c’est uniquement parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de façons d’accomplir certaines choses [2].
Complémentairement, le principe DIP (devoir implique pouvoir) (que, sauf inattention de notre part, Lahire ne mentionne pas) présuppose qu’il serait inhumain de définir le devoir indépendamment de ce qu’un être humain est effectivement capable de faire (ce qui implique qu’il y aurait aussi des raisons morales de rechercher les bases naturelles de nos capacités morales). Notre réflexion doit alors être instruite par ce que l’on sait de nos capacités naturelles. Il existerait ainsi un principe de réalisme psychologique minimal, lequel implique de « limiter les conceptions normatives à celles qui pourraient être réalisées par un Homo Sapiens biologiquement normal et rester stables dans certains arrangements sociaux possibles » [3]. Le principe DIP définit donc ce qu’un être appartenant à l’espèce humaine est censé pouvoir faire. Il s’oppose à l’idée de la malléabilité infinie, idée, au moins implicitement, répandue dans des sciences sociales attachées à montrer la puissance de l’environnement sur les comportements, alors qu’elle est la fantasmatique tentation des régimes totalitaires. Par de très nombreux exemples, Lahire contribue à discréditer cette illusion (voir, notamment, « L’homme et la page blanche »).
Cette orientation n’implique-t-elle pas la possibilité d’universaux transculturels ? Bernard Lahire examine cette question, et il semble considérer que la recherche des universaux participe du même esprit que celle des invariants à laquelle il souscrit. Il cite de nombreux auteurs à l’appui de cette thèse, notamment Christoph Antweiler [4] pour qui la recherche d’universaux transculturels n’est pas autre chose que l’exploration empirique de l’unité de l’humanité et, à ce titre, contribue à donner des fondements substantiels à l’antiracisme. Cependant, il conclut l’examen par une référence à la distinction de Françoise Héritier entre invariants et universaux, la quête de ces derniers relevant, selon l’anthropologue, de l’entreprise philosophique. Mais existe-t-il de bonnes raisons de tenir cette dernière à distance, comme si elle n’avait rien à nous apprendre sur l’universel ?
On a d’autant plus de raisons d’en douter que la profession de foi réaliste de Lahire (on a dit son opposition au nominalisme) prendrait plus de consistance encore en endossant l’hypothèse de l’existence d’universaux [5] (dont on connait le rôle dans la querelle du nominalisme, soit, en simplifiant, l’affrontement entre Duns Scot et Guillaume d’Ockham). Mais sans doute la méfiance de l’auteur à leur égard ne vaut-elle qu’à propos des inventaires non classés, non hiérarchisés, et surtout non problématisés. Nous touchons là à l’une des rares limites de cette œuvre magistrale : l’absence de références aux travaux contemporains en philosophie analytique (et, sur ce point précis, à la pensée de David Armstrong). Ces travaux, et tout particulièrement ceux qui appartiennent à la métaphysique scientifique réaliste (dont Claudine Tiercelin est la principale représentante en France), procèdent de cette volonté, brillamment défendue par Lahire, d’exercer leur discipline dans un constant dialogue avec la science. Il ne s’agit évidemment pas de faire de la philosophie ou des sciences sociales les servantes de la science, mais de mettre l’explication en harmonie avec les données de l’expérience, ce qui équivaut à considérer que la science se limite, mais c’est beaucoup, à déterminer le champ des possibles. Ainsi que le soulignait Wilfrid Sellars, ne confondons pas l’idée juste que la philosophie n’est pas la science avec l’idée fausse qu’elle est indépendante de la science. C’est cette recommandation qu’a suivie Bernard Lahire dans un travail qui, à n’en pas douter, constitue une étape décisive dans la compréhension de ce que nous sommes.
[1] Jean Baechler, Qu’est-ce que l’humain ? Liberté, finalité, rationalité, Hermann, 2014, p. 17
[2] Alexandre Goldenweiser, «The Principle of Limited Possibilities in the Development of Culture », The Journal of American Folklore, vol. 26, no 101, juillet-septembre 1913, p. 259-290
[3] Owen Flanagan, Psychologie morale et éthique, PUF, 1996, p. 43
[4] Christoph Antweiler, « Cosmopolitanism and Pancultural Universals: Our Common Denominator and an Anthropologically Based Cosmopolitanism », Journal of International and Global Studies: vol. 7, no 1, 2015, p. 49-66