Manifestement nous ne sommes plus capables de grandes querelles, de grandes disputes. De celles qui mobilisent les masses, condamnent, exilent, relèguent. Aujourd’hui, l’impuissance du pouvoir, contrairement aux apparences, est telle qu’il n’est en position que d’organiser un colloque, compulsion favorite des universitaires (la « colloquite », maladie dénoncé jadis par Jacques Le Goff), pour dénoncer un nouvel « athéisme », la « déconstruction ».
En janvier 2022 s’est tenu un colloque à la Sorbonne intitulé « Que reconstruire après la déconstruction ? », organisé par le Collège de philosophie (à ne pas confondre avec le Collège international de philosophie, dont Derrida fut membre fondateur) et l’Observatoire du décolonialisme, avec le soutien du Comité Laïcité République. Ces institutions se veulent les vigiles de la République, gardiens autodésignés des « valeurs » d’icelle, les empêcheurs de « séparatismer » en rond, et c’est à ce titre qu’ils ont chargé le canon « colloque » d’un obus censé diagnostiquer les dangers d’une déconstruction ayant débordé ses rives (vers le wokisme, l’intersectionnalisme, l’islamo-gauchisme, le néoféminisme, etc.) ‒ à la métaphore de la crue, il faut ajouter celle du virus et de l’épidémie ‒ et répandant ses eaux dans tous les domaines, politique, culturel, l’éducation et les arts. Puis, une fois établi le constat des ruines amoncelées, envisager, bien que cette pars construens apparaisse moins clairement, la reconstruction, en ayant le toupet de se réclamer de Paul Ricœur, qui se demandait « comment reconstruire après la déconstruction ».
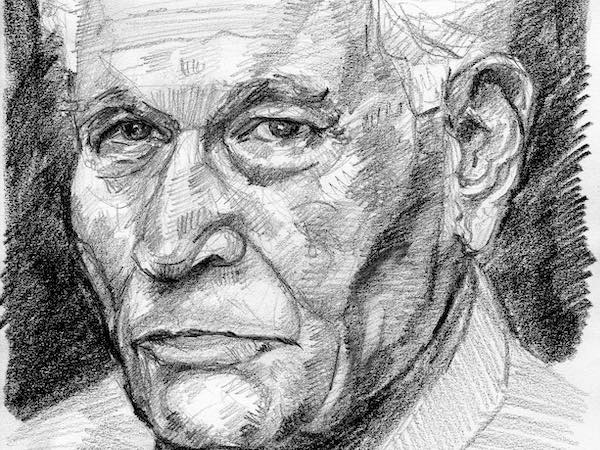
La finalité de la manifestation sorbonicole était, selon les organisateurs, triple : dénoncer une menace contre la recherche, la « déconstruction » exerçant un magistère délétère sur les sciences humaines et sociales ; démasquer un postulat : le réel n’est qu’un champ de domination ; enfin, dégager un horizon de reconstruction. Réactivant, plus de trente ans après, la dynamique critique engendrée, en 1985, par la publication de La pensée 68 (Gallimard), il fallait démontrer que la déconstruction était entrée dans son troisième âge, après Descartes et Kant, après Nietzsche, se caractérisant, non pas comme les deux autres par la dialectique entre une phase destructrice et une phase constructrice, mais par le fait qu’elle ne viserait qu’elle-même, tournant sans fin dans la négativité, là encore, d’un triple constat : tout est domination, tout est colonialisme, la décolonisation est une illusion. Cette réunion, qui proclame avoir voulu éviter les anathèmes, voulait favoriser « les conditions d’un pluralisme éclairé qui interdise à toute idéologie de s’imposer comme dogme moral contre l’esprit critique. Car il s’agit avant tout de favoriser la construction, chez les élèves et étudiants, des repères culturels fondamentaux ».
L’écrivain Philippe Forest énonce bien les enjeux de cette pulsion reconstructrice dans Déconstruire, reconstruire. La querelle du woke (Gallimard, 2023), livre dont, par ailleurs, les directeurs du volume Qui a peur de la déconstruction se démarquent. Il soulignait qu’il « importe moins, contre l’opinion unanime, de reconstruire enfin ce qui avait été hier déconstruit que de déconstruire encore ce qui prétend se reconstruire aujourd’hui ». C’est bien pourquoi les auteurs du livre qui nous intéresse aujourd’hui se tiennent à l’écart de toute prétention à la reconstruction. S’ils répondent au colloque accusateur par un colloque justificateur, c’est qu’il leur est imposé par les impératifs de la fameuse « visibilité » médiatique et parce que, universitaires, ils n’ont à leur disposition aucun autre type de riposte. L’identification du symptôme (qui a peur de la déconstruction ?) fait écho au prurit de reconstruction.
Mais ce travail d’analyse (au sens freudien du terme) ne réplique pas au colloque nettoyeur ; il ne répond pas, comme un moteur, mécaniquement, répond ou non sous les pédales de son usager, par la logique de l’après : après la guerre, la paix, après la ruine, la relève. Dans un geste derridien, ils préfèrent la logique de ce qui « vient », de l’évènement : après, personne ne sait ce qui vient, pas plus les planificateurs du « redressement » (rhétorique que de fois criminelle), que les activistes du programme de l’émancipation générale qui s’installent dans une assurance dominatrice. Mais il est une autre raison, liée au « qui vient » de l’avenir, de ne pas s’engager dans la logique de l’avant et de l’après, raison qui tient de près à la déconstruction. Elle s’exprime dans « la lettre à un ami japonais » (in Psyché. Inventions de l’autre, Galilée, 1987), texte dans lequel Derrida précise le sens de la déconstruction pour en éclairer la traduction japonaise. La déconstruction n’est ni une analyse (régression jusqu’à l’élément simple), ni une critique (au sens kantien), ni une méthode : « la déconstruction a lieu, c’est un événement qui n’attend pas la délibération, la conscience ou l’organisation du sujet, ni même de la modernité. Ça se déconstruit […]. C’est en déconstruction ». Autrement dit, aucun ordre, fût-il révolutionnaire, aucune (re) construction, encore moins une restauration, ne résiste à sa propre déconstruction, non seulement dans le temps, mais dans ce qui fait son propre et sa propriété. Marta Hernandez Alonso, Ginette Michaux et Danielle Cohen-Levinas le rappellent opportunément dans leurs interventions.
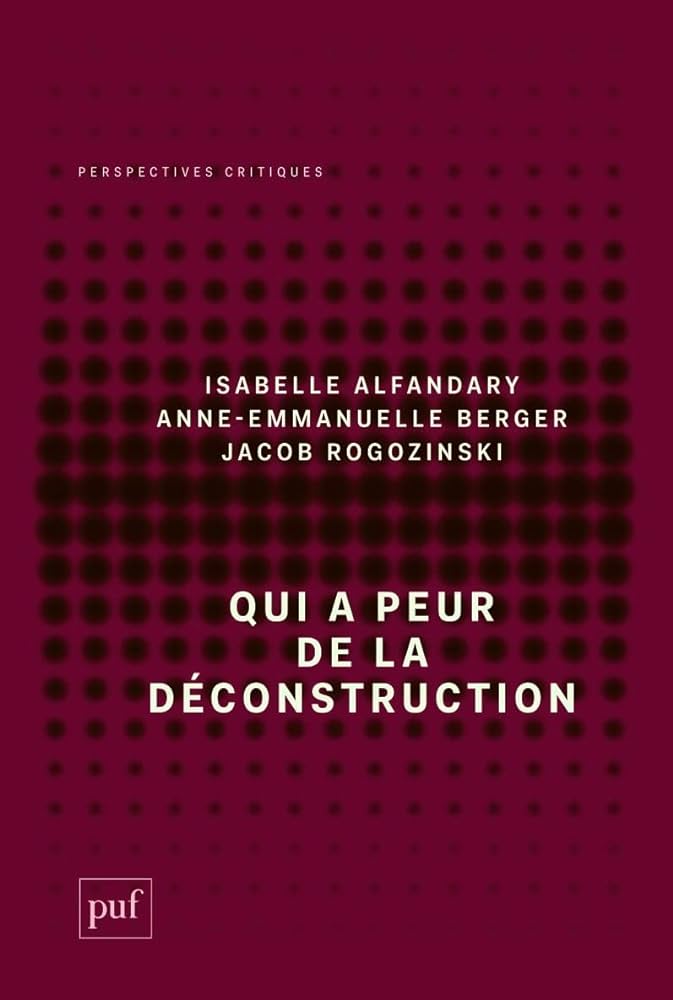
L’objectif principal de Qui a peur de la déconstruction est de clarifier de quoi il s’est agi avec la « déconstruction ». À peu près tous les textes du collectif s’y emploient. Il ne peut être question de confondre le travail philosophique d’un Derrida avec son instrumentation dans des luttes politiques ou sociales. Ils plaident pour l’existence de « plus d’une » déconstruction, soulignant avec Denis Kambouchner l’extrême précaution du déconstructeur présumé, son attachement aux situations, aux contextes, aux chaînes lexicales, etc. La contribution de Seloua Luste Boulbina éclaire les « souterrains » biographiques des origines de la déconstruction, tandis que Danielle Cohen-Levinas et Raphaël Zagury-Orly insistent sur la question de la langue. Dans les deux cas, c’est l’Algérie qui est désignée comme expérience fondamentale d’une déconstruction vécue (le fameux : « je n’ai qu’une langue et ce n’est pas la mienne »). Ces interventions font diversement écho aux analyses de Pierre Vermeren, qui, dans le colloque de 2022, concluait lui aussi sur le rôle crucial de l’Algérie dans cette histoire.
L’ensemble des articles donne raison à ce qu’écrivait Jean-Luc Nancy dans La déclosion (Galilée, 2005) sur l’inscription de la déconstruction dans la tradition, loin d’être un virus, ou alors c’est la philosophie dans son histoire qui représente un danger (et nous voilà retournés au début de ces lignes). Ce qui rend d’autant plus importante la question de savoir « qui a peur de la déconstruction ». Et sur ce plan, il faut exprimer une certaine déception : si les textes réunis répondent en creux à la demande, ils ne l’abordent pas de front. Cependant Marc Goldschmit et Étienne Balibar s’y coltinent. Sans désigner qui a peur, ils s’efforcent de définir le pourquoi d’une telle peur, l’un en suggérant un sentiment de culpabilité devant la difficulté d’être « à la mesure de l’impossible et de l’événement », l’autre en s’interrogeant sur un certain embarras à « conjurer » la violence potentielle d’une justice sans cesse différée. Répondre au pourquoi de la peur, c’est demander quelle place peut avoir la déconstruction dans l’Histoire : un moment sceptique comme il y en a eu dans l’histoire de la pensée, immédiatement suivis d’un moment dogmatique ? Un jeu avec le négatif ne visant que lui-même ? L’invention d’une boite à outils pour la lutte « politique » ? Rien de tout cela, mais le soulèvement de toute la tradition pour tenter, peut-être (cet adverbe si important chez Derrida), de donner une chance à l’événement de la justice.












