Zanzibar… Le nom seul fait rêver : navigation, commerce, aventure, mélange des cultures, entourés de sable blanc et d’eau turquoise. Dans son nouveau roman, le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin en trace un tout autre portrait. La princesse de Zanzibar décrit une société entièrement bâtie sur l’esclavage et la cruauté. Mais, même au sein du plus grand malheur, certains êtres se creusent des espaces de liberté. Par la maîtrise des histoires, comme la conteuse Uhuru, ou par la passion amoureuse, comme l’eunuque Sundus. Après Le messie du Darfour et Les Jango, Abdelaziz Baraka Sakin fait une nouvelle fois entendre une voix unique par la liberté et l’humour avec lesquels elle donne vie et lumière à des destins très sombres. Méprisés, torturés, massacrés, ses personnages sont toujours traités dans ses romans en frères et sœurs précieux.
Abdelaziz Baraka Sakin, La princesse de Zanzibar. Trad. de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin. Zulma, 352 p., 22,90 €
Dans les premières pages du roman d’Abdelaziz Baraka Sakin, un sorcier calcule l’âge réel du sultan de Zanzibar : c’est le même que celui de Satan lorsqu’il refusa l’ordre divin de se prosterner devant la créature de Dieu, « l’Humain ». Le ton est donné : récits tirant vers le conte et le mythe, superstition, comique et déni d’humanité entrelacent satire de l’oppression et bonheur de raconter. La première moitié du roman dessine sur l’île le crépuscule d’un conte de fées pourrissant. On y suit la princesse, fille du sultan, parangon de la classe dirigeante d’origine omanaise qui vit dans le luxe et les plaisirs, grâce à une foule d’esclaves lui évitant le moindre effort.

Abdelaziz Baraka Sakin (décembre 2022) © Jean-Luc Bertini
L’ironie permet de peindre un monde de faux-semblants où la richesse outrancière repose sur une cruauté extrême. Pour les faire croire à l’abri de la maladie et ainsi augmenter leur valeur marchande, on y trace sur les esclaves de fausses marques de variole. Quand la princesse va acquérir un nouveau bijou, elle achète surtout de quoi se désennuyer : une belle histoire, un coup d’œil sur la bonne société européenne incarnée par une improbable « duchesse de Padoue ». Mais, balayant brutalement l’illusion de la négociation, elle ne cesse de baisser le prix jusqu’à ce que le marchand finisse par rester silencieux. Fille du sultan, elle impose son pouvoir. Le bijoutier prendra sa revanche sur l’esclave qui active son soufflet, « morceau de chair noire », dont le dos ressemble « à un vieux filet de pêche à force de recevoir brûlures et coups de fouet ».
Les captifs ne possèdent même pas leur corps. Arraché avec son père à son village par des chasseurs d’esclaves commandés par le célèbre Tippo Tip, le jeune Naanu est privé de son nom pour devenir Sundus, et aussitôt castré. Parce qu’il a aidé Livingstone, Stanley ou Emin Pacha, Tippo Tip a joui d’une aura exotique en Europe, mais Abdelaziz Baraka Sakin donne la vision qu’ont de lui les Africains. Ils le surnomment autrement : c’est le féroce « Léopard ». Et il suscite une si grande terreur qu’il devient son propre fantôme, bien qu’il ne soit mort qu’en 1905, c’est-à-dire théoriquement après les événements racontés dans le roman (la princesse naît en 1855).
Cependant, l’auteur maintient le flou, brouille les repères historiques, aux lisières du fantastique. Si des dates précises scandent la chute des sultans de Zanzibar au profit des Anglais, son livre n’est pas une chronique. La structure des romans d’Abdelaziz Baraka Sakin joue avec souplesse, ne fige jamais l’intrigue, toujours prête à prendre une direction nouvelle. La princesse de Zanzibar est avant tout l’histoire de l’amour de Sundus et de la princesse.
Une fois l’esclavage aboli par les Anglais, sur l’île le parfum de « santal, girofle et gomme s’était mué en pestilence immonde » puisque « les éboueurs et les ramasseurs de merde avaient tout laissé pourrir sur place ». Les deux amoureux, eux, ont suivi des révolutionnaires sur le continent. Le roman rétablit une circulation possible entre Zanzibar et l’Afrique.
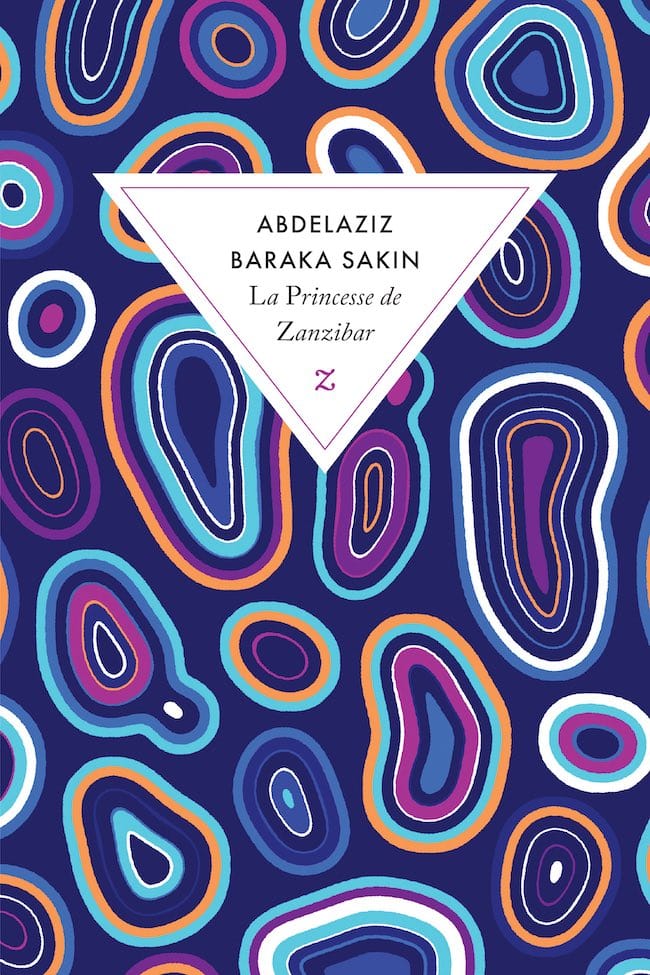
Si le village où arrivent Sundus et la princesse peut sembler plus bienveillant que le sultanat esclavagiste, l’intolérance y prend d’autres formes. Parce que la tribu de Sundus a été dispersée par les chasseurs d’esclaves, elle est considérée comme maudite. Privé de son membre viril, Sundus est réputé avoir « l’âme incomplète », autant que la princesse, qui a été excisée. Et si, pour récupérer les morceaux d’eux-mêmes qui leur manquent, les villageois les invitent à rencontrer Dieu au fond d’un puits, reste à savoir s’Il y est bien.
Aucune religion n’est bénéfique dans La princesse de Zanzibar. Les Africains « sont maintenus en esclavage grâce à des hadiths sacrés que l’on faisait remonter au prophète arabe ». L’islam justifie l’asservissement : en cas d’évasion, l’esclave finira en enfer. Quant aux chrétiens : « un autre peuple de Blancs sur le continent […] avait la même religion parlant de tolérance, d’amour et de pardon, mais [ils] n’hésitaient pas à tuer les Africains, leur seul souci étant de trouver des diamants, de l’or et une matière collante qui sortait de certains arbres […] on appelait ces gens les Belges. Nous ne pardonnons pas ». Les colonialismes se valent. Les Omanais de Zanzibar le justifient avec les mêmes arguments que les Occidentaux : ils ont civilisé des sauvages.
La princesse de Zanzibar est un roman des corps. Ceux martyrisés par l’oppression ; ceux qui, même mutilés, permettent de réinventer la vie ; ceux qui, grâce à un burlesque scandaleux, presque rabelaisien, unifient les classes sociales, ramènent à la même réalité. Lorsqu’un cochon culbute Sundus accroupi dans un buisson pour se régaler de ses excréments, lorsque le braiment d’un âne met en fuite une foule de lyncheurs, lorsqu’un homme devient un chien, le mythe déraille pour dire le chaos d’un monde tordu par la violence, mais encore vivable, réparable.
Si les plaies laissées par l’Histoire sont trop à vif, si « lorsque la justice divine ne s’accomplit pas, cela laisse la place à l’injustice de Satan », l’avenir tient au personnage d’Uhuru, danseuse, chanteuse et sorcière, qui a su préserver son indépendance grâce à une fiction créatrice. Les prisonniers libérés par la chute du sultan, nus, aveuglés par le soleil, traversent une friche semée de charognes tels des personnages de Breughel. Uhuru les recueille, en attendant la révolution qui, après les Omanais esclavagistes, libérera Zanzibar des Anglais, pour mettre en place un monde (un peu) meilleur.
On n’oubliera pas Sundus et la princesse, Roméo et Juliette swahilis, alliant jusqu’au bout leurs imperfections, ruant dans les brancards, comme Abdelaziz Baraka Sakin mêle les formes et les tons jusqu’au paradoxe consistant à exposer les horreurs de la traite orientale en créant un grand plaisir de lecture. Il le faisait déjà avec les crimes de guerre dans Le messie du Darfour, et avec la condition des saisonniers sans terre dans Les Jango, autres grands romans.












