Aujourd’hui, c’est « dès l’aérogare », comme le chante Claude Nougaro, que se sent « le choc » de New York. Dans les années 1920, c’était sur les débarcadères, là où tournoient les mouettes et grincent les treuils, que Manhattan venait à votre rencontre. Des hommes et des femmes y débarquaient en masse, se bousculant entre les parois en bois du tunnel de la gare maritime, « poussés et heurtés comme des pommes que l’on envoie rouler dans la cuve d’un pressoir ». Le roman moderniste de John Dos Passos, Manhattan Transfer, vient de reparaître aux éditions Gallimard, dans une nouvelle traduction de Philippe Jaworski, près de cent ans après celle du grand Maurice-Edgar Coindreau. « Gare, gare, gare / Là c’est du mastoc », soufflerait le même Nougaro, « C’est pas du Ronsard / C’est de l’amerloc » ; certes, mais, qu’on se le dise, via les transferts qu’il opère, le français de Jaworski tient le choc.
John Dos Passos, Manhattan Transfer. Trad de l’anglais (États-Unis) par Philippe Jaworski. Gallimard, 528 p., 23 €
On n’a pas toujours su prendre la pleine mesure de Manhattan Transfer. Souvent considéré comme un simple prélude à la trilogie U.S.A. (1938), le roman de 1925 est aujourd’hui reconnu comme le portail par lequel le modernisme américain a transité. Dos Passos y aura passé au banc d’essai l’essentiel des techniques qui feront la renommée de 42e parallèle, en particulier. Techniques empruntées aux médias (presse et publicité), mais aussi et surtout au cinéma : découpage, montage, cadrage, œil de la caméra, alternance de plans serrés et de plans larges, tout y est en germe, ne demandant qu’à s’exprimer au grand jour. Sans oublier une bande-son nourrie des « tubes » de l’époque. Surtout, Manhattan Transfer est un immense roman-ville, l’égal de l’Ulysse de Joyce, ou du Mrs Dalloway woolfien. Mais un Joyce ou une Woolf qui aurait consommé des amphétamines, tant Manhattan s’y affiche speed, swing et trans. Couvrant une trentaine d’années, du Gilded Age des années 1890 au Jazz Age des années 1920, la chronique relate sans fard l’endroit et l’envers de la ville, mais aussi la campagne alentour, de jour comme de nuit : « Oh ! c’est parfait la nuit, quand on ne peut pas voir. Il n’y a pas de sens artistique, pas de beaux bâtiments, pas d’atmosphère de l’ancien temps, c’est ça, le problème ».
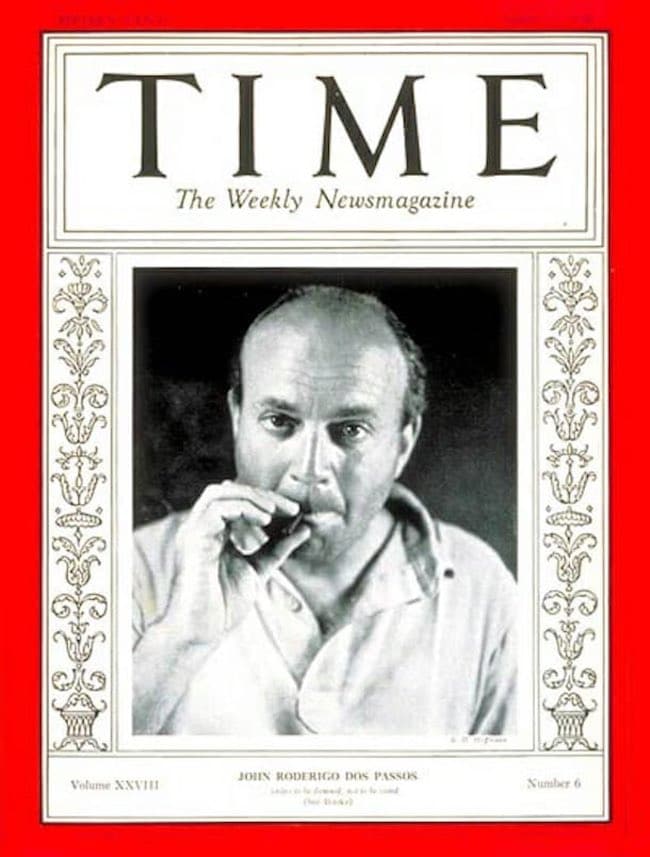
John Dos Passos en Une du « Time » daté du 10 août 1936
Les gens qui la traversent en tous sens se côtoient sans se voir, ni se tendre la main. À force de vouloir « des choses inconcevables », ils s’y fracassent, le plus souvent, loin des réussites espérées. Les personnages y sont nombreux, près d’une trentaine, mais ils sont cinq ou six à vraiment retenir l’attention. Plus nombreux encore, innombrables même, sont les « plans » (d’immanence, dirait Deleuze) : « La plus grande confusion régnait – entrecroisement de plans colorés, visages, devantures, trams, automobiles ». Ce n’est plus une ville, c’est un kaléidoscope dont les « alphabets » se mélangent – en français dans le texte – et où chacun s’avance « à l’aveuglette ». La grande affaire de Manhattan, ce sont les affaires qui ne s’y font pas, les boulots introuvables ou ingrats. Bud Koerpenning, le premier à y débarquer, ne trouvera jamais la porte permettant d’accéder au « cœur des choses ». Dans la « deuxième ville du monde », transbordement (ferroviaire) rime trop souvent avec sabordement : « They had to change at Manhattan Transfer. The thumb of Ellen’s new kid glove had split and she kept rubbing it nervously with her forefinger. » / « Ils durent changer de train à Manhattan Transfer. Le pouce du gant neuf en chevreau d’Ellen avait craqué, et elle ne cessait de le frotter nerveusement avec son index. »
Sous l’apparence d’une narration décousue et fragmentaire, se dévoile peu à peu une « grande forme » articulée à des objets, images et autres accessoires (dans un roman faisant la part belle aux actrices et au music-hall) dont Dos Passos orchestre savamment le retour : portes à tambour, pompes à incendie (et grande échelle), voies, dollars, fleuve (« Un fleuve encore jusqu’au Jourdain »), gratte-ciel. Jailli du brouillard vide et sombre sur le fleuve, « bouche noire à la gorge lumineuse », le débarcadère de fin fait écho à celui du début, décrivant l’équivalent d’une boucle fatale, figurant un étau retenant entre ses mâchoires d’acier les personnages pour mieux les broyer. Seul, Jim Herf, journaliste manqué, montera à bord d’un truck qui l’emmènera loin, très loin de Ninive, la Cité de la Destruction. Il fallait donc que l’écrivain, contrairement à son double de fiction, crût encore au pouvoir des mots…

New York (2004) © Jean-Luc Bertini
Ses mots, Philippe Jaworski se charge de les aiguiller, de les transférer. Pour la circonstance, l’intrépide traducteur (d’Herman Melville, Mark Twain, Francis Scott Fitzgerald, Jack London, ou bien encore George Orwell) s’est confronté à une figure dans le métier, Maurice-Edgar Coindreau (1892-1990), grand découvreur de Hemingway, Faulkner, Steinbeck, qu’il aura fait connaître à la France de Sartre et de Malraux. Remontant à 1928, sa traduction de Manhattan Transfer, toujours en circulation, faisait (un peu) son âge sur certains détails. Révolu, le temps des « bourgerons » et autres « sergots », place aux bleus de travail et aux flics. Les « phrases » sont des formules et non des phrases, les « tracks », des « voies » au moins autant que des « rails ». Le « ferryslip », en l’occurrence, est un « débarcadère », plutôt qu’un « embarcadère ». La « lumière », elle, désigne le feu de circulation, passant au rouge ou au vert. Quant aux portes des grands hôtels, on les dit à tambour, plutôt que « tournantes ». Mais Jaworski rejoint Coindreau pour ce qui est de la compréhension en profondeur du phénomène qu’est Manhattan Transfer : le « shift » permanent, la vitesse de déplacement, mais aussi la force d’écrasement matérialisée par le rouleau compresseur (et non le « rouleau à vapeur ») de New York. En revanche, c’est sur le plan de l’exécution que leurs chemins divergent, à l’image de l’Hudson et de l’East River, « deux rivières serpentines aux reflets lumineux coulant sans discontinuer » :
« Et tandis qu’il descendait rapidement Hudson River, pour se rendre aux bureaux de Winkle & Gulick, Importateurs des Indes occidentales, il reniflait les larmes qui lui brûlaient les yeux. « (Coindreau)
« Aspirant ses larmes brûlantes, il redescendit rapidement Hudson Street pour gagner les bureaux de Winkle & Gulick, importateurs des Indes occidentales. » (Jaworski)
« Puis il poussa la tête de Congo contre le pont et s’enfuit vers l’arrière. Tandis qu’il courait, ses sabots claquaient sur ses pieds nus » (Coindreau)
« Puis il plaqua la tête de Congo contre le pont et s’enfuit vers l’arrière, faisant claquer ses sabots à ses pieds nus » (Jaworski)
« Des milliers de fenêtres s’embrasèrent. Un grondement, un bourdonnement s’élevèrent de la ville. » (Coindreau)
« Un million de fenêtres s’embrasèrent, un bourdonnement sourdait des profondeurs de la ville » (Jaworski)
« Et gauchement il la prit avec de grands soupirs, profonds, fous. » (Coindreau)
« Puis il pesa sur elle, gauchement, sa respiration s’affolait. » (Jaworski)

À chaque fois s’affirme un même parti pris de radicalité. De l’anglais américain d’origine, Jaworski retient la prédication, la dynamique aussi, mobilisées avant la destination. Là où Coindreau décompose et analyse, son successeur impulse un élan et relance la machine, visant un effet démultiplicateur, mais aussi libérateur, comme on parle d’une « vitesse de libération ». Avec lui, la « phrase urbaine » de Dos Passos, pour reprendre la forte, et si juste, expression de Jean-Christophe Bailly (La phrase urbaine, Seuil, 2013), procède d’une mise en jambe autant que d’une mise en branle. Parcourant Manhattan à tombeau ouvert, un grand train de mots file de station en station, avec pertes et fracas. « Grammaire générative des jambes », écrit Bailly, qui ne pensait pas nécessairement aux grands marcheurs (Jim, Bud), aux grandes marcheuses (Ellen), du roman de Dos Passos. Phrase new-yorkaise, « géométrique et sautillante », fluide et heurtée, convulsive et atmosphérique, à l’image des dizaines de notations, tantôt météorologiques, tantôt chromatiques, qui constellent le propos, à chaque coin de rue, derrière chaque fenêtre restée ouverte : « Des machines à écrire font pleuvoir dans ses oreilles des déluges de confettis nickelés » ; « Au-delà de l’eau couleur de zinc, les hauts murs, les bâtiments du bas Manhattan, forêt de bouleaux, miroitaient dans le rose du matin comme un appel de cor dans une brume chocolat. »
À ces touches largement spatiales s’ajoutent les choix opérés entre divers régimes de temporalité, Jaworski supplantant régulièrement les temps du récit, dont le fil souvent se rompt, par un présent de narration dépassionné autant qu’iconique : « Les assiettes glissent interminablement entre les doigts graisseux de Bud. Relents d’eaux grasses mêlés à du savon chaud. Deux coups de lavette, bain, rinçage, et l’égouttoir pour le petit Juif au long nez qui essuie. Éclaboussures, genoux trempés, avant-bras luisants de graisse, crampes aux coudes. ». Ou, plus loin : « Les sifflets des vapeurs mugissent, des bacs rouges qui se dandinent comme des canards battent l’eau blanche, un train entier sur un chaland traîné par un remorqueur à son flanc qui lâche en haletant des bouffées de vapeur cotonneuses, toutes de même taille. » Transférant dans une durée cette fois immémoriale, à rebours du réalisme, la possibilité d’une île, l’île de Manhattan, longuement rêvée avant d’être trouvée puis habitée, lieu à rejoindre autant qu’à quitter, objet de mille et une transactions, financières comme psychiques : « Le vacarme de la rue se brise comme une vague déferlante sur un coquillage où palpite l’angoisse ». Transfert et contre-transfert.












