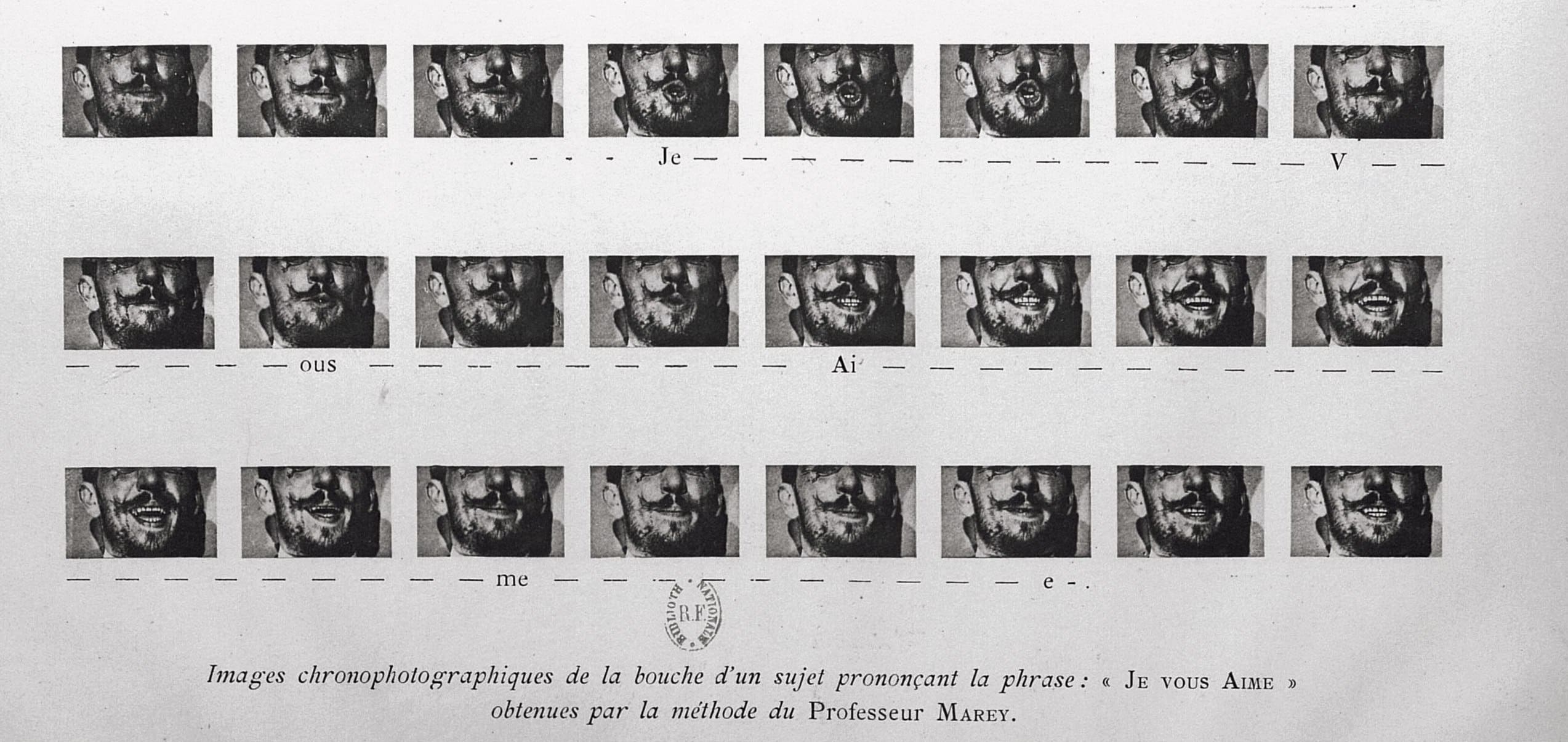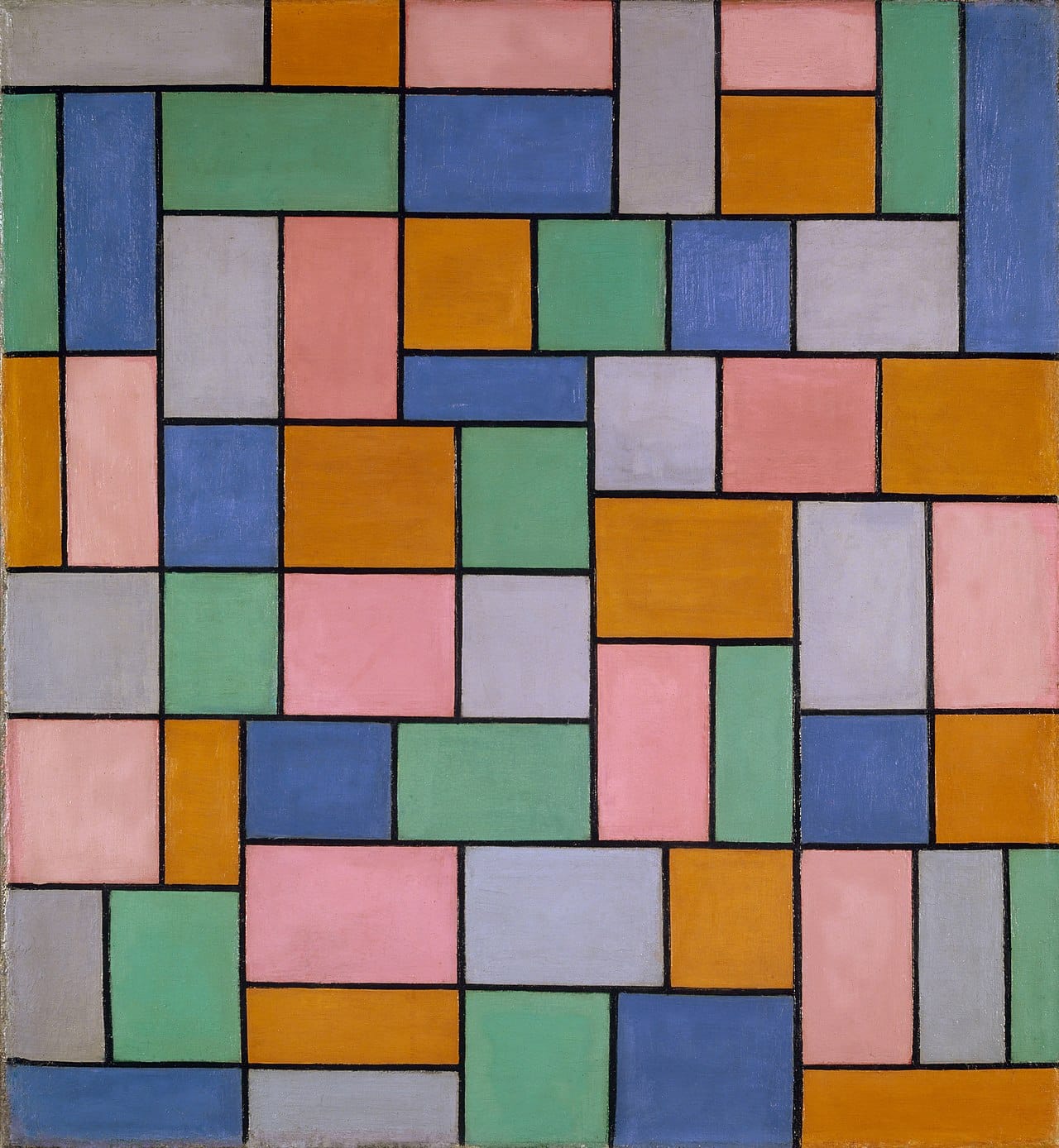De The Economist à The Guardian, de la Suddeutsche Zeitung au New Yorker, le jeune politologue Yascha Mounk est encensé. Défenseur ardent et inquiet de la démocratie libérale, ce professeur de Harvard s’est vu tout autant acclamé par la presse française pour son dernier livre, Le peuple contre la démocratie. Renvoyant dos à dos populisme et libéralisme autoritaire, l’ouvrage provoque l’engouement toutes couleurs politiques confondues. Cet unanimisme ne manque pas d’interroger.
Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean-Marie Souzeau. L’Observatoire, 529 p., 23,50 €
Premier enseignement : se positionner en oiseau de mauvais augure peut susciter l’adhésion. Et parce que la peur est une passion, elle donne un bel allant, une manière, ou tout du moins une tonalité à cet essai personnel sous bien des rapports. Le propos a beau être théorique, quelques éléments de biographie aident à comprendre cette Cassandre politologue. Descendant d’une famille juive de Pologne, Yascha Mounk est allemand. Dans son pays natal, il assiste aux manifestations de l’Alternative für Deutschland. Dans son pays d’adoption, il se retrouve avec Trump. Pendant ce temps-là, Brexit, Syriza et Podemos s’installent dans le paysage, Marine Le Pen accède au second tour de l’élection présidentielle française et le Mouvement 5 étoiles poursuit son ascension… Hanté par les totalitarismes et soucieux de compréhension globale, l’auteur dresse des parallèles entre ces formations et la Turquie, les Philippines ou le Venezuela. Ces rapprochements ont quelque chose de saisissant. Particulièrement après avoir assisté aux élections brésiliennes. Lugubre, Mounk nous fait part de ses angoisses : « Durant la majeure partie de tout un siècle, la démocratie libérale a été le système politique dominant dans de nombreux endroits du monde. Cette époque pourrait bien être en train de s’achever. » Vous en doutez ? Le chercheur déverse alors force études sur l’effritement de la confiance dans la démocratie : « Au Royaume-Uni, 25 % de la population déclarait son soutien à un dirigeant fort en 1999, le pourcentage est aujourd’hui de 50 %. »
Plus éloquentes encore, ces statistiques sur l’attirance des jeunes Américains pour la dictature dégagent une saveur longue en bouche. Ainsi, une fois le lecteur (libéral) parfaitement atterré, l’auteur lui assène le coup de grâce : « Désormais, la démocratie n’est plus le seul choix possible : elle est en cours de déconsolidation. » Encore faudrait-il que la démocratie libérale fonctionne de manière démocratique, pourrait-on avancer. Justement ! Mounk partage en partie cette objection. Et cela fait du Peuple contre la démocratie autre chose qu’une énième opération éditoriale sur le thème des « populismes ». Car, et c’est là le pivot du livre, la démocratie libérale subirait une menace en double hélice : « Nous assistons à la naissance de démocraties antilibérales, ou démocraties sans libertés, et d’un libéralisme antidémocratique, ou libertés sans démocratie. » Il se trouverait donc d’abord des gouvernements affirmant avoir « un monopole moral sur la représentation populaire »… mais peu enclins à protéger les libertés individuelles. Exemple : Orban bénéficiant d’un solide soutien des Hongrois tout en réprimant au nom de la majorité tout ce qui ressemble à une minorité. Et, de l’autre côté du spectre, il y aurait bien des régimes respectueux des libertés fondamentales mais qui ne jouiraient pas du soutien des populations. Exemple : l’Union européenne. À l’appui de sa démonstration, l’auteur conte la célèbre affaire suisse de la construction d’un minaret dans la bourgade de Wangen bei Olten. Ledit minaret fut déclaré légal par tous les tribunaux du pays. Décisions de justice qui entrainèrent campagne politique, votations et, finalement, interdiction démocratique des minarets chez nos voisins helvètes… Schéma d’autant plus infernal que ce « libéralisme antidémocratique » nourrirait bien sûr l’attrait pour la « démocratie antilibérale ».

Yascha Mounk
Rustique, cette grille de lecture a son efficacité. Pourtant, tout en ayant le mérite de la clarté, elle n’ajoute rien. Sous la « démocratie antilibérale » on retrouve la « démocratie plébiscitaire ». De même, le « libéralisme antidémocratique » évoque ce mixte d’ordo et de néolibéralisme que la théorie critique nomme « libéralisme autoritaire ». Pierre Rosanvallon avait quant à lui proposé il y a plus de dix ans ans une opposition peu éloignée : « antipolitique achevée » et « contre-démocratie » (évaporation de l’antagonisme politique au profit de l’expertise). Et même, dès 1995, Jacques Rancière désignait sous le nom de post-démocratie « la pratique gouvernementale d’une démocratie ayant liquidé l’apparence, le mécompte et le litige du peuple ». C’est dire si les analyses de Mounk ne frappent pas par leur originalité. En revanche, il intéresse lorsqu’il rejoint des intellectuels concevant le populisme comme une forme plus que comme un contenu. Enzo Traverso écrit ainsi : « Le populisme est avant tout un style politique avant d’être une idéologie. » Et Chantal Mouffe (populiste de gauche revendiquée…) emploie l’expression de « stratégie populiste ». Malheureusement, Mounk ne distingue pas entre populisme de gauche et de droite. Fâcheux oubli ! En effet, le premier, parce qu’il vise à « construire un peuple », reconnaît l’hétérogénéité du corps social. Tandis que le second affirme « incarner le peuple » en partant de la pétition de principe selon laquelle le peuple existe et serait doté d’une identité homogène. La différence est donc de taille ! Elle signifie ni plus ni moins que le populisme de gauche peut s’articuler à la démocratie libérale. C’est bien tout le projet de Chantal Mouffe lorsqu’elle envisage le populisme de gauche comme une manière de remettre de l’antagonisme dans un jeu politique dévitalisé par vingt ans de neutralisation idéologique. Et donc de vivifier une démocratie libérale dont Mouffe reconnaît par ailleurs l’absolue nécessité. Hélas, Mounk prête peu attention à ce genre de théoriciens, alors même qu’ils sont ses alliés objectifs. Cette myopie le conduit à ranger dans la même catégorie Erdoğan et Podemos, Corbyn et Salvini. Avec pour effet de dissoudre la notion d’extrême droite.
Résultat paradoxal, qui surprend d’autant plus que Mounk se situe plutôt à gauche de l’éventail politique. Peut-être faut-il mentionner qu’il fut dans ses vertes années militant au SPD. De cette formation social-démocrate, il a quelques restes. Il se trouva notamment aux premières loges pour observer ce qu’il appelle avec une touchante pudeur « l’éloignement des élites politiques de la scène populaire ». Même, et toujours avec ce sens aigu de l’euphémisme, il pousse l’audace jusqu’à admettre « l’effet corrupteur » de l’arrêt Citizens United vs Federal Election Commission. Fameuse et décisive, cette jurisprudence de la Cour suprême américaine de 2014 autorise les entreprises et groupes d’intérêt à dépenser autant d’argent qu’ils le souhaitent pour soutenir ou attaquer tel ou tel candidat.
Trop libéral ou pas assez sociologue pour penser l’État en termes de classes sociales, Mounk est néanmoins contraint d’admettre une mainmise (partielle) du capital sur les décisions politiques. Il ne s’attarde pas sur ce point. Faisant varier son approche, il reconnaît que « l’exécutif, pendant longtemps l’organe politique le plus important, a perdu une grande partie de son influence au profit des tribunaux, de la bureaucratie, des banques centrales et des traités et organisations internationaux ». Commentant ainsi le fonctionnement de l’Union européenne, l’auteur remarque d’une part que les droits fondamentaux y sont respectés grâce à la Cour de justice de l’UE mais que les procédures politiques stricto sensu s’avèrent faiblement démocratiques du fait de l’indépendance de la BCE, de la puissance de la Commission et de la faiblesse relative du Parlement. Bref, l’auteur décrit la montée en force d’une technostructure experte. Respectueuse du droit certes, mais tellement convaincue de sa prétendue neutralité idéologique qu’elle en devient autoritaire.

Fresque sur plâtre représentant les prophéties de Cassandre, 20-30 après J.-C. © Musée archéologique de Naples
Cela une fois établi, Mounk préconise avec pompe des « Remèdes ». Très instructifs, ils illustrent l’inusable formule de Bossuet : « Dieu se rit des prières qu’on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s’oppose pas à ce qui se fait pour les attirer. » Un florilège s’impose. Débutons par l’injonction suivante : « Aussi peu attirant que cela puisse paraître aux yeux de militants de faire campagne pour un parti du centre, joindre un mouvement politique qui possède des chances réelles de succès reste l’une des meilleures manières de se battre pour la démocratie. » On se frotte les yeux. Deux cent cinquante pages nous disant tout le mal des politiques menées depuis trente ans par le centre-droit ou gauche pour, finalement, appeler à y adhérer ! Implacable, le même raisonnement se répète lorsqu’il s’agit de « réparer l’économie ». Là aussi, tout commence par une observation catastrophiste : entre 1986 et 2012, le PIB des États-Unis augmente de 59 %, augmentation de la richesse donc, dont 42 % reviennent aux 0,1 % les plus riches. Face à cela, les suggestions de Mounk se résument à une série de mesures techniques intensifiant la répression de la fraude fiscale ou imposant des compagnies comme Apple proportionnellement à leur chiffre d’affaire dans chaque pays. Recommandations de bon sens mais bien courtes face aux enjeux évoqués. Cela vaut tout autant pour sa proposition de « patriotisme inclusif », qui cherche à articuler protection des minorités et émigration raisonnée (comprendre : choisie).
Tout cela ne fait pas un programme et l’auteur, conscient du caractère technique de ses mesures, tente un habillage idéologique : pas moins qu’une « refondation de la religion civique ». (Le mysticisme se loge toujours là où on l’attend le moins.) Les populations n’ont plus foi dans la démocratie libérale ? Interdisons les redécoupages électoraux et augmentons les salaires des représentants du peuple pour les rendre moins corruptibles. Pourquoi pas ? Mais comment provoquer un ralliement à partir de mesures technocratiques ? Il y a là un contresens dont l’auteur semble conscient. Un ultime aveu de faiblesse en atteste. Mounk finit en effet par sommer les enseignants d’« inoculer l’esprit civique à leurs élèves ». L’emploi de ce verbe révèle d’étranges penchants éducatifs chez ce libéral. Et il ajoute que les enseignants doivent « passer davantage de temps à montrer combien les solutions de remplacement idéologiques à la démocratie libérale restent repoussantes ». C’est Churchill bégayé. Cette ligne de défense paraît si mince qu’on risquera l’hypothèse suivante : en situation de crise (comme aujourd’hui), soit on attaque en imaginant autre chose que l’existant, soit on se replie sur une rhétorique héritée du passé. Mounk opte pour le repli. Quoi de plus normal pour un penseur lisant le présent au prisme du XXe siècle ? Tout « nouveau monde » qu’il soit, il nous vient d’une autre époque. Pour preuve, son incapacité à évoquer les enjeux environnementaux.
Le succès de Mounk ne s’explique que par l’habileté de son attelage rhétorique : affoler le lecteur puis proposer des mesures consensuelles auxquelles n’importe qui pourrait souscrire. Valse à deux temps : inquiéter de manière spectaculaire (pour se construire une image de visionnaire), puis rassurer par des solutions « raisonnables » (parfaites pour plaire au plus grand nombre). L’effet a quelque chose de déplaisant. Mais, après tout, imaginons que Mounk soit de bonne foi. Alors, c’est presque pire. Car il paraît croire en la nécessité de réformes approfondies tout en craignant qu’elles ne mettent à terre la démocratie libérale elle-même. Il serait tactiquement aventureux d’entreprendre de réelles ruptures maintenant. À cet égard, il rappelle ces fins ministres de Louis XVI conseillant des réformes, fussent-elles minimes, pour éviter une autre éventualité. Pareillement, ce politologue voyant de profondes fissures de structure suggère… de les repeindre. Un mur peut tenir ainsi quelque temps. Ça ne l’empêchera pas de s’écrouler.