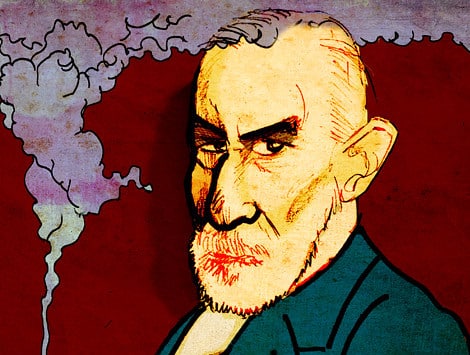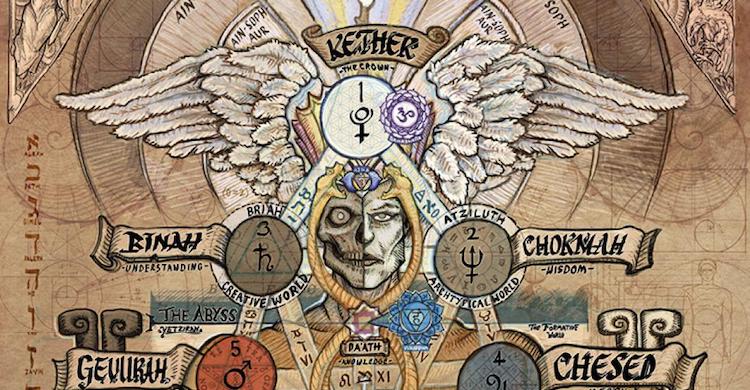D’emblée, en des termes discrets mais sans appel, Laurence Kahn prévient qu’il ne saurait être question, s’agissant des effroyables dégâts que le nazisme a pu causer dans le champ psychanalytique, de se limiter à ce que le titre de son livre pourrait laisser croire, à savoir l’évocation de l’exil auquel furent contraints les analystes juifs d’Allemagne et d’Autriche, lesquels ne furent du reste pas toujours si bien accueillis aux États-Unis qu’on le laisse souvent entendre, et cela sans compter ceux qui furent assassinés par les nazis.
Laurence Kahn, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse. Puf, 260 p. 14 €
Cet exil, précise Laurence Kahn, « ne représente qu’une partie du coup porté par le nazisme à la psychanalyse ». Mais gardons-nous d’une vision par trop étroite, « patriotique », de ce désastre, la psychanalyse n’a pas plus échappé que le reste du monde occidental, voire aussi bien le monde communiste sous d’autres formes, à « l’implacable ébranlement du socle langagier sur lequel elle reposait ». Et l’auteure de ce livre de rappeler qu’à « Thomas Mann qui, pour célébrer Freud se demandait en 1936 si le monde n’avait jamais été transformé autrement que par la pensée et son support magique, le mot », l’histoire « avait en quelque sorte répondu que la magie du mot pouvait transformer le monde en ruines ».
Au regard de la richesse, de l’érudition et du caractère novateur de ce livre appelé selon nous à être incontournable, on ne peut éviter de se limiter à en n’extraire que quelques lignes essentielles sans viser à en restituer toute la richesse, celle concernant le détail de la destruction par les nazis de la culture aussi bien que l’histoire chaotique de la psychanalyse qui ne sortira pas indemne de cette tragédie, ou que celle qui, prenant appui sur des études linguistiques, littéraires, sociologiques ou politiques, en constitue le contexte général. Laurence Kahn, cela se sait, n’est pas seulement psychanalyste, elle est aussi philosophe, philologue en plus d’un aspect, et on la devine sans difficulté étant plus qu’à l’aise dans diverses langues, depuis le grec jusqu’à l’allemand en passant par l’anglais et bien sûr le français, sans compter celles que l’on oublie ou qu’elle ne laisse pas paraître. On se limitera donc ici à cet objectif, celui d’éveiller la gourmandise des lecteurs à venir, ils sont déjà nombreux, en prévenant toutefois ceux de cinquante ans et plus – cela concerne l’éditeur bien plus que l’auteure – qu’ils auront à vérifier l’adéquation de leurs lunettes.
Les maux dont souffre aujourd’hui la psychanalyse, ce que l’on pourrait appeler son déclin ou sa « crise », l’entreprise nazie en a forgé la litière directement et indirectement alors que commençait de se développer ailleurs, berceau de l’épanouissement du cognitivisme et du scientisme contemporain, l’hostilité épistémologique des cultures, anglo-saxonnes notamment, dominées par l’empirisme logique et la philosophie analytique qui combattaient la métapsychologie freudienne perçue comme enracinée dans la spéculation métaphysique à laquelle il était déjà reproché ses conceptions ignorantes de cet axe fondamental, la preuve, pièce maîtresse de l’idéologie de la mesure et du calcul que Michel Foucault dénonçait vigoureusement – idéologie aujourd’hui triomphante.
Victor Klemperer est ici d’abord convoqué, lui qui, depuis sa cachette, dénonce très tôt, comme en simultané, la pauvreté de la langue du régime hitlérien mise au service exclusif de l’invocation, fonction magique que pointera de son côté Cassirer qui souligne la transformation par ces mêmes nazis du sens des mots.
S’agissant de Klemperer, dont la démarche fut longtemps ignorée, sans doute parce que l’on voulait oublier le ravage et la barbarie nazis, il n’est pas anodin, Laurence Kahn le rappelle opportunément, de noter qu’il fut édité en 1947 en RDA et qu’il fallut attendre… 1966 pour qu’il le fût à l’Ouest. Entendre l’inconscient, comme c’était le cas de ce philologue plus que courageux, constituait une raison supplémentaire pour être ignoré, lui-même observant, réflexion on ne peut plus freudienne : « Ce que quelqu’un veut délibérément dissimuler, aux autres ou à soi-même, et aussi ce qu’il porte en lui inconsciemment, la langue le met au jour. » En manipulant les mots et les concepts, les nazis visaient d’abord à l’élimination de toute forme de pensée autre que celle du « Reich », troisième du nom. Au temps de la première édition du travail de Klemperer, mais vingt ans plus tard aussi bien, l’entreprise de dénazification n’était pas encore entamée et l’époque était alors marquée par les tentatives de « surmontement du passé », ce qu’Adorno dénonçait dès 1959 en y décelant un mouvement souterrain d’effacement de ce passé.
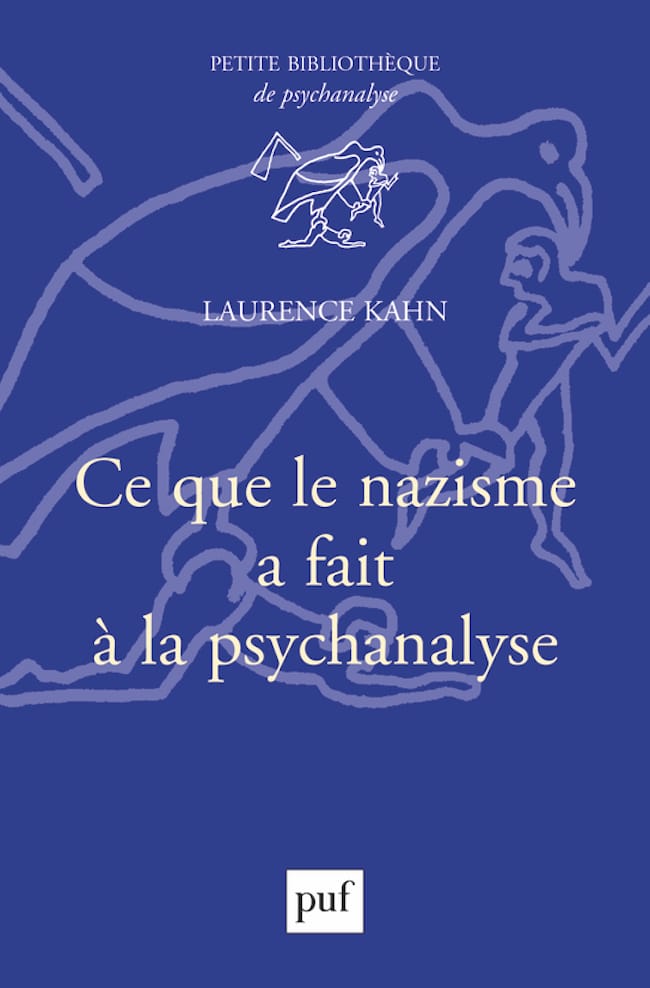
« Surmontement », « effacement » du passé, enterrement du continent freudien, le processus est déjà bien lancé en 1933 mais il aura des effets durables du fait de la torsion infligée à la langue allemande et donc à la culture que cette langue avait forgée et au-delà. Cette transformation sera telle que, dans les années qui suivront la chute du régime nazi, le sens du vocabulaire freudien demeurera à ce point altéré qu’il rendra encore un temps opaque, voire inaudible, le « retour » à Freud de Lacan qui, lui-même, ainsi que le fait observer Laurence Kahn, aura quelques difficultés à saisir avec justesse l’ampleur du désastre. Dans le champ de la psychanalyse, ce dynamitage de la langue fut bien sûr accéléré par le déchaînement antisémite, mais la destruction de la psychanalyse s’inscrit dans un cadre, un projet bien plus large, celui d’une altération, entre autres, de l’image du père, de la notion de pulsion ramenée à celle d’instinct, toutes opérations dont on ne donne ici qu’un aperçu et qui devraient obliger les psychanalystes à repenser leur contexte et leurs références, modifiés bien au-delà de ce qu’ils semblent croire, par ces retombées de la « culture » nazie. Quelle que soit l’ardeur mise, et ce livre en est un des plus beaux exemples, pour opérer ce déblaiement des immondices nazis, il reste que ceux-ci se sont inscrits de manière durable à travers le monde dans la mesure où cette épuration de la culture de la Mitteleuropa allait finalement, au-delà du contexte tragique qu’aura constitué l’extermination opérée à Auschwitz et ailleurs, rencontrer, voire fusionner avec ce contre quoi Freud avait entrepris sa « conquête », la psychologie, spontanée ou « scientifique » qui trouvera aux États-Unis son terrain le plus fertile, celui du scientisme évoqué à l’instant, pour développer son territoire.
Mais saisir dans toute leur ampleur les effets de l’horreur nazie suppose d’aller au-delà des faits et de leur déploration : Auschwitz, c’est bien plus que l’horreur, que le camp et la fumée des corps gazés et brûlés, c’est fondamentalement « le paradigme d’un nouvel état de la condition humaine » qui a mis « la loi hors la loi ». Pour penser de cette manière et saisir à bras-le-corps ce que ce véritable tsunami de la pensée a pu produire notamment dans le champ de la psychanalyse et dans la communauté psychanalytique, il faut, tout en continuant à réfléchir avec Klemperer, Cassirer, Mann ou Adorno parmi d’autres, lire, relire Kertész, ce jeune Hongrois marqué à jamais par la fumée et les cendres de cet enfer, Kertész dont la pensée, les livres, loin de se limiter à des récits, aussi douloureux puissent-ils être, constituent une manière de nous faire réaliser que « la contre-culture nazie » n’est autre que le contenant et les contenus des « potentialités générales de l’humanité et donc les nôtres ». En d’autres termes, Kertész tire de sa traversée de l’enfer cette idée que l’Holocauste, loin d’être un accident de l’histoire, voire un cataclysme, est une « contre-culture » avec ce que cela nous oblige, ou devrait nous obliger, à penser au lieu de tenter d’en borner les retombées. À bien considérer cet apport de Kertész, la question se pose de l’attitude de la majorité des psychanalystes qui – laissons de côté ceux, nombreux, qui ignorent ou ne tiennent pas ou plus l’histoire comme un facteur incontournable –, confrontés aux effets de la destruction effectuée par les nazis, réintroduisirent la notion de trauma avec l’espoir de « se délivrer de l’impact de la Shoah » pour permettre à la psychanalyse de se réinscrire, en quelque sorte à part entière, dans le domaine du savoir et à la communauté psychanalytique de renaître.
Cette « récupération » est donc de l’ordre des « bonnes intentions », celles visant à aider sous les auspices d’une idéologie morale qui se veut apaisante. Laurence Kahn s’emploie à démontrer, contre cette démarche, et elle le fait avec une rare minutie, que ce qui a conduit en particulier à la dérive de l’Ego-psychology, non sans débats et contradictions, est tout autre et réside d’abord dans l’imposante littérature qui, dès les années d’avant-guerre, sous l’impulsion notamment de Carl Müller-Braunschweig – future éminence de l’Institut Göring qui réussira, dans les années de l’immédiat après-guerre, véritable tour de « passe-passe » qui leurra autant Jones qu’Anna Freud, à fonder l’Association psychanalytique allemande alors reconnue par lPA –, entreprend, bien au-delà d’un « dépassement » de Freud, de le « liquider », lui et « sa » psychanalyse juive.
Si l’on se tourne vers la pratique, vers ce qu’il en est de la position du psychanalyste dans ce courant de la dite « psychanalyse américaine » dominée par l’Ego psychology, il apparaît que, conséquence inévitable du traumatisme collé sur la tête et les épaules des rescapés de la Shoah, l’attitude ne peut qu’être une caricature de cette pratique dont Freud avait jeté les bases, puisque irrémédiablement tirée vers l’idée de soigner, de sauver au moyen d’une démarche de compassion elle-même organisée autour de l’idée, du faux concept, d’empathie qui fait écran à l’idée même d’écoute de l’inconscient et tout autant à la haine énoncée sans concession par Kertész.
Ce n’est pas le moindre des paradoxes de l’idéologie nazie que d’avoir mis en avant, avec toute l’hypocrisie qui lui fait cortège, cette morale bien-pensante, cet altruisme qui relève de l’escroquerie intellectuelle la plus immonde, pour briser la subversion freudienne.
Au fond et à la fin de cette exploration des soubassements qui impliquait un refus ou une mise à l’écart des faux semblants de toutes espèces, Laurence Kahn pose la question de ce qui advient dans ce passage, cet échange sous terrain entre l’économie intrapsychique individuelle, celle qui ouvre sur la subordination dont chaque individu est porteur, et « l’économie du consentement à la tyrannie, à l’œuvre dans la masse ». Et de se demander, ultime questionnement de ce maître livre, si l’oubli – que nous dirons plus que repérable dans toute une partie de la psychanalyse contemporaine – du fait que l’on passe, sans y prendre véritablement garde, du père quel qu’il soit, « petit » ou pas, à la masse, ne serait pas « le stigmate de ce que le nazisme a fait à la psychanalyse ». Se débarrasse-t-on jamais d’un stigmate sauf à tenter d’en penser les racines historiques ? Laurence Kahn, ce n’est pas le moindre de ses mérites, s’efforce de nous indiquer le chemin qui peut conduire à prendre en compte cette hypothèse pour continuer de la mettre au travail.