Les historiens se sont longtemps méfiés des témoignages. Puis, à mesure que dans le discours mémoriel, le sort des victimes a pris le pas sur celui des héros, ils se sont intéressés aux savoirs du témoin. Depuis une quarantaine d’années, nous sommes entrés dans « l’ère du témoin », les témoignages sont devenus une source habituelle, et logiquement, la recherche s’interroge de plus en plus sur les conditions de production de ces récits. A cela s’ajoute le constat que les témoins disparaissent – c’est le cas de ceux de la Shoah et du Goulag. Il ne reste que des textes et des enregistrements. Comment en tirer une connaissance historique ? Deux livres, dirigé par Judith Lindenberg et de Marta Craveri et Anne-Marie Losonczy, liés à deux programmes de recherche au long court, nous donnent à réfléchir sur la manière de s’y prendre, à travers des études passionnantes de cas.
Judith Lindenberg (dir.), Premiers savoirs de la Shoah. CNRS Editions, 334 p., 25 €.
Marta Craveri, Anne-Marie Losonczy, Enfants du Goulag. Belin, 304 p. 25 €.
Judith Lindenberg s’est intéressée aux premiers témoignages de la Shoah. Elle s’est engagée, avec un groupe de chercheurs, dans l’analyse complète d’une collection de 175 volumes, en yiddish, édités pendant vingt ans (1946-1966), à Buenos Aires, par Marc Turkow et Abraham Mitelberg, Dos poylishe yidntum [La judéité polonaise]. Elle comprend des études historiques, des fictions, des récits de vie produits par des Juifs polonais, pendant et après le génocide. La plupart n’a jamais été traduite vers d’autres langues. « La description immédiate d’expériences personnelles, note Jan Schwarz, est une caractéristique essentielle de la collection. » Judith Lindenberg s’est particulièrement intéressée aux textes dus à des historiens formés avant-guerre dans l’université polonaise. C’étaient des membres du « cercle des jeunes historiens » qu’animait Emanuel Ringelblum ; ils ont été à l’origine du Comité central historique juif créé après guerre en Pologne, qui deviendra l’Institut historique juif de Varsovie. Ils ont collecté des milliers de témoignages de survivants, puis ont quitté la Pologne à la fin des années quarante. Joseph Karmisz (1907-2005) et Philip Friedman (1901-1960) ont fait carrière, l’un comme directeur de Yad Vashem, l’autre comme professeur aux Etats-Unis, tandis que Joseph Wulf (1912-1974), fixé en Allemagne, eut des difficultés à trouver une assise institutionnelle. Il fonda à Paris, avec l’écrivain Michal Borwicz (1911-1987), un Centre d’étude de l’histoire des Juifs de Pologne ; Borwicz, lui-même rescapé de Lwów et responsable de la Commission historique juive de Cracovie, attachait une grande importante au témoignage.
En fait, dès la fin de la guerre se dessine parmi ces historiens qui publient dans ces Dos poylishe yidntum une « discorde historiographique ». Les premiers s’intéressent surtout aux sources officielles, tandis que, pour Wulf et Borwicz, les documents d’archives « ne dévoilent qu’une partie de l’image et, en plus, de manière très simplifiée. » Borwicz exhorte : « Et les milliers de témoins oculaires, ils ne comptent pour rien ? »
Cette discussion met en évidence la nécessité d’intégrer les conditions de production du témoignage, dans son exploitation historienne. « Les pratiques d’écritures du génocide sont envisagées dans une continuité entre le moment même de l’événement et son après », écrit Judith Lindenberg. Et elle qualifie ces premiers textes d’ « écrits survivants », ils sont porteurs des « premiers savoirs de la Shoah », ils sont toujours le fruit d’entreprises collectives. Ils participent d’un « souci de reconstruction », avec au cœur, la langue yiddish qui a été, « pendant quelques années au lendemain du génocide, la langue d’un renouveau culturel paradoxal, perpétuant la “chaine d’or” de sa transmission », avant de devenir la langue symbolisant la destruction, « la langue de personne », a dit Rachel Ertel.
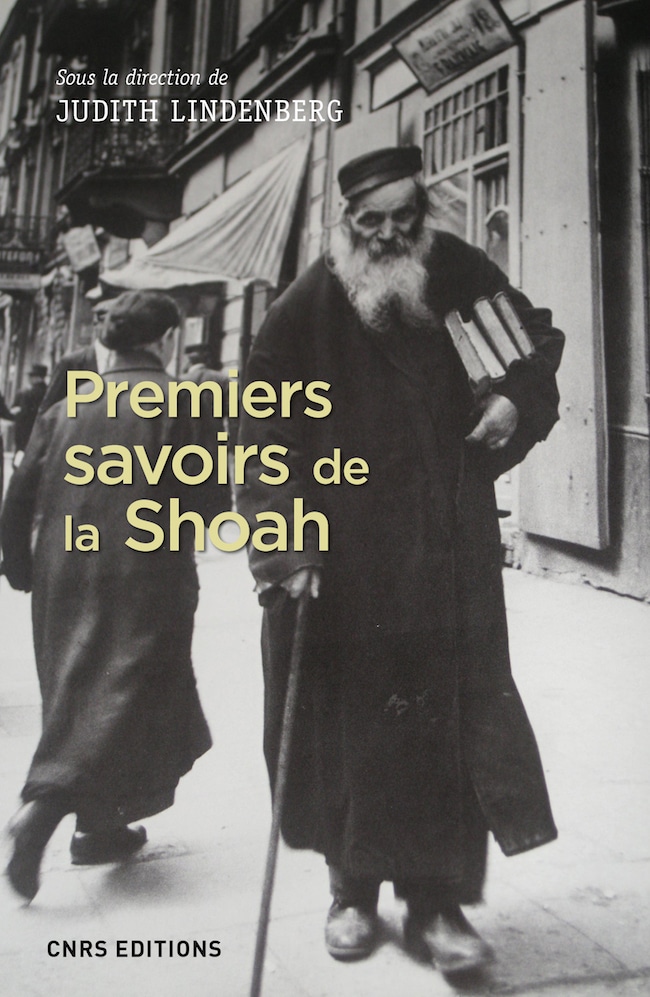
Dans cet esprit, l’ouvrage réunit une quinzaine d’études approfondies de cette production des années quarante à soixante. En plus des Dos poylishe yidntum, on trouvera trois trajectoires d’écrits survivants. Les bouleversants reportages de Peretz Opoczynski dans le ghetto de Varsovie sont présentés par Samuel D. Kassow (« Le lecteur y voit les Juifs non comme des victimes ou comme de futurs martyrs mais comme des individus », « des Juifs ordinaires, des Juifs sans qualité »). Le journal d’Oskar Rosenfeld dans le ghetto de Lodz est confronté par Catherine Coquio aux réflexions de Jan Karski sur « le monde du ghetto » (« Dans chaque journal de ghetto la perspective de l’anéantissement est traversée par un “croire au monde” persistant, lui-même en constante mutation »). Judith Lyon-Caen suit le parcours vers l’histoire, de l’écrivain et poète Michal Borwicz qui se méfie des approches « documentaires » ou « romantiques » des « écrits des condamnés à mort » [titre de son maître ouvrage] : « Borwicz invite à s’intéresser à toute écriture, celle des enfants, des simples comme des savants ou des grands poètes, à l’écriture comme événement et comme pratique mobilisant des compétences », ces écrits sont « un objet en tant que tel pour l’histoire des camps et des ghettos. » D’autres survivants sont approchés à travers leurs écrits, particulièrement Leïb Rochman (« Un “je” collectif », nous dit Carole Ksiazenicer-Matheron) et Piotr Rawicz qui, dans ses Cahiers, inventa une langue en en mélangeant six, un « volapük, écrit Anna Ciarkowska, un espace libre qui lui permit d’exprimer l’inexprimable. ». Chaque fois, outre une approche nouvelle et érudite de ces écrits et personnages, nous comprenons, finalement, combien les savoirs du témoin sont décisifs.
On rencontre les mêmes difficultés avec les récits oraux. Enfants du Goulag de Marta Craveri et Anne-Marie Losonczy présente une courte et fascinante synthèse de témoignages collectés auprès de déportés d’Europe centrale, qui ont vécu enfants (certains y sont nés) au Goulag soviétique. Elles les ont rencontrés dans le cadre d’un projet « Archives sonores – Mémoires européennes du Goulag », une collecte, de 2008 à 2012, d’un corpus de 180 témoignages en onze langues différentes, par une équipe d’une douzaine de sociologues, historiens, anthropologues ou démographes, coordonnée par Alain Blum.
Elles se sont demandées : « Qu’y a-t-il de singulier dans le regard enfantin sur la déportation ? » Ce qui les a obligées à des précautions méthodologiques. « L’irruption d’un regard d’enfant donnait une coloration particulière aux récits, contrastant étrangement avec l’âge avancé du témoin. » Dans chaque narration elles ont assisté à « une sorte de dédoublement entre les souvenirs propres de l’enfance en déportation et une mémoire critique superposée » reconstruite par l’adulte. Elles ont donc travaillé sur « la limite entre le souvenir intime et le témoignage public », sur les silences et les non-dits, et surtout analysé le ton, les émotions, les hésitations des récits oraux jamais transcrits. « Écouter et réécouter les témoins nous a permis de les percevoir comme des sujets, acteurs de leur remémoration. De la parole émerge, au-delà de leur histoire, un point de vue, un style mémoriel qui n’est qu’à eux. »

Il faut lire ces souvenirs. Ils nous offrent un savoir nouveau et exceptionnel sur l’expérience du Goulag. Marta Craveri et Anne-Marie Losonczy les ont classés en trois rubriques, en suivant le parcours de ces enfants déportés dans les années quarante, des Pays baltes, de Pologne, de Hongrie ou d’Ukraine occidentale. « L’arrachement », c’est-à-dire l’arrestation et l’arrivée dans un camp de travail ou une colonie de peuplement, est brutal. Il se résume parfois à une image. Ainsi cette petite Ukrainienne de 8 ans : « Quand on nous fait descendre [du camion] on voit en face de nous une immense forêt et on entend rugir les ours et hurler des loups. Il y avait des renards autour de nous. Les enfants, nous avons commencé à pleurer parce qu’on avait peur d’être mangés. » Pour les plus petits ou ceux qui naissent sur place, « Grandir » [la deuxième rubrique] est l’occasion « d’expériences en demi-teinte, de quelques moments de joie, de soulagement et de partage » et ce n’est que plus tard, quand ils prennent conscience des souffrances de leur famille que le choc émotionnel est vif. Quant aux « retours de déportations », c’est pour la plupart « le stigmate de ce passé infamant qui fera de la quête d’un logement légal, d’un travail, d’une reprise des études, ou d’une adhésion aux organisations de masse, un parcours semé de frustrations et de dangers ».
Parmi ces témoignages, ceux des Juifs donnent lieu à de longs développements. Ils ont été soumis dans ces années quarante, à une double persécution, celle de l’extermination nazie suivie, quand ils en réchappaient, du Goulag. Le récit de Juliana Zarchi, cité in extenso en annexe, résume tous les autres. Née à Kaunas en 1938, son père juif lituanien est assassiné par les Einsatzgruppen, elle est exfiltrée du ghetto à l’âge de 3 ans. En 1945, elle a 7 ans quand elle est déportée avec sa mère (d’origine allemande) par les Soviétiques, en Asie centrale. En 2009, la vieille dame interviewée chez elle, à Kaunas, résume le début de sa vie : « Moi qui avais survécu au ghetto, je me souviens que quand je suis arrivée au Tadjikistan on me jetait des pierres, on m’appelait fasciste ! Quand on allait se baigner, les garçons du village nous frappaient et essayaient de nous noyer. Je comprends qu’ils avaient perdu des pères dans cette guerre, mais pourquoi moi, qui avait souffert du fascisme, qui avais perdu mon père et toute ma famille, je devais être responsable des crimes nazis ? C’était cela le plus terrible. »












