S’efforçant d’évaluer la portée des travaux technoscientifiques sur l’intelligence, Catherine Malabou compare l’attitude des philosophes à la tortue, cette organisation puissamment défensive de l’armée romaine décrite par Plutarque. Leur faut-il vraiment adopter cette posture défensive ? Certaines autocritiques sont peut-être justifiées mais, s’il est difficile pour les philosophes d’adopter une position ferme sur un tel sujet, ils n’en sont peut-être pas réduits à capituler devant les scientifiques.
Catherine Malabou, Métamorphoses de l’intelligence. Que faire de leur cerveau bleu ? Puf, 182 p., 15 €
Contrairement à ce qui pourrait sembler aller de soi, l’intelligence n’est pas vraiment un problème pour les philosophes. Ce qui leur importe, c’est la raison, ses normes, ses modalités, ce que son usage rigoureux promet. Jadis, ils parlaient de l’âme, que certains distinguaient de l’intellect. Ils préfèrent désormais décrire la conscience et ses manifestations. Alors que la notion d’intelligence est d’usage courant dans les magazines ainsi que (hélas !) dans le discours de la plupart des enseignants et de ceux qui se piquent de pédagogie, les philosophes la dédaignent, la considérant sans doute comme trop floue pour qu’il vaille la peine de s’y attarder.
Peut-être pour cette raison même, les psychologues s’en sont emparés et, à défaut de définir clairement l’intelligence, ont entrepris de la mesurer. Ce furent d’abord, au début du siècle dernier, les échelles métriques de Binet-Simon, puis l’énorme succès américain de la notion de quotient intellectuel grâce à laquelle on peut enfin prouver scientifiquement que les Africains sont moins intelligents que les Anglo-Saxons blancs et protestants. Grâce aux mêmes tests, on peut aussi prouver que les immigrants qui débarquent à Ellis Island sans savoir un mot d’anglais font preuve d’une intelligence très inférieure.
Toute la question, pour un philosophe, est de savoir si, découvrant de telles pratiques, il peut se contenter de se détourner en se pinçant le nez. Bergson est un des rares à s’être donné la peine d’argumenter, suivi, un demi-siècle plus tard, par Canguilhem. Si les arguments de l’un et de l’autre restent convaincants, ils ont le défaut de ne toucher que ceux qui sont sensibles à la philosophie tout en laissant le champ libre à ceux qui se parent des plumes de la scientificité.
Catherine Malabou qui, enseignant en Grande-Bretagne et aux États-Unis, connaît de près ce que l’on n’ose appeler la littérature sur la question, s’efforce depuis des années d’intervenir en tant que philosophe sur ce terrain. Regrettant la tactique trop défensive de la tortue, elle dialogue avec les psychologues et les spécialistes des neurosciences et de l’intelligence artificielle, afin de déterminer une position philosophiquement solide qui soit audible même par eux. Dans cette entreprise, elle avance lentement et ne peut marcher droit mais cette errance même est instructive.
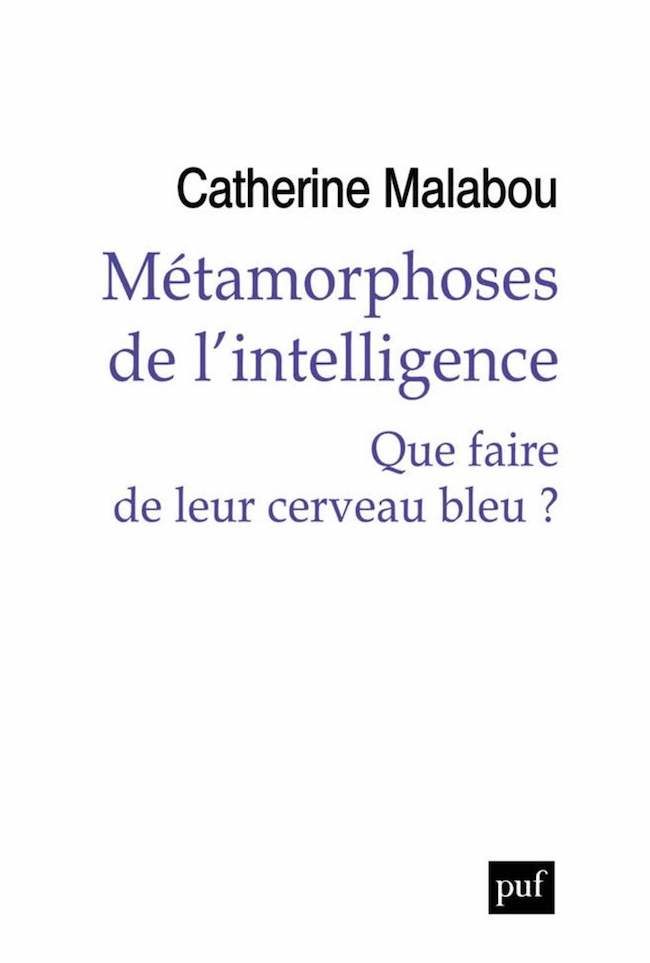
Point n’est besoin de faire montre d’une grande acuité philosophique pour percevoir et dénoncer le caractère ouvertement réactionnaire et raciste d’un certain usage américain des tests de QI. À quoi toutefois les intéressés pourraient répondre, comme fit Watson, Prix Nobel pour la découverte de la double hélice de l’ADN, en invoquant, en 2007, avec une désarmante bonne foi, la rigueur scientifique de résultats qu’il ne serait pas le dernier à déplorer. D’autres dénonceraient plus crûment la naïveté des belles âmes si attachées à leur illusoire conception moralisante d’une prétendue égalité d’intelligence entre les humains. Les choses sont plus délicates face à un psychologue comme Binet dont l’intention est explicitement progressiste : mesurer l’intelligence des enfants pour mieux prendre en charge scolairement les moins doués.
Quand Bergson lui oppose que l’on ne saurait mesurer une intensité, les philosophes sont tentés de l’approuver : prétendre mesurer une intensité ou une qualité est une contradiction dans les termes, puisque le qualitatif est par définition ce qui échappe à la mesure. Dire que l’on ne mesure que du quantitatif n’est pas une thèse que l’on pourrait discuter, c’est une définition. Mais l’enjeu n’est pas que de précision conceptuelle car le psychologue peut rétorquer, outre sa prétention à la scientificité, qu’il cherche, lui, à aider les pauvres enfants peu doués tandis que le souci de précision conceptuelle est un bon prétexte dont usent les philosophes pour s’enfermer dans leur tour d’ivoire.
Canguilhem voyait les philosophes remonter la rue Saint-Jacques vers le Panthéon tandis que les psychologues la descendraient vers la préfecture de police. C’est évidemment une vision de philosophe, que Catherine Malabou n’a pas tort d’assimiler à la tortue de Marc Antoine. Le plus important n’est pas que cette prétention soit irritante pour ceux qu’elle déprécie, c’est qu’elle est peut-être dénuée de pertinence, moins du côté du Panthéon que de celui de la préfecture de police. Ce procès qu’ils font volontiers aux « sciences humaines » pourrait bien être une commodité intellectuelle que s’accordent les philosophes, même s’ils n’ont pas tort de blâmer des contradictions comme la mesure du qualitatif. Mutatis mutandis, la situation est comparable à celle des débats internationaux sur les normes commerciales : il est vrai que la bière ne se fait pas avec du riz mais, dans la mesure où l’Allemagne est le seul pays du monde à ne pas le faire, exiger qu’il n’y ait pas de riz dans la bière peut être tenu pour une disposition protectionniste. Il y a semblablement quelque chose de protectionniste dans l’exigence de rigueur conceptuelle si chère aux philosophes.
La situation a évolué depuis quelques décennies. Il ne s’agit plus tellement de rompre des lances contre les tests de QI – il est sans doute trop tard pour espérer dissuader les Américains de les pratiquer à grande échelle et les prétendus modernistes européens de les imiter –, l’enjeu s’est déplacé vers la question de l’intelligence artificielle. Dans une société envahie par l’informatique, on ne peut feindre de négliger la représentation de l’intelligence qu’ont mise en œuvre les concepteurs des ordinateurs. Il n’y a rien d’académique dans l’exigence de comprendre comment fonctionne l’ordinateur que chacun de nous utilise. Ce n’est certes pas la machine qui raisonne, mais celle-ci met bien en jeu des modes de raisonnement, ceux que les théoriciens de l’informatique attribuent à l’intelligence humaine – si tant est qu’il puisse y en avoir d’autres. Quand nous nous exaspérons contre la machine parce que nous butons sur ce qui nous paraît une manière absurde de raisonner, c’est à une certaine conception de ce que doit être l’intelligence que nous nous en prenons. Que nous le voulions ou non, celle-ci devient donc un problème philosophique.

Face à des recherches technoscientifiques comme celles qui tendent à cartographier le cerveau avec pour but de « produire un jour une conscience artificielle capable de s’auto-transformer en accédant à son code source », on se contente souvent de réagir sur le mode de la bioéthique et de lancer dans le vide des alertes sans effet. La technophobie est une attitude commode et aussi illusoire que toute réaction moralisante. Il faut toutefois reconnaître qu’il n’est pas toujours aisé de rester serein quand d’aucuns prétendent élaborer une « neuroscience de l’art » qui, comme par hasard, préférera la peinture figurative à l’art abstrait et la « vraie musique » romantique aux horreurs de l’atonalisme qui « n’éveille pas l’intelligence ». Il est plus valeureux, pour qui prétend à la philosophie, de chercher à engager le dialogue avec les spécialistes de ces questions afin d’en évaluer les enjeux et de tenter de formuler ce qui pourrait être une voie prometteuse. Ce que Catherine Malabou appelle « la démocratie expérimentale ». Du coup, il redevient possible de mobiliser de solides références philosophiques, aussi bien du côté des Méditations pascaliennes de Bourdieu que des réflexions de Dewey, contemporain américain de Bergson qui n’apparaît plus aussi éloigné de nous.
Sa réponse intéresse, bien sûr, mais plus encore la démarche qu’elle adopte, faite de tâtonnements reconnus comme tels. Plutôt que la tactique défensive des soldats romains, la tortue à laquelle on pense alors serait cet animal connu pour la lenteur et la détermination de sa marche. Catherine Malabou résiste ainsi à deux tentations auxquelles succombent volontiers les philosophes : camper dans l’opposition philosophique aux psychologues ou se faire le vulgarisateur plus ou moins critique des recherches technoscientifiques, en l’occurrence celles qui portent sur l’intelligence artificielle. Elle passe donc victorieusement entre Charybde et Scylla.












