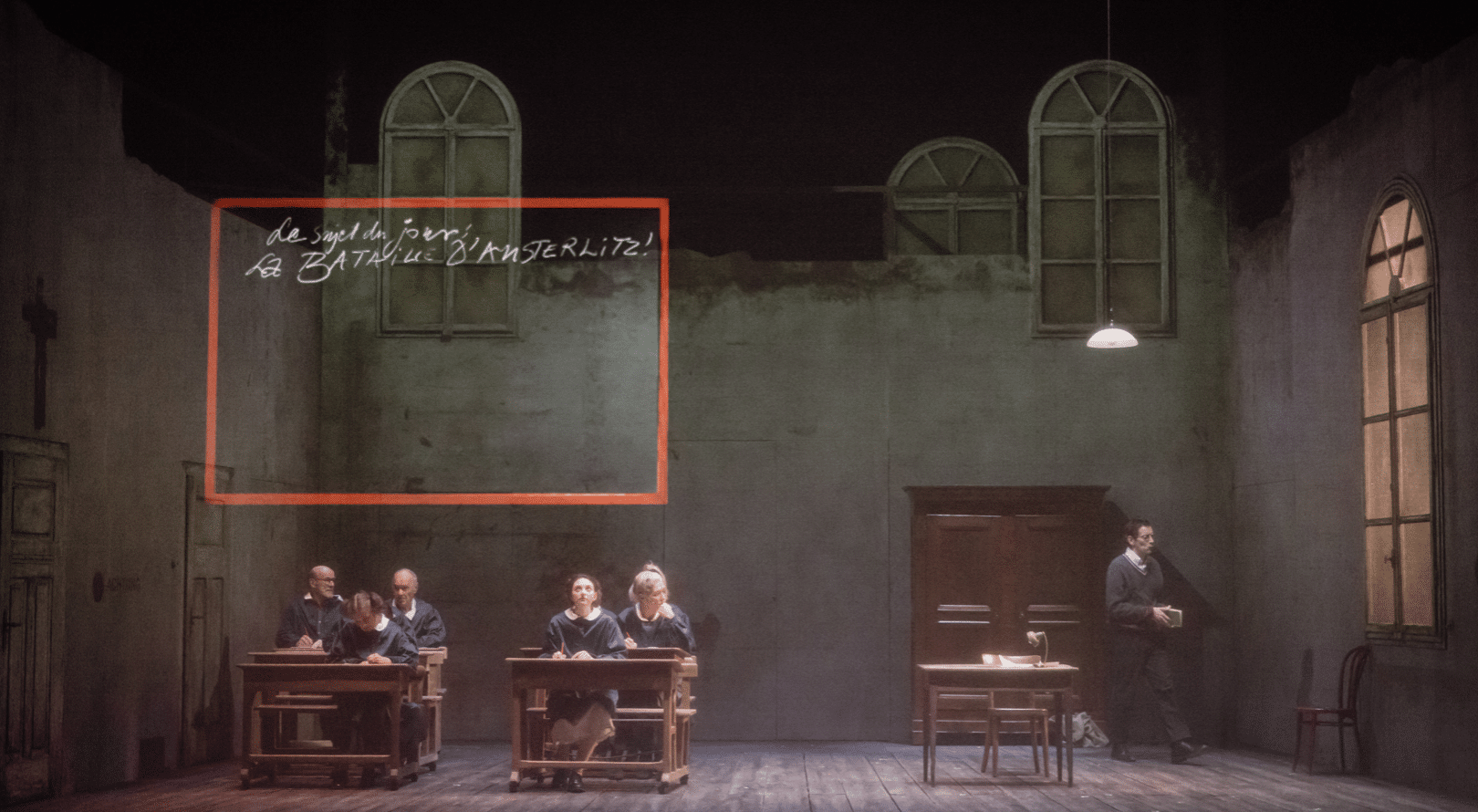La grande proximité de l’interprète et du spectateur constitue une expérience singulière, proposée le plus souvent par les salles du théâtre privé. D’ici la fin de la saison, Constellations de Nick Payne par Marc Paquien au Petit Saint-Martin, La Dernière Bande de Samuel Beckett par Peter Stein à l’Œuvre, Pourquoi je suis là ? d’Alain Pierremont par Anne-Marie Lazarini à l’Artistic Théâtre offrent quelques occasions d’apprécier une fois encore cette spécificité du spectacle vivant.
Nick Payne, Constellations. Mise en scène de Marc Paquien. Petit Saint-Martin jusqu’au 18 juin.
Samuel Beckett, La Dernière Bande. Mise en scène de Peter Stein. Théâtre de l’Œuvre jusqu’au 30 juin.
Alain Pierremont. Pourquoi je suis là ? Mise en scène d’Anne-Marie Lazarini. Artistic Théâtre jusqu’au 30 juin.
La représentation théâtrale n’a jamais craint de se déployer dans de vastes espaces. En France, la salle du TNP du temps de Jean Vilar, la cour d’honneur du Palais des papes à Avignon, avant sa sonorisation, laissent imaginer la performance alors exigée des interprètes. L’utilisation des micros HF, la projection de gros plans en vidéo sont devenues des pratiques courantes qui tendent à modifier l’art de l’acteur. Mais il y a toujours une émotion particulière à entendre le timbre d’une voix en direct, à découvrir de près sur un visage la diversité des expressions.
Il est des pièces qui semblent requérir cette approche. C’est par exemple le cas de Constellations du jeune auteur britannique Nick Payne, créée en 2012, avec grand succès, au fameux Royal Court de Londres, actuellement présentée, dans un texte français d’Elisabeth Angel-Perez et de Manuel Piolat-Soleymat, au Théâtre du Petit Saint-Martin. Elle pourrait évoquer de manière quelque peu prévisible une relation amoureuse, vécue sur un mode très contemporain : rencontre et intimité physique, hésitations et dérobades, séparations et retrouvailles. Mais Roland est apiculteur, Marianne enseignante chercheuse en physique quantique ; la dramaturgie s’inspire de cette spécialité, précisément de la théorie des multivers, ainsi appliquée à leur couple : « Si on dit que notre univers est le seul qui existe vraiment. Il n’y a donc qu’un seul et unique toi et une seule et unique moi. Si c’est vrai, alors il ne pourra jamais y avoir qu’un seul choix. Mais si chaque futur possible existe, alors les décisions qu’on prend ou qu’on ne prend pas vont déterminer lequel de ces possibles finira par se réaliser. »
Ainsi d’un univers à l’autre, d’un temps à un autre, certaines séquences sont sujettes à de subtiles variations, alternent des tonalités les plus diverses, à l’encontre de toute linéarité ; par exemple des allusions indéchiffrables à une maladie font déjà peser une gravité inattendue sur la légèreté des premiers moments. C’est dire les nuances exigées par la reprise à quelques mots près, et non la simple répétition, des mêmes épisodes. D’entrée Christophe Paou impose la finesse de son interprétation, vue « de si près » ; Marie Gillain semble d’abord souligner les contrastes, avant que ne se devine progressivement, dans la perturbation de la chronologie, la nécessité d’un double jeu hanté par la mort. Rien dans la mise en scène et la scénographie de Marc Paquien ne vient parasiter la performance des deux comédiens, le plus souvent debout dans un espace abstrait : sorte de disque suspendu, mur du fond diversement éclairé (lumières de François Menou) d’un univers à l’autre. Et s’il y a sonorisation du plateau, elle n’intervient que brièvement lors de quelques séquences, comme équivalent des variations typographiques dans le texte.
Au Théâtre de l’Œuvre, la voix de Jacques Weber ne s’entend pas toujours en direct dans La Dernière Bande de Beckett. Elle sort d’un magnétophone, le temps que Krapp écoute l’enregistrement de sa trente-neuvième année. Mais de prime abord, son visage découvert « de si près » ne peut que sidérer le spectateur qui aurait vu la pièce à plusieurs reprises ces dernières décennies. L’écrivain a lui-même mis en scène quatre fois son texte, en anglais, allemand, français, de 1969 à 1977, a laissé des cahiers de notes très précises, a suscité une « tendance à la formalisation », selon l’expression de Bernard Dort. Il a ainsi instauré une sorte de tradition qui a fini par supplanter le texte écrit en anglais en 1958, traduit par lui en collaboration avec Pierre Leyris, publié en mars 1959 dans Les Lettres nouvelles, puis par les éditions de Minuit. Peter Stein a choisi de revenir à la première version dans une totale fidélité aux didascalies. Contrairement à ce qui a été dit et écrit, il ne suscite pas de surenchère, par exemple dans le jeu avec les bananes ; tout juste à propos de la seconde, il accentue le geste indiqué, « il flanque la peau dans la fosse », et la fait jeter en direction du public, faute de l’espace nécessaire entre la scène et la salle.
« Le vieil homme avachi », le clown effondré sur sa table métallique avant même le début de la représentation, correspond à la description : « Visage blanc. Nez violacé. Cheveux gris en désordre » (maquillage et perruque dus au magnifique travail de Cécile Kretschmar ). Il porte bien une « surprenante paire de bottines, d’un blanc sale, du 48 au moins, très étroites et pointues ». Il est pris régulièrement d’« accès de toux », il marche de plus en plus difficilement, à mesure que se répète en coulisses « le bruit du bouchon qu’on tire ». Il retrouve cette « voix poussive et cassée », entendue par Beckett à la BBC, celle de l’acteur Patrick Magee, qui lui inspira le monologue, qui fut le créateur du rôle. Ainsi un très grand metteur en scène, un très grand acteur redonnent à une pièce légendaire sa verdeur originelle. Frédéric Franck quitte sur une belle réussite le Théâtre de l’Œuvre qu’il doit vendre après quatre saisons ; en 2012 il avait déjà ouvert une programmation ambitieuse avec ce même texte, mis en scène par Alain Françon avec Serge Merlin.
Il y a une proximité plus grande encore que celle des petites salles, celle des espaces privés. Alain Grasset avait créé en 1989 le premier Festival mondial de « théâtre à domicile ». Sous son nom d’auteur, Alain Pierremont, il participe, avec sa pièce Pourquoi je suis là ?, à la programmation Artistes en appartement(s), coproduite par la Poudrerie de Sevran et les Athévains. L’originalité du projet tient à la double proposition : « un théâtre dans mon salon » ou « mon salon dans un théâtre ». À l’Artistic Théâtre, dans le onzième arrondissement de Paris, a été installé un petit lieu, adapté à la pratique du « théâtre à domicile » pour ceux qui ne disposeraient pas chez eux d’un espace assez grand. D’ici la fin juin, il est utilisé par différents artistes, mais il sert principalement pour la mise en scène par Anne-Marie Lazarini de Pourquoi je suis là ? : cadre intime pour une histoire familiale, pour la rencontre d’amis et de voisins.
En cinq séquences, deux monologues d’un père, deux monologues du fils, suivis de leur unique dialogue, la pièce parcourt un demi-siècle, depuis la naissance en 1947 du fils jusqu’à l’annonce en 1997 d’un enfant à naître, l’arrivée d’une nouvelle génération. Elle évoque l’incompréhension entre deux hommes, chacun enfermé dans son silence, dans son amour pour une femme disparue, l’épouse et la mère. Lors des premières représentations, Bruno Andrieux (le père) n’avait manifestement pas encore adopté la juste distance par rapport à un public si proche, déjà trouvée par Cédric Colas (le fils). Mais cette part de maladresse pouvait ajouter au trouble des spectateurs eux-mêmes exposés aux regards, privés de la séparation entre la scène et la salle, de l’obscurité protectrice. Anne-Marie Lazarini laissait aux deux interprètes toute l’aire de jeu, indiquant le passage du temps par le simple affichage des dates, la diffusion d’une chanson représentative de chaque époque. Un gyrophare d’ambulance, suggérant l’internement psychiatrique de sa femme par le père, témoignait d’un minimalisme revendiqué. Les petits jouets et peluches accrochés dans une sorte d’arbre généalogique, à côté de photos d’enfance, celles confiées par les membres de l’équipe, semblaient comme une incitation à personnaliser par des apports privés ce « salon dans un théâtre ».