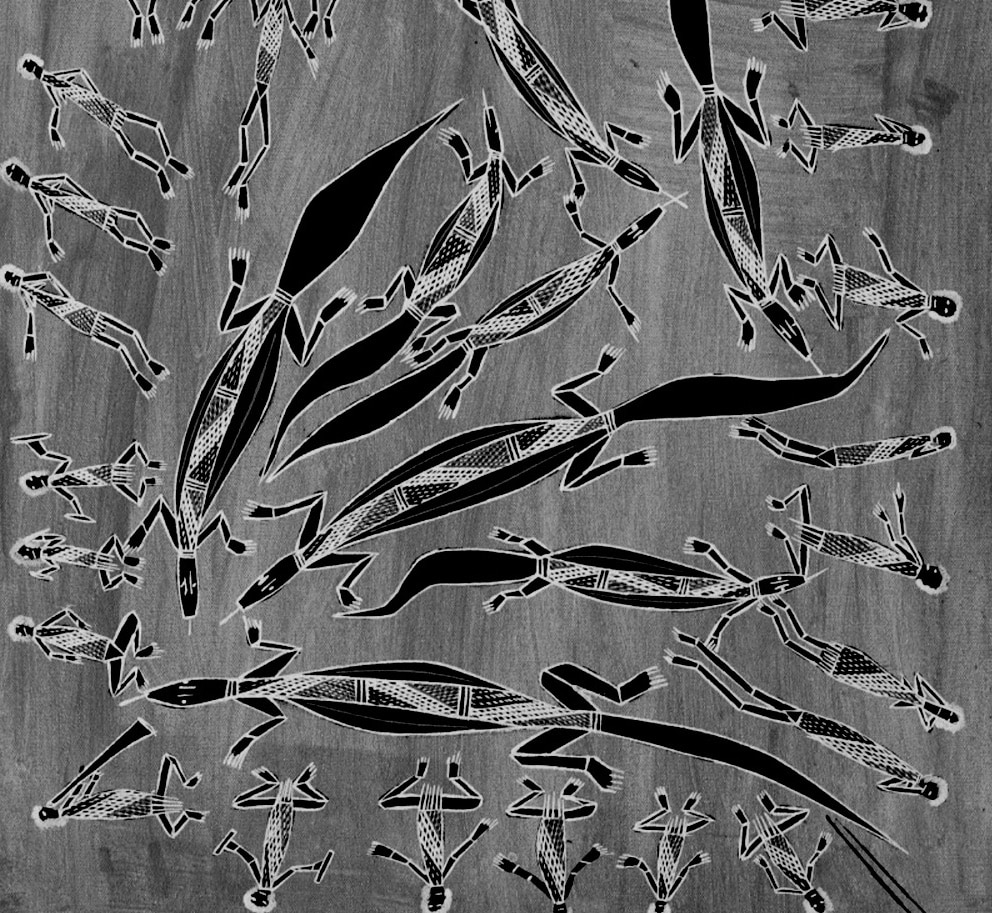Il faut imaginer Aragon au téléphone chez lui, dans son appartement parisien, ce 12 mars 1953. Il vient de boucler le dernier numéro des Lettres françaises, publication liée au Parti communiste qu’il dirige depuis quelques semaines. Au bout du fil, son rédacteur en chef, Pierre Daix. C’est à lui qu’il lâche : « Toi et moi avons pensé à Picasso, à Staline. Nous n’avons pas pensé aux communistes. » L’affaire du portrait de Staline vient d’éclater. Elle est le sujet d’un petit volume, passionnant, paru à La Fabrique. Son auteur, Laurent Lévy, en déplie les méandres avec un réel talent de conteur. Il en propose même une exploration méticuleuse, s’attaquant aux questions esthétiques, théoriques et politiques qu’elle soulève.
La mort de Staline survient le 5 mars 1953. C’est une « terrible nouvelle » dans les rangs communistes, étant entendu, comme le rappelle Laurent Lévy, qu’à l’époque « être communiste ou être stalinien, les expressions sont synonymes » (sauf pour des minorités révolutionnaires, trotskystes ou libertaires, aussi courageuses que marginales). Et au-delà, puisque l’auteur rappelle que le pape invite à prier « pour l’âme de Staline » et qu’un deuil national de trois jours est décrété en France. Le dictateur est encore largement, et avant tout, considéré comme l’un des vainqueurs du nazisme.
Aragon est chargé de composer un numéro d’hommage des Lettres françaises, hebdomadaire culturel du parti. Il a les contributions de Frédéric Joliot-Curie, de Georges Sadoul, la sienne évidemment. Pour la une, il lui faut un portrait et c’est vers « le plus grand peintre vivant » qu’il se tourne : Picasso. Ce dernier a adhéré au PCF en octobre 1944, recevant sa carte des mains de Jacques Duclos. Aragon, lui, a été élu au comité central en 1950 en qualité de « grand intellectuel ».
Picasso accepte et le portrait arrive. Le dessin s’inspire d’une photographie de Staline jeune, prise en 1903. Dès la sortie des presses, les salarié·es de L’Humanité et de France nouvelle qui partagent les locaux se scandalisent – d’où l’appel téléphonique de Pierre Daix. C’est le tollé dans le parti, il sera démesuré. Elsa Triolet a saisi ce qui est en jeu : Picasso « n’a pas déformé le visage de Staline. Il l’a même respecté. Mais il a osé y toucher ». La crainte de « déformation » habituellement associée à l’une des figures de proue du cubisme – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – n’est pas le pire des griefs.

Picasso « dessine un personnage qui n’a rien de surhumain, comme un brave paysan géorgien, un jeune homme tout simple, qui semble avoir plus de choses à apprendre qu’à enseigner ». Ça n’est pas un « vrai Staline » : il n’est pas revêtu des habits et des médailles de maréchal de l’Union soviétique, il n’a pas le regard résolument tourné vers l’avenir radieux que construit la « patrie du socialisme ». Sans le vouloir, Picasso s’est fait iconoclaste – il réagira avec bonhomie à tout ce raffut, étranger aux instrumentalisations politiques de l’art.
Or, depuis le début des années 1930, le « réalisme socialiste » s’est imposé en URSS. Toute œuvre doit respecter un « académisme rigide et sans âme », présenté comme seule garantie de son accessibilité, elle-même condition nécessaire à l’édification des masses. À l’exact opposé, le manifeste Pour un art révolutionnaire indépendant de 1938, signé André Breton et (bien que son véritable coauteur soit Léon Trotski) Diego Rivera, défend qu’en matière de « création intellectuelle [la révolution] doit dès le début même établir et assurer un régime anarchiste de liberté individuelle ». C’est bien cette liberté qui est insupportable à ceux qui n’imaginent le socialisme qu’associé à l’ordre et à la discipline. Il n’est pas question d’ailleurs que de l’artiste. L’émancipation de celle ou celui qui lit, écoute ou regarde est, elle aussi, entravée. Ce qu’analyse par exemple John Berger : « La création artistique, que l’académisme réduit pour l’artiste à un mécanisme, est réduite pour le spectateur à un véhicule. Il n’y a pas l’ombre de dialectique entre l’expérience éprouvée et son expression ou sa formulation. » [1] Autrement dit, c’est l’annihilation de toute relation vivante entre réception et réflexion.
Cette dialectique-là échappe visiblement aux quelques hommes qui ont en charge la direction du Parti en 1953. Ils sont trois, François Billoux, Étienne Fajon et, surtout, Auguste Lecœur à décider le 17 mars d’une communication du Secrétariat du PCF (dont seul est membre le troisième) « désapprouvant catégoriquement » la publication du portrait. Un autre personnage les en avait pressés : André Fougeron, ancien métallurgiste et peintre se voulant à la pointe du réalisme socialiste à la française. Il s’est offusqué, dans une lettre à Lecœur, rendue publique, « qu’un ou des camarades responsables [des Lettres françaises] aient cru pouvoir publier une telle profanation ». Rien de moins. Profondément affecté, Aragon est au bord du suicide.
Maurice Thorez, secrétaire général du Parti et ami d’Aragon, est « soigné » à Moscou depuis deux ans. C’est l’un des nœuds de l’affaire : un affrontement de direction est à l’œuvre, et s’en prendre à Aragon c’est viser Thorez. L’historien du PCF qu’est Laurent Lévy sait nous entraîner dans les arcanes de ce parti [2]. Il en identifie une constante, le mouvement de balancier entre les orientations « classe contre classe » et « Front populaire », la première se caractérisant par un sectarisme téméraire, la seconde par son insertion démocratique. Nous sommes en pleine guerre froide et, en l’absence de Thorez, Lecœur penche pour la première option. Des initiatives aventureuses sont prises, non sans conséquences : de nombreux membres du Parti sont embastillés. L’esprit de citadelle assiégée domine. Autre conséquence pointée par l’auteur : « La raideur politique a pour corollaire une certaine raideur dans la relation avec les intellectuels. Qu’ils n’aillent pas croire qu’ils vont faire la loi ! »
Feu sur Aragon, donc. On exige de lui qu’il publie dans Les Lettres françaises une sélection de courriers peinés ou outragés. Dix-sept le seront dans le numéro du 26 mars. On y lit l’attachement « aux choses que nous comprenons », comme le dit un militant d’usine. Y succède une longue autocritique d’Aragon – il lui faut en passer par là – qui veut s’adresser aux sincères tout en méprisant les serviles. Sous l’apparence de la docilité, il contre-attaque. Sans toutefois, ne nous méprenons pas, se révéler partisan d’un « art révolutionnaire indépendant ». Récusant tout tropisme anarchiste en art, convoquant d’ailleurs les œuvres de Staline en personne, il tient ainsi à affirmer, d’abord, l’opposition radicale entre émancipation individuelle et émancipation collective (préjugé doctrinaire « dont on pourrait discuter le bien-fondé du point de vue même de la pensée de Marx », comme le note fort justement Laurent Lévy). Aragon, en familier de la grammaire léniniste, dénonce ensuite une forme de « populisme » dans les critiques qui l’ont visé : soit une abdication du travail d’avant-garde. Au sein de laquelle, bien sûr, les intellectuels ont toute leur place, lui au premier chef.
La boucle est bouclée et le retour de Thorez le 10 avril enfonce le clou. Ce dernier va « corriger » la ligne (avant de purger Lecœur). À la une de L’Humanité du 23 avril, une photographie clôt l’affaire : on y voit Picasso et Thorez, en pieds, deviser amicalement. En légende : « Le secrétaire général du Parti Communiste Français s’entretenant avec le grand peintre. »
De ce morceau d’Histoire, brillamment élucidé, Laurent Lévy discerne en définitive les enjeux de la confrontation entre art, peuple et politique (ici incarnée dans le Parti). Ce n’est pas le moindre des mérites de son livre que de nous inviter à les réfléchir et à les discuter.
[1] John Berger, Art et révolution, Denoël, 1970. L’ouvrage, épuisé, est publié dans la collection des « Dossiers des Lettres nouvelles », liée à la revue du même nom, dirigée par Maurice Nadeau – ce qui mérite d’être signalé ici.
[2] Laurent Lévy a lui-même été membre dix années durant du PCF. Il a publié récemment Histoire d’un échec. La stratégie « eurocommuniste » du PCF (1968-1978) aux éditions Arcane 17.