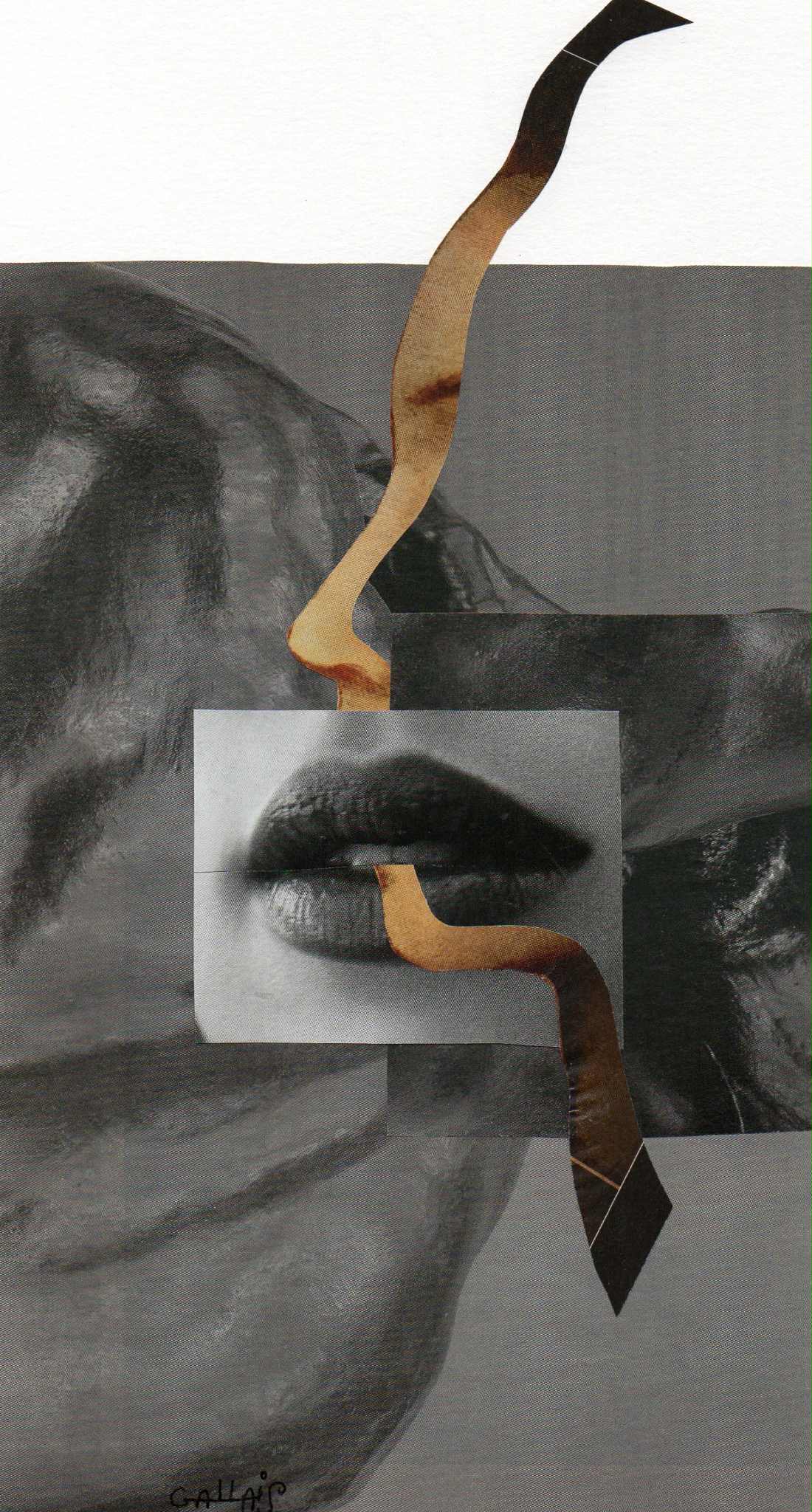Le délicieux, avec la poésie, c’est qu’il arrive qu’on l’aime bien qu’elle demeure obscure, qu’elle consente seulement à entrouvrir sa porte pour nous donner à voir un pays-paysage d’autant plus désirable qu’il paraît interdit. Dominique Quélen paraît nous déclarer : « Je ne suis pas dans moi » ; « Je me dépose ailleurs ». Anne Malaprade, quant à elle, prend le chemin des contes dont elle emprunte la voix.
Dominique Quélen met en exergue de sa troisième section, intitulée « Bancals et malfaisants », une phrase de Jean-Patrick Manchette qui donne exactement le ton de sa « matière » autant que de sa manière : « C’était une histoire assez épouvantable que je lui racontais mais c’était assez agréable de la lui raconter. » Sa matière est effectivement peu amène, mais sa manière enchante. En voici un exemple : « Qui perd un parent est orphelin, qui perd un enfant n’a pas de nom, qui perd un frère. Il est préférable d’avoir tout perdu, d’être le disparu du frère plutôt que du père. »
Ses textes, brefs paragraphes ou séquences avec titres, organisés en huit chapitres de longueurs très variables, racontent des catastrophes et suscitent un rire jaune ou un sourire en coin. Les corps et les objets s’empoignent et se confondent. Qui appartient à quoi ? On se demande : « Le chien te poursuit de ses crocs. Qu’un mollet tombe à terre, il s’en empare, un chasseur était caché […], il cherche à s’échapper. C’est lui qui depuis le début pédale en toi, plus rapide, composé du chien plus vif d’esprit qui te suit et t’avale à travers la chair où tu es répandu ». On pense à Henri Michaux et Samuel Beckett. Tragique et burlesque emmêlés.
Chaque texte obéit à une logique devenue folle et en même temps follement maîtrisée, une faconde sans issue, comme irrécupérable, et pourtant bonne à prendre, si bonne à prendre qu’on n’en souhaite pas d’autre. Dans cet univers où tout est sinistre et sombre, on préfère attendre. Ne pas se précipiter dans les pages d’un livre est toujours préférable, on ne le savoure qu’avec plus de plaisir et de précision. Un homme – le narrateur ? – tombe dans la zone marécageuse d’un vieux lavoir, ses pieds se racornissent, de même que ses baskets, abandonnées plus loin. Toujours il y a un frère qui le précède ou qui le suit, un frère multiple, un frère pareil, indémodable, irremplaçable. Ce qui est beau n’existe pas. Mais ce qui est pénible existe : un corps devient caillou quand l’aide-soignante lui prodigue ses soins, « tout le bas pend sous l’autre moitié », les repères sont perdus, toutes choses se mélangent, les formes tombent « d’un ciel dans l’autre » ou bien c’est un corbeau qui tombe dans un poème.

Vertige. Où sommes-nous ? Qui est ce personnage au corps multiplié, qui s’entremange et qui se quitte ? Pourquoi nous est-il étranger, ne nous parle-t-il pas ? Il y a comme un trou dans la langue. Quand l’insolite fait merveille, la matière dont nous sommes fabriqués est aussi la matière de l’écrit.
Épuiser le viol, d’Anne Malaprade, présente des ressemblances avec le livre de Dominique Quélen. Ils expriment tous les deux la souffrance des corps, qui se cachent sous les mots, qui sont comme à jeter, comparables aux objets, aux éléments d’un mobilier descendus dans la rue, étiquetés et déposés, adossés aux façades, afin d’être emportés par les camions de la voirie. Dans les deux cas également, le sens chemine d’un mot à l’autre, il peut passer, doué de grandes ailes, de viol à vol, à enviolé et à Violette… Après le titre, les deux exergues, tirés de la correspondances de la marquise de Sévigné, proposent celui d’un animal, qui s’avère, par la suite, capital : « J’ai passé tous ces jours-ci comme un loup-garou, ne pouvant faire autrement » et « À propos, il y a des loups dans mon bois ».
Quel humour délicieux ! Mais en même temps le danger rôde, et cela d’autant plus que le loup, comme le viol, se décline, qu’ils ont entre eux des parentés. N’est-ce pas le loup qui autrefois avait violé l’Enfant venu voir sa Mère-Grand ? Donc le loup se décline, en louve, bien entendu, en love, en lune… que sais-je. Ajoutons le Petit pour tomber à pieds joints dans « l’abîme familial ». Nous voilà presque dans l’univers du livre précédent, du moins à première vue. « Les matières stagnent et font remonter le niveau des eaux » ; « Les poussières s’épaississent et cerclent les formes » ; « Petit vit sur écoute », « branché à des membres automatiques, il surdoue la pulsion ». Les personnages s’interpénètrent, jusqu’à se perdre l’un dans l’autre, à n’avoir plus d’identité : « Elle ne précise plus qui est présent derrière les pronoms. Il faudrait inventer un quatrième genre ».
Mais chez Anne Malaprade, le pronom, le prénom est un masque. Il permet d’exprimer autre chose, par exemple le désir de la femme d’échapper au destin qu’on lui trace, à une identité qu’elle juge insuffisante, ce dont elle semble se punir par des automutilations, des scarifications, autrement dit des sacrifices… : « Louve doit marquer son corps » ; l’étrangeté demeure grave, l’onirisme est chargé de cérébralité : « Elle fait surgir la part du corps qui meurtrit l’écrit ». « Peut-être qu’elle bat la langue, peut-être qu’elle pousse les mots au combat ». Il y a, comme de juste, de la violence chez celle qui cherche à épuiser le viol, « les cheveux donnent le fouet », « les vêtements de nuit rentrent dans la gorge », les regards peuvent être belliqueux et les mots devenir des flèches.
Avec Anne Malaprade, il y a de la peur, des maux et des médications. C’est en fait toute une vie qui se déroule là, derrière l’écran du texte ou sur la scène d’un conte à la Mme d’Aulnoy ; une vie de tragédies feutrées car tues, de combats difficiles, de hontes bues et de victoires modestes. « Il n’y a pas d’endroit agréable, puisque notre corps nous empêche de sortir » (Georges Perros). Anne Malaprade, comme Dominique Quélen, ne cède pas au drame qui couve, elle le tient à distance, elle le retient, par l’écriture.
Quoi d’autre, pour clore ces deux évocations, que le réjouissant et merveilleux petit livre qui nous parvient comme un cadeau de fin d’année, parfaitement adapté aux univers de nos deux auteurs, les Pensées collées de Georges Perros, d’où est extraite la citation précédente ? On aimerait les citer toutes. Leur bonhommie acerbe, leur familiarité, leur profondeur discrète enchantent : « Aimez-vous les uns les autres et foutez-moi la paix » ; « Je suis sûr que Dieu existe. Quant à y croire, c’est une autre affaire ». Ni Dieu, ni Diable, ni Maître, mais la vie simple et naturelle, car « l’existence est ici », avec la poésie, fidèle compagne, jamais quittée, dont le poète nous donne au fil des pages des aperçus et des définitions qu’on aimerait avoir écrites : « Ce n’est pas pour être lu qu’on écrit. Pour être vécu, un peu » ; « La poésie donne le plaisir de ne pas comprendre » ; « J’écris quand je sens que je passe par moi ».