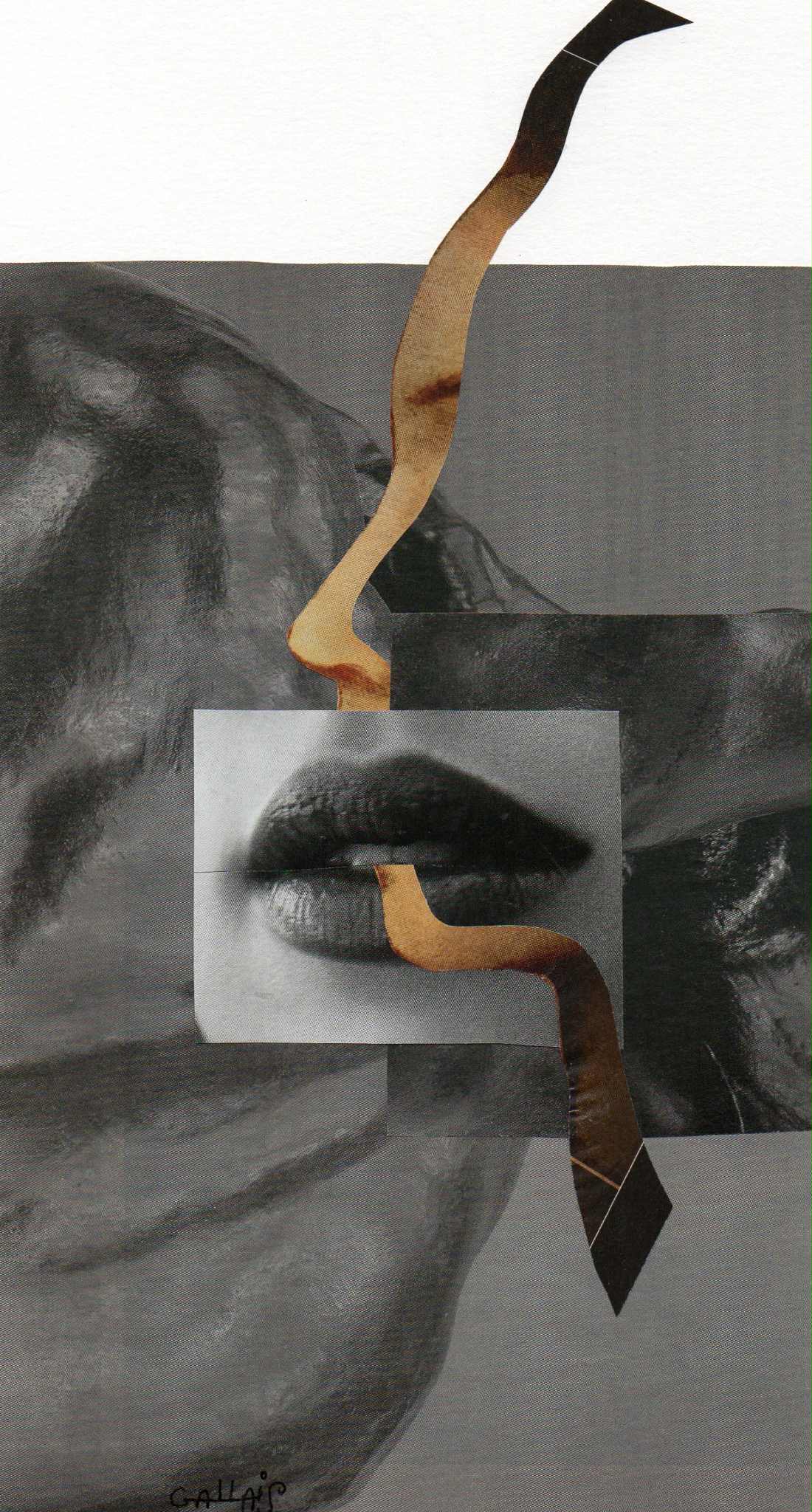Décharge, poème publié par Séverine aux éditions LansKine, est aussi bref qu’intense. En quelques dizaines de pages, elle retrace son histoire, avec une économie donnant à chaque mot, chaque blanc, chaque retour à la ligne, une énergie qui pulvérise l’oppression. En désignant les mécanismes de la domination dans la famille, fléau largement étayé par une idéologie dominante, celle du « faire famille », elle cartographie l’inceste et sa spécificité si bien partagée.
« Quelle famille », écrit-elle, et qui d’entre nous ne peut pas, peu ou prou, se joindre à cette exclamation ? Mais, dans le rythme d’un texte qui ne laisse aucun répit, d’autant plus que l’autrice s’adresse à elle, sous la forme du « tu », et donc à nous, à toi, et surtout à toi, Séverine dit tout : « Imagine que tu n’imagines pas ce qui peut arriver. » Elle dit tout des failles de la mémoire, du doute qui ronge comme un poison, de la domination patriarcale, bourgeoise, médicale, du corps de l’enfant puis de la jeune fille livré aux mains expertes de la mère puis du père, « la médecine à papa », et rappelle la très grande serviabilité des victimes, toujours : « Pour assurer tes arrières, tu endosses tout, à commencer par la honte. Ta honte est essentielle, elle peut sauver les tiens, qui peuvent continuer. » Mais il s’agit aujourd’hui de « cesser de consentir au meurtre ». La poésie est là pour que cela cesse, Séverine joint sa voix aux autres voix, sa voix magnifique et magistrale, « au moins est-on une ribambelle d’allié.es qui tentons de nous désaliéner », et c’est dans les blancs de la poésie de Séverine, dans ses mots, que nous pouvons mettre nos espoirs d’enfin « converser », avec nous-même aussi, et que nous pouvons puiser une énergie nouvelle, celle de continuer à écouter et à dire. Sans se décourager.
Séverine, vous êtes poétesse, et cette histoire que vous racontez dans Décharge, qui est votre histoire, vous lui donnez une forme poétique. Vous écrivez à la fin du livre : « Ce qui compte n’est pas ce dont tu témoignes, mais la forme que tu inventes, ton choix possible, pour arrêter l’hémorragie, les générations sacrifiées ». Quelle est la genèse de ce texte ?
J’ai traversé un épisode de résurgence traumatique au cours duquel j’ai eu besoin de consigner les souvenirs qui me revenaient de manière chaotique. J’étais alors dans un état psychologique de dévastation et je n’avais pas confiance en ma mémoire. Pendant deux mois, j’ai écrit pour consigner ces souvenirs mais aussi pour les mettre à distance, sur la page. Je me suis retrouvée avec une matière textuelle qui n’avait pas de forme particulière et j’ai senti, après cette traversée, que je ne pourrais pas revenir à la vie sans lui donner une forme. J’ai commencé à la travailler pour l’articuler et cette organisation a été possible en infléchissant la langue, en la faisant rentrer dans une narration qui était alors comme en étoile, tentaculaire. Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas dites, et dont j’aurais eu besoin si j’avais fait le choix d’une narration plus classique, mais j’avais les éléments d’un réseau, et c’est ce réseau que j’ai essayé d’attraper dans le texte. C’est là que le fait d’être poète a joué, ce qui donne au texte sa forme fragmentée, qui ne dit pas tout, mais qui fait émerger un système.
Malgré la forme fragmentée un fil narratif très clair se déroule, de votre naissance à ce moment où vous dites retrouver votre dignité, d’une adresse, un « tu », à un « nous » qui surgit à la toute fin du livre. Est-ce la langue poétique qui a permis à ce fil d’apparaître de manière aussi claire ?
En effet, le texte va de ma naissance jusqu’au moment de l’écriture du texte, ce moment où j’évoque une dignité retrouvée. J’ai été prise dans une urgence vitale de reconstruction, et j’ai reparcouru des décennies d’existence en quelques semaines. Le livre couvre 55 années de ma vie en 56 pages, et c’est là que les ellipses jouent un rôle, que le travail sur la langue m’a permis de donner une cohérence à cette narration si rapide. Les lecteurs traversent une vie alors qu’il n’y a aucun élément lié au contexte, à une époque, à un lieu.
On lit d’ailleurs à la fin de Décharge : « Il ne s’agit pas d’englober la réalité, mais d’en désigner la faille. »
L’écriture poétique peut désigner cette faille, en nommant le système qui la permet. À partir du moment où c’est écrit, alors on peut se défaire de cette faille. Elle existe toujours mais elle ne me définit plus, je m’en désolidarise en la nommant, ou en tout cas en lui donnant forme car je ne suis pas sûre qu’elle soit nommée à proprement parler. Ou alors ce serait quoi ? Ce serait le mot « viol » ? J’ai voulu désigner des choses inédites. Les mots « viol » ou « inceste », ce n’est pas moi qui les ai posés sur ce qui m’est arrivé. J’évite de les réemployer, car j’ai l’impression qu’ils réduisent mon histoire à des représentations qui aplatissent les événements. Or le texte touche aussi les lecteurs qui n’ont pas la même histoire, car il désigne des systèmes de domination, de silenciation. Les événements ont eu lieu, je n’y peux pas grand-chose. En revanche, je peux affirmer une subjectivité qui a été niée.

Vous nommez aussi dans Décharge, lorsque vous parlez d’« incesteurs » et d’« incestueurs », et en cela vous vous attaquez à un déni social immense.
Beaucoup auront un mouvement de recul en lisant ces mots, mais j’ai l’impression de pouvoir les désigner au-delà même des termes, pour amener les lecteurs à les accepter. Quand on est victime de viol ou d’inceste, on a énormément de difficulté à sortir du doute, qui est un véritable poison, et c’est aussi cette sortie du doute que relate le livre.
Est-ce que cette sortie du doute est manifeste dans l’emploi récurrent du verbe « imaginer » et le fait que le texte soit presque entièrement écrit à la deuxième personne du singulier ?
Le tutoiement et le verbe « imaginer » sont des éléments qui me sont apparus immédiatement, comme si je m’adressais d’emblée à une autre, à ce double de moi, comme s’il fallait une mise à distance pour nommer les faits, comme si c’était encore très difficile de coïncider avec ma voix, pour dire ce qui s’était passé et comme si je me préservais moi-même de ce que j’allais raconter. Mais au fil du texte, je me réconcilie avec cette autre en moi complètement niée, en embarquant tous et toutes les autres. Ce n’est qu’en allant vers quelque chose de collectif et de systémique que j’ai pu accepter ce qui m’était arrivé.
Vous évoquez, non sans un certain humour, « notre lâcher de merde empaqueté », l’apparition du « nous » recouvrant ces voix qui dénoncent, et vous désignez aussi très clairement un autre poison des violences, celui de la résilience, « aubaine » pour la société.
C’est vraiment une aubaine, en effet, car on compte sur la capacité des victimes à se remettre d’à peu près tout. Mais on ne sait jamais à quel prix on peut faire preuve de résilience, et survivre ne veut pas dire vivre. Ça signifie simplement qu’on ne se plaint pas, qu’on ne désigne pas les agresseurs. La loi n’a pas à être signifiée et rien n’est remis en cause. Il y a dans le livre un appel à sortir du silence, un appel à désigner, à ajouter un maximum de paroles à d’autres paroles, pour inverser, au moins pour déstabiliser ce système où les agresseurs peuvent continuer à agresser, les violeurs à violer, les parents à violenter leurs enfants, puisque toutes les victimes s’en remettent. Et les bourreaux ne sont jamais inquiétés. La résilience est une immense manipulation.
Qui se nourrit aussi de l’idéologie de la famille que notre société prône…
C’est fou tout ce qu’on est prêt à faire au nom de la famille. On a très fort intégré que c’était la valeur absolue, la valeur refuge et c’est très difficile de se défaire d’une famille, y compris d’une famille maltraitante, c’est très culpabilisant car on nous vend la famille comme un espace unique, où les parents seraient forcément des tuteurs pour des enfants… Toute violence faite à des enfants défait ce cadre de prétendue protection de la famille envers l’individu. Mais les victimes sont empêchées de se défaire de ce système, prises dans une culpabilité incroyable qui donne énormément de force aux agresseurs. Ceux qui, au nom du corps familial, nient les corps de tous les individus qui composent la famille. On s’autorise tout et on interdit toute dissidence.
Vous évoquez la « médecine à papa », vous soulignez la place qu’occupait votre père en tant que médecin dans la famille : « C’est bizarre quand même d’être médecin et avec sa fille de faire autre chose que soigner ». Est-ce que la fonction de médecin ajoute encore à la domination que vous évoquiez ?
C’est bien sûr un ordre supplémentaire. L’ordre familial est intouchable, et la domination implicite des adultes sur les enfants, des hommes sur les femmes, en fait partie. À cela s’ajoute la domination du médecin, celle de l’homme qui, au nom de la médecine, a droit à toute intrusion sur le corps de la femme. C’est aussi l’ordre de la bourgeoisie qui se doit de montrer une façade irréprochable, l’ordre bourgeois des notables de province. Le nom de mon père était très connu et il était un médecin très respecté. On se raconte qu’on fait partie des notables, et qu’on a des droits, et ça contribue aussi à l’exercice de cette domination.
Est-ce en partie ce qui explique le choix de publier le livre sous le nom de Séverine ?
Au départ, c’était pour me protéger et ne pas avoir affaire à eux une énième fois, puis je me suis rendu compte que je devais m’y confronter si je voulais me sortir de cette violence familiale. Séverine, c’est aussi le prénom hors de cette filiation, même s’il est choisi par les parents. Une manière de rendre la parole à cette enfant qui n’a jamais pu exister ou advenir. Et des Séverine, il y en a beaucoup, comme des Cécile, des Camille, etc. C’est une voix parmi d’autres, une voix parmi les voix. Je trouve génial de faire entendre des formes différentes, que ce soit de purs témoignages, comme celui de Camille Kouchner, une réflexion illustrée incroyable sur le système de l’inceste, comme celle de Cécile Cée, de la poésie… Si on attrape ça par toutes les formes, on a peut-être une chance d’être entendu. On sait qu’il y a des dizaines de milliers de témoignages qui ont été recueillis par la CIIVISE [Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants], et on voit bien pourtant comment la parole est facilement écrasée. Il faut ces dizaines de milliers de témoignages pour que les gens ouvrent les yeux mais cela ne suffit pas. On doit aussi faire entendre ces voix par une forme de subversion, par l’art, qui a son propre pouvoir de subversion, et qui peut activer la pensée autrement. C’est aussi la raison pour laquelle il est très important pour moi que Décharge soit incarné par des voix, qu’il soit lu par d’autres voix que la mienne, incarné par d’autres que moi.
Vous écrivez que votre poème est « un lieu où converser ». Cette idée de conversation désigne aussi une manière d’échanger, de se rapprocher. Avec qui voulez-vous avant tout converser ?
C’est pour moi une sorte d’appel à une communauté qui serait peut-être la communauté des victimes, y compris des victimes qui s’ignorent. Des lecteurs me disent que la lecture de Décharge est aussi une manière de prendre conscience des systèmes d’écrasement, notamment au sein de la famille, qui n’étaient pas perçus jusque-là. Dans l’idéal, ce serait aussi de converser avec des gens qui sont violents et qui se rendraient compte de leur violence en découvrant le texte. Parler de la violence partout où elle se trouve, y compris chez les victimes, et on ne peut éluder cette réalité-là. Pour ne pas reproduire la violence, il faut déjà être sacrément au point sur sa propre violence, et peut-être que la conversation que je souhaite revient à parler de l’endroit où se nichent la violence et la manière d’en sortir. Mais ça a un coût énorme de sortir de la violence. Au sein d’une famille violente, tout le monde a ses petits arrangements avec la loi. Il se joue dans la famille ce qui se joue en dehors : on sait que la loi existe mais, la plupart du temps, elle n’est pas appliquée. Je ne sais pas quel levier il faudrait pour qu’effectivement la loi puisse être opérante à l’extérieur. Le fait de mettre au jour ces systèmes pourrait faire bouger des lignes.
Propos recueillis à Paris par Gabrielle Napoli le 22 décembre 2025
Cet article a été publié sur le site de notre partenaire Mediapart.