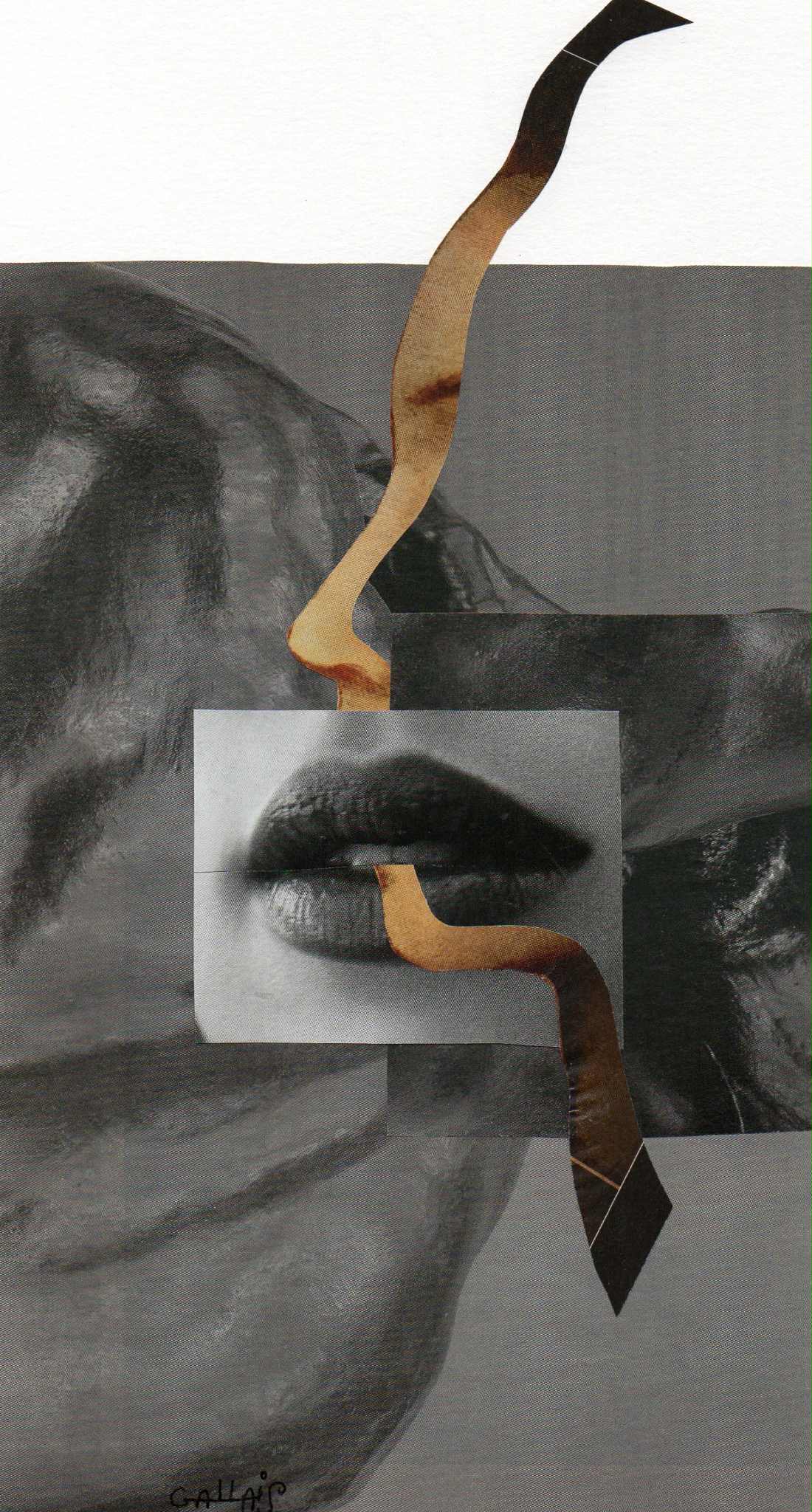Engagée volontaire pour défendre son pays contre l’envahisseur russe, Yaryna Chornohuz se bat pour libérer l’Ukraine. Caporal-chef des Forces armées, pilote de drone, médecin de guerre, elle a reçu, en 2024, le prix Taras Chevtchenko, la plus haute récompense littéraire ukrainienne, pour son recueil de poésie C’est ainsi que nous demeurons libres.
La voix de Yaryna Chornohuz a sauté aux oreilles de Frédéric Martin, alors éditeur au Tripode, lors de la manifestation « Face à la guerre. Dialogues européens » en novembre 2024, organisée par l’établissement des Champs libres et l’Institut français. Lorsque, le dernier jour de la manifestation, Yaryna Chornohuz a pris la parole pour lire, en français, le poème qui ouvre le recueil, « Si nous restons en vie », poème destiné à son compagnon, Frédéric Martin a su qu’il voulait éditer ses textes.
Ses mots nous parviennent depuis les tranchées où elle écrit durant de brefs instants de repos. Sa poésie est essentielle : dès les premiers vers, nous pressentons une écriture tissée d’urgence et de détresse.
« Je pleure dans mes poèmes en ce court moment
où je ne fais pas la guerre
où je ne tiens pas nos positions »
Dans ce recueil, Yaryna Chornohuz dit le souvenir de son premier amour tué par un sniper russe, comme elle l’écrit si douloureusement dans « Danse macabre à l’ukrainienne », où, juste après le tir de la balle, « la vie et la mort restent cousues ensemble », l’instant de mort s’étirant en un acte d’union paradoxale. Par le passage du je au elle, la distanciation laboure sa tristesse sans l’épuiser : elle permet à la fois de créer une scission entre celle qui a vécu le traumatisme et celle qui le raconte, soit dire l’indicible, et de survivre à ce qui est dit.
« elle le verra mourir
il la verra en mourant
transi par la peur de la peur même
ainsi verront-ils simultanément la mort de l’autre en en imaginant la mort de l’autre »
Yaryna Chornohuz personnifie la nuit, l’attente et la mort, ce triangle infernal qui torture les soldats. La nuit d’abord, qui « lève son loquet » au-dessus de sa tête avant de s’abattre et de l’enfoncer « jusqu’aux genoux dans la terre ». Combattre sur le front, c’est se frictionner à la terre, tirer, esquiver mais aussi attendre l’aube. L’autrice compare l’attente à un renard écrasé, « personne ne prend la peine de s’arrêter pour le repousser au bord de la route ». La mort, enfin, qui apparaît en même temps qu’elle disparaît, qui sait « se déguiser, prendre forme humaine » tout en étant « trop paresseuse pour se camoufler par beau temps ». La mort est omniprésente dans les tranchées mais aussi au-delà, jusque dans les pots de confiture préparés par des personnes entretemps parties, où « le cœur de cornouille bat contre les parois du bocal ». Et ce faisant, la mort est si familière que, dans un paradoxe sordide, elle devient « famille ». Ses frères, ses sœurs d’armes et son amour, tous tués par l’armée russe, Yaryna Chornohuz les pleure tout au long du recueil.

« Serhiy a perdu Yana
Yulia a perdu Illya
Inna a perdu Ihor
Halyna a perdu Mykola »
Le deuil l’accapare car « comment vivre avec l’empreinte des morts sur nos corps » ? Elle décrit son propre corps sur le champ de bataille, son matériel de combattante enserrant ses émotions, et « cet amour perdu entre la forêt et la rivière entre le MultiCam maculé de terre / le gilet tactique qui enserre la poitrine et les munitions neuves ». La guerre est d’une sordide trivialité, que la poétesse compare au « grincement de balançoire dans les cours-caponnières », image symptomatique d’une guerre qui pervertit jusqu’aux sons, mêlant l’innocence de l’enfance, la balançoire, à l’univers militaire des caponnières, fortifications défensives.
Yaryna Chornohuz décrit les gestes de l’amour et du deuil dans le plus marquant des poèmes, « Station-service », un tableau nocturne qui contient tous les autres textes. À la fin de chaque mois, la poétesse s’arrête dans une station-service pour se changer, elle substitue les vêtements de son compagnon perdu aux siens. Et nous la voyons mettre « un t-shirt rouge / un pull rouge avec un avion aigue-marine / qu’il portait quand il se reposait après sa garde / une longue veste militaire isotherme trouée à la manche droite ». Nous sommes avec elle quand elle les déplie lentement, dans le silence de la nuit.
« ces vêtements souffrent de solitude même quand je les porte
chaque fois c’est comme s’ils s’épuisaient sur mon corps »
Cet hommage dit tout du deuil universel mais aussi de la singularité de perdre l’amour de sa vie dans la défense de son pays « contre l’ennemi six fois plus nombreux / qui veut nous exterminer à tout prix » depuis des siècles. De russie, l’autrice fait tomber le r majuscule, la résistance à l’oppression passant par les mots. La question linguistique étant centrale dans l’affirmation identitaire, surtout en Ukraine où la russification forcée reste un des traumatismes historiques.
Les poèmes de l’écrivaine ne sont pas des mots abstraits posés à côté des choses, ils s’inscrivent dans la peau du réel et souffrent avec elle. Ils pleurent son peuple, ses villes détruites et ses rivières mitraillées, comme la Siversky Donets, dans le Donbass, devenue une ligne de front. La poétesse la compare au Styx antique – ce fleuve des Enfers qui évoque la séparation entre le monde des vivants et le monde des morts. Elle s’adresse directement à elle et l’apostrophe : « pourquoi, rivière, n’as-tu pas de voix / pour tout simplement crier ? ». Yaryna Chornohuz forge un nouveau topos élégiaque du paysage témoin : loin de la nature consolatrice romantique, les éléments naturels deviennent les complices muets de l’horreur. Les artères de la rivière trouées par des obus, les chênaies marquées par le chagrin, devraient crier à l’injustice mais restent silencieuses.
À chaque nouvelle saison, le désastre se poursuit. Elle qui pensait que « la douleur s’usait / comme les chaussures » découvre qu’elle « habite le ciel / et t’observe toujours à travers une lunette de tir ». La victoire et la vieillesse deviennent alors des horizons lointains, des leitmotivs d’un avenir que l’autrice ne pense jamais vivre, elle qui se dit déjà à moitié morte puisque « les corps ne laissent pas partir d’autres corps / les vivants meurent avec les morts ». Dans son immédiateté rugueuse, l’écriture de l’artiste-combattante permet de nous approcher au plus près du peuple ukrainien.
« je porte mon sac à dos ma mitraillette ma fatigue passée sous silence
je porte ton cœur
et toi, tu avances »