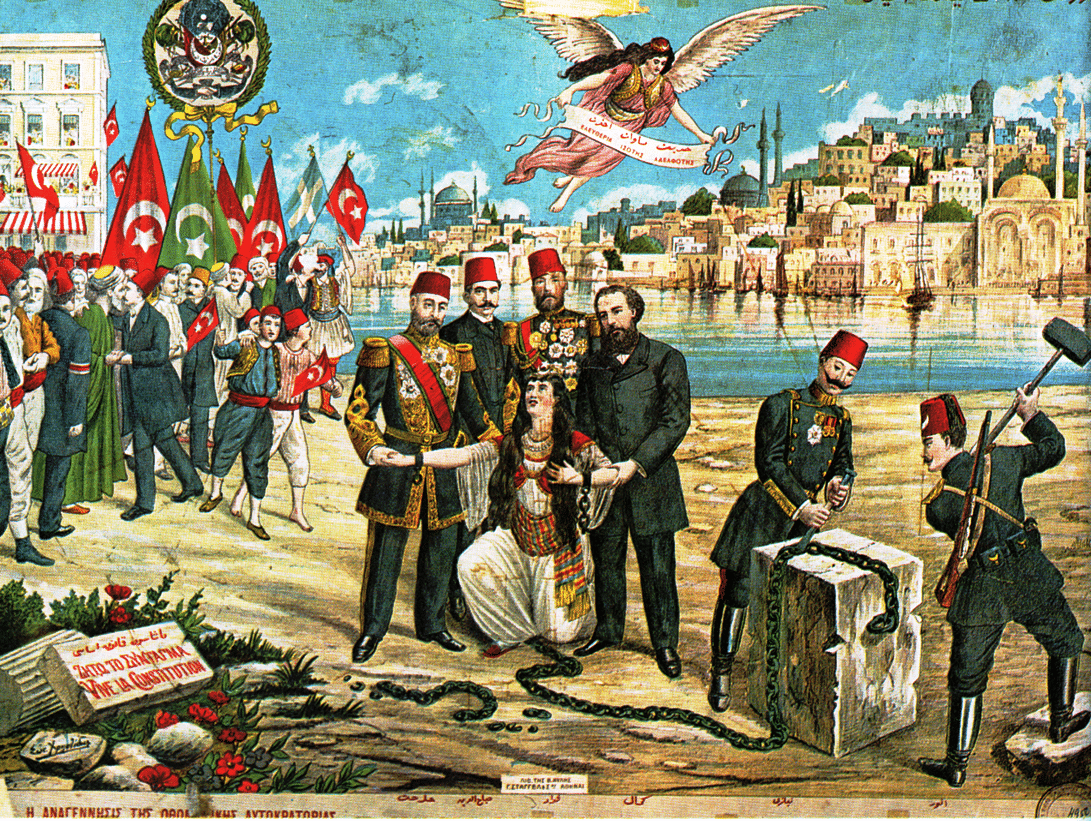Dans le droit fil de ses travaux sur la propriété foncière, plus largement sur le monde rural algérien sous la colonisation, l’historien Didier Guignard livre avec Une ferme en Algérie un ouvrage important qui va au fond de la résilience de la paysannerie algérienne, des formes de ses continuités et adaptations dans ses rapports à la terre, au territoire, à la lumière des politiques publiques développées autant par la colonisation que par l’État indépendant. Ces continuités relevant de ce qu’il caractérise ici comme un « enracinement paradoxal ».
La recherche prend ainsi quelque distance par rapport à la thèse du « déracinement », thèse qui doit, selon l’auteur, sa diffusion et son « caractère dissuasif sur la recherche et le sens commun » au contexte de la « décolonisation ». Pour éclairer ce rapport paradoxal, l’auteur va, dans une démarche méthodologique jusque-là peu empruntée dans les approches sur l’histoire coloniale de l’Algérie – celle de la micro-histoire –, renouveler la perspective à partir du terrain en question, notamment celui des acteurs et protagonistes, Algériens et Européens dont les liens avec le territoire, le lieu, la ferme, ont été, à travers les générations familiales, prégnants. C’est par « l’attachement » à la terre que ces liens se laissent appréhender. Guignard privilégie, dans cette histoire sociale, moins l’ancrage par la propriété que celui à la terre « quand bien même le lien physique [serait] rompu ». Aussi, ceux qu’ils prend en compte sont « moins les propriétaires et les gérants, que les ouvriers, les domestiques et leurs descendants », ceux qui s’inscrivent dans un ancrage durable et évolutif.
L’approche conjugue à bon escient l’enquête de terrain, l’observation in situ, les entretiens, les témoignages, les correspondances, les échanges épistolaires, la cartographie, l’iconographie, avec le recours à différents documents et archives, aussi bien en France qu’en Algérie. Procédant d’une approche de micro-histoire tout à fait novatrice dans ce qu’elle apporte à la fois comme détails ethnographiques de la vie quotidienne d’une ferme et de connaissances nouvelles plus larges, qui éclairent la grande histoire de la dépossession coloniale et de ses effets dans le long terme, elle montre la voie à ce que pourrait être une perspective d’approche par le bas, fondée non pas sur une démarche d’historiographie classique appuyée sur les seules archives, mais plus largement sur un travail mobilisant des acteurs des deux rives, populations et protagonistes de la confrontation ; une voie à ce que pourraient être des recherches basées autant sur des sources locales orales, sur des enquêtes de terrain, sur la restitution de traces locales in situ, sur la prosopographie, que sur les archives et documents coloniaux.
À partir d’un repérage sur une photo de famille, Didier Guignard reconstruit les arbres généalogiques des familles qui vivent dans cet espace en portant « la focale » sur la ferme coloniale, son environnement, ses acteurs, son histoire sociale des années 1870 à 1990. Les chapitres qui structurent l’analyse et l’interprétation développées vont alors coller à une périodisation des faits marquants qui ont scandé cette évolution. À partir des dates des faits qui déterminent des basculements, sont ainsi pris en compte les effets locaux des contextes globaux et de ce qu’ils induisent comme transformations ou permanence. Si l’année 1877 est arrêtée comme « l’année zéro » de cette histoire , où la ferme devient la ferme Bruat du nom de l’administrateur Edmond Bruat, un des principaux artisans du séquestre dans la région, les années qui la précèdent sont marquées par la mise en œuvre des modes d’orchestration de la dépossession (confiscations, expropriations, séquestres, punitions) qui trouve son acmé avec l’insurrection de 1870, conséquence de « l’avancée indubitable des fronts de la colonisation ».

Le début du siècle élargit la focale de « l’espace-ferme » à l’environnement, au nouveau quartier tenu « par les notables musulmans », au marché hebdomadaire, proches de la ferme, et aux interactions qui reconfigurent cet espace élargi. La période voit également « l’amorce d’une nouvelle donne » avec l’émergence d’activités agricoles nouvelles : vigne et tabac. La survie des « indigènes » repose alors sur les solidarités familiales. Dans les années 1920, des mutations profondes caractérisent la ferme-espace convertie à la vigne et passée aux mains d’une famille catalane, qui en fait une vitrine à l’échelle de la région et de la colonie. Les relations colons/ouvriers saisonniers ou permanents se rationalisent. Émerge un monde de travailleurs agricoles qui se hiérarchise, où certaines places, comme celles d’emplois sur l’année ou de contremaître, sont mises en concurrence et convoitées. L’auteur relève dans le même temps un retour en force de familles dépossédées dans les années 1870-1880. L’émigration vers la métropole est alors le fait des populations des montagnes, la plaine est faiblement concernée. L’entrée en crise de la ferme au début des années 1930, consécutive à un début de tension dans la production viticole et surtout à l’homicide d’un journalier algérien par un technicien européen, modifie les relations entre les nouveaux gérants et le personnel. Cela ne remet pas en cause la résilience des familles restées sur place.
Cette présence se fait dans une coexistence contrainte où « l’attachement à la terre n’est pas non plus le gage d’adhésion à la colonisation ». L’immédiat après-Seconde Guerre mondiale approfondit les fractures sourdes entre « une main-d’œuvre devenue pléthorique et une gestion comptable » où « les besoins élémentaires du personnel ne sont pas pris en compte ». Les mouvements insurrectionnels se développent dans le Constantinois en 1945, où les effets de la famine (voir Neil MacMaster, « La politique de la famine : Adrien Tixier et l’Insurrection de Sétif en 1945 » in Revue Naqd, n° 7 Hors-Série, 2023/3) comme l’élargissement de la prise de conscience nationaliste ne sont pas sans effets sur la situation locale. En dépit de ces manifestations, l’autisme des dirigeants est frappant. Les conflits et incidents se multiplient dans la ferme ; de fait, les autorités coloniales sont en train de perdre le contrôle de la paysannerie qui sera la force motrice du mouvement indépendantiste. La jonction, « la communion de pensée » entre les intelligentsias nationalistes et les masses rurales, va s’affirmer progressivement dans le moment ; en témoigne, selon un militant, le fait que « juste au-dessus de la ferme Chartier [….] trois abris (pour les nationalistes) sont aménagés à cette époque ». Et c’est logiquement, peut-on dire, que la ferme devient dans les années 1950 une « cible pour l’ALN », symbole du nœud gordien des rapports dominants/dominés, lieu qui exprime l’acmé de cette évolution vers l’explosion. « Les cadres et ouvriers du domaine sont à la première loge, à l’intersection de la plaine et de la montagne », note l’auteur qui observe que « l’exploitation va devenir un camp militaire après l’assassinat de la gérante ».
À l’intersection de la plaine et des montagnes environnantes, la ferme voit sa main-d’œuvre de saisonniers se réduire ; la suspicion s’installe et les ouvriers permanents, afin d’être mieux surveillés, sont logés à l’intérieur du camp. Cependant, avec l’avancée de la guerre, la répression s’intensifie, certaines familles d’ouvriers permanents sont expulsées de la ferme et certains de leurs membres sont arrêtés et torturés. Les opérations de regroupement développées dans l’urgence et l’improvisation tendent également à couper les paysans de leur environnement agricole.
Ainsi le mouvement indépendantiste va-t-il recruter de nouveaux résistants « avec une capacité à drainer une partie des richesses de la plaine ou des terres du Piémont ». Au tout début des années 1960, le domaine « n’a plus rien d’une ferme modèle ». Les militaires occupent toujours les lieux et les relations avec les populations des environs sont coupées.
L’intermède 1961-1962 a pu laisser croire, comme partout dans le pays, que les Européens, en dépit de toutes les violences de l’été 1962, avaient toute leur place après l’indépendance. L’auteur cite à cet égard un document du commandement de la gendarmerie des Issers commentant un document que la direction de la Wilaya III aurait diffusé pour tenter de rassurer les propriétaires colons de la région. Aussi bien l’auteur observe-t-il qu’en dépit du départ massif de ces derniers, certains propriétaires ont hésité, différant leur départ, d’autres ont jugé leur départ provisoire, laissant les clés à leurs ouvriers, alors que certains autres sont revenus temporairement.

La ferme nationalisée en novembre 1963, son propriétaire, Francis Chartier, quitte définitivement le pays. On sait alors gré à l’auteur de ne pas clore cette histoire avec la fin de la colonisation. En effet, dans l’incertitude du statut de la propriété foncière entre octobre 1962 et novembre 1963, domaine autogéré ou bien vacant, les anciens employés et ouvriers occupent déjà les lieux. L’auteur remarque que les lignages étudiés conservent, dans un moment de recomposition et de redistribution des places sur les domaines autogérés, « une influence et une emprise territoriale » importantes.
Si les politiques publiques, plutôt axées sur l’industrialisation et une modernisation par le haut du monde rural, distendent ces liens avec la terre, elles ne remettent pas en cause fondamentalement les objectifs de ces familles qui continuent à investir comme si leurs enfants allaient prendre la suite. Les années 1990 distendent encore les liens avec le lieu, mais « l’attachement » est toujours là, il est même « sublimé », observe l’auteur. Le passage, au cours des années 1980, à des EAC (exploitations collectives) et des EAI (exploitations individuelles), comme la remise en cause de la réforme agraire à travers la privatisation des terres domaniales et la restitution de celles des propriétaires nationalisés, aiguisent les contradictions entre occupants anciens et nouveaux et modifient les rapports à la terre.
Guignard enregistre bien en quoi cette situation profite au parti islamiste ascendant, le FIS (Front islamique du salut). Sans qu’elle en infère une conséquence directe, sa recherche permet cependant d’éclairer en quoi la crise qui affecte à la fin des années 1980 le secteur agricole va conduire certains membres des EAC – dont les effectifs pléthoriques posent problème – à des solutions de pis-aller : location voire vente des terrains, transformation de leur destination et surtout exclusion de familles des lieux, nourrissant la base sociale du mouvement islamiste, par jonction des jeunes ruraux sans travail, devenus « trabendistes » (jeunes transporteurs depuis l’étranger de valises de produits vendus dans l’informel), au service d’activistes de l’informel, comme certains commerçants et artisans, voire des petits entrepreneurs et des petits fonctionnaires locaux. Ainsi, un certain nombre de chefs des GIA sont issus de ces catégories de populations « rurbaines » et « indus-occupants » vivant dans et à proximité des domaines en restructuration (à l’exemple d’Antar Zouabri, originaire de Haouch Gros, la ferme coloniale Gros de Boufarik, et de Hassan Hattab issu du domaine Benzergua à l’est d’Alger). Il y a en effet? à cet égard, à approfondir l’analyse des déterminants de ce que l’auteur caractérise comme la « greffe islamique », au-delà des rapports entre islam réformiste et islam confrérique, en interrogeant également d’autres « institutions de socialisation »? notamment le système d’enseignement dans ses différents ordres .
Il s’agit là d’un important ouvrage, dense et rigoureux, académique (qui peut paraitre difficile d’accès pour le grand public, en ce qu’il entrecroise les périodisations, les témoignages et les trajectoires, les vécus, les documents et les archives, mais dont néanmoins les synthèses d’étapes de chaque chapitre sont les bienvenues dans la saisie de la logique de l’interprétation), qui apporte de nouveaux éclairages et surtout ouvre de nombreuses et nouvelles pistes de compréhension de l’évolution de la société algérienne, à partir d’une analyse du monde rural à plusieurs niveaux, sur plusieurs échelles ; analyse qui conjugue approche locale et contextes plus larges, histoires familiales et trajectoires individuelles, histoire et mémoires, qui donne à comprendre à partir du « vécu » et des pratiques sociales cette évolution ; analyse qui, continuée dans le temps, aurait sans doute éclairé davantage la place du monde rural, des populations de l’intérieur, censées avoir été absentes dans le Hirak, le mouvement social de contestation du système politique en place, lors même qu’elles sont souvent à la base des mouvements de dissidence.