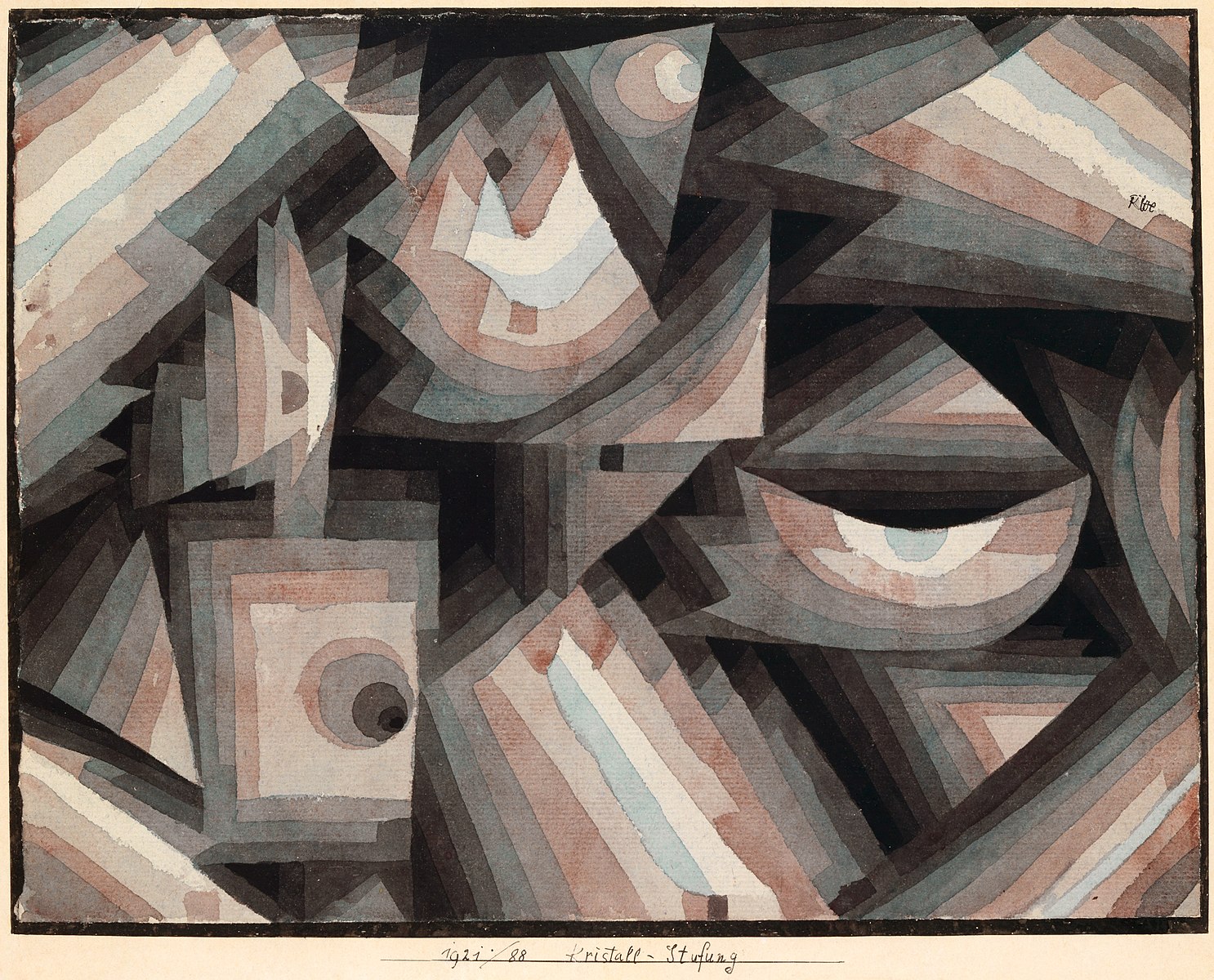Dans Le cours de l’eau, Grégoire Sourice lance ses amarres sur des articles du Code civil concernant l’eau et la propriété ; il les teste, réfléchit à leurs implications, prend soudain le cap vers son histoire personnelle, dérive vers ceci ou cela, puis clôt son périple par un « Index des choses » qui sert de renvoi libérateur et amusé à tout le livre.
Son montage poétique et fantaisiste, présenté sous les sobres et jolies couvertures des éditions Corti, obéit à une intention : penser quelques aspects de « l’humaine condition » en s’animant de ce plaisant mouvement individuel que peut prendre l’essai lorsqu’il va vers une reconnaissance des complexités et apories de la réflexion plus que vers l’aboutissement de celle-ci.
Le point de départ, le Code civil, est, quant à lui, clairement posé. Son choix comme objet et outil de réflexion est d’entrée de jeu justifié : « Le Code civil est un livre matriciel [qui] détaille la personne française : […] sa lecture révèle la personne à elle-même. On découvre alors comment naître, comment s’affilier, hériter, comment épouser, disparaître et surtout posséder ».
Il se révèle, en effet, un merveilleux instrument d’investigation dans le domaine qui intéresse ici plus précisément l’auteur : « posséder ». Il offre surtout une catégorie paradoxale ou difficilement cernable de possession, « l’eau », laquelle permet de faire apparaître les logiques et les absurdités de la « propriété » concernant un monde dont Sourice montre qu’il est rétif à la nomenclature et plus agréable lorsque personne ne se l’approprie. Le Code, lui, s’efforce de définir les « choses » et d’indiquer les manières légales de les posséder ; il ne peut que buter sur ces « choses » complexes que sont les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les sources, la pluie, les animaux aquatiques… car l’eau par sa fluidité déjoue ses catégories.

Voilà bien sûr qui séduit l’auteur, et il s’amuse à observer les acrobaties auxquelles doit se livrer la loi pour les définir et déterminer leurs justes propriétaires. À qui appartient une île soudain apparue dans le fleuve ? Y a-t-il une compensation possible pour un bout de champ définitivement submergé par la rivière ? Un vélo jeté dans la Seine, territoire domanial, est-il res nullius, chose de personne, ou res communis, chose commune ? Etc. Pour leur part, les formules du Code ( attendu que, vu que…), son vocabulaire (les havres, les atterrissements, le fonds…), ses pronoms (un curieuse utilisation du « nous » et du « on »), ne font que rendre encore plus absurde le féroce désir qu’il exprime de tout transformer en biens appropriables. Tout ? Heureusement non : « Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous », dit son article 714. Comme l’air qu’on respire, la pluie, les nuages… Même si les lois d’autres pays ont bien tenté de privatiser les nuages : en effet, des tribunaux américains (devant les procès intentés à ceux qui les « crevaient » pour le bénéfice de leurs cultures) ont statué qu’ils appartenaient à ceux qui se trouvaient dessous, avant de devoir abandonner cette conception, finalement jugée inapplicable à des entités trop mouvantes pour faire l’objet d’un droit spécifique.
Mais Le cours de l’eau, on l’a dit, ne se contente pas de « coller » au Code civil, il inclut dans sa méditation d’autres matériaux comme, par exemple, dans une section centrale, un épisode de la vie de l’amie de l’auteur. Contrainte de vider la maison familiale à la mort de sa mère, elle doit déterminer ce dont il lui faut se défaire et ce qu’elle veut garder. La question de la propriété matérielle cède le pas à celle de la propriété affective, à une interrogation sur le rapport sentimental aux objets, sur la transmission et sur la mémoire. Et de ces liens, que peut dire le droit ? Rien.
Dans les dernières pages, des tristesses sociales ou politiques présentes dès le début du livre, mais mises à distance par l’ironie, se précisent. Comment exister dans ce monde régi par le Code où règne l’hégémonie de la propriété et où rien ne doit échapper au marché ? Faute d’avoir une réponse, laquelle ne saurait d’ailleurs être individuelle, l’auteur passe à l’action, sur le mode du happening : il va déposer au fond du jardin un exemplaire du Code « dont le volume et la couleur font penser à une brique » (celle que la dialectique peut ou ne peut pas casser ?) que la pluie ne manquera pas de retourner à l’état de pâte et de désagréger. Il contribue ainsi à la victoire finale de l’eau sans maître sur le Code, texte des maîtres, de leurs nomenclatures et dispositions.
Vivat aqua !