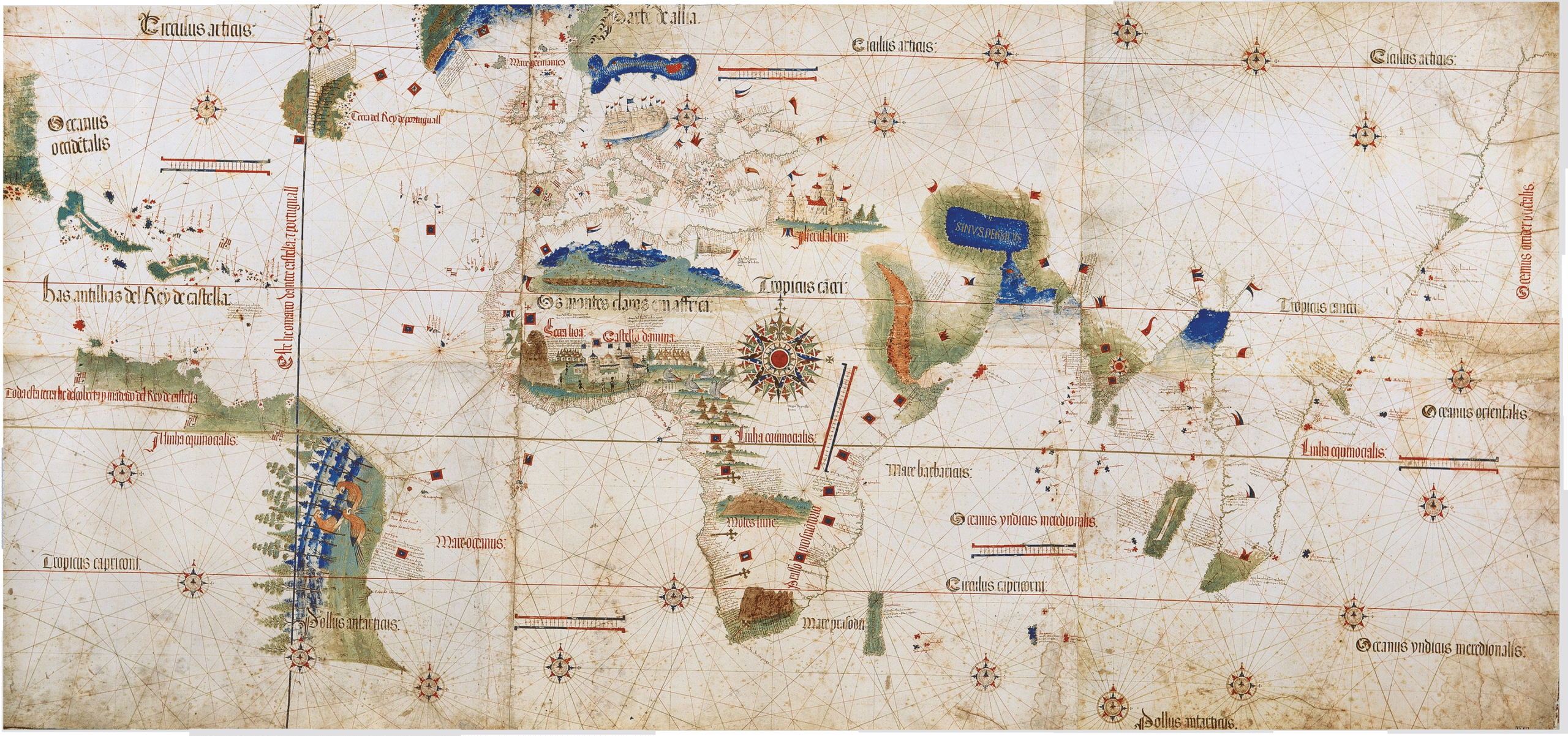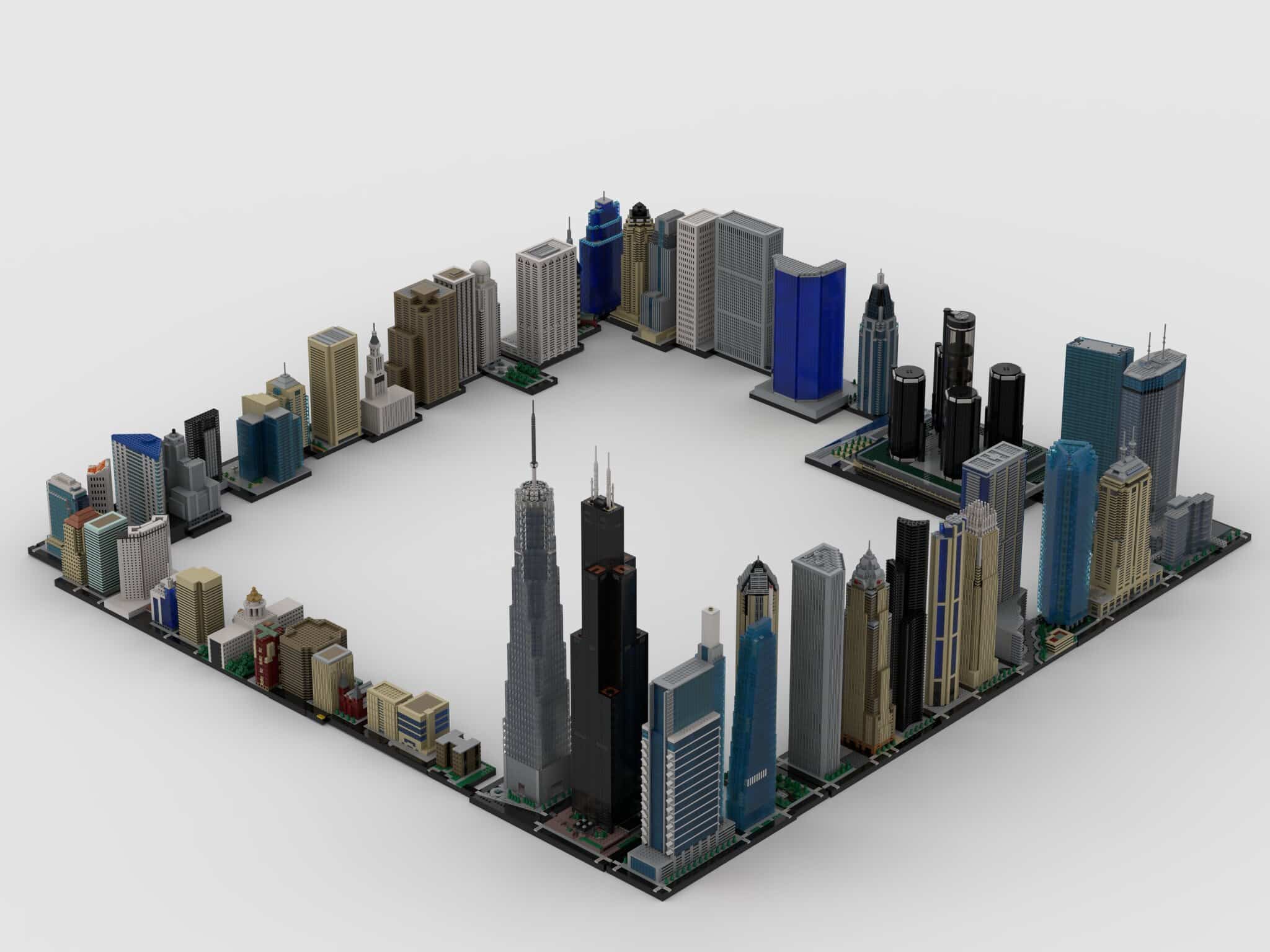Dans La souveraineté de la terre, l’anthropologue Danouta Liberski-Bagnoud explore les systèmes de pensée de la région voltaïque (ou issus du haut bassin du fleuve Volta) et expose une alternative au paradigme propriétaire qui sert de matrice à la civilisation dominante actuelle et qui a causé la crise écologique. Ce faisant, elle indique le chemin que devrait emprunter un projet africain de décolonisation mentale.
Dans la société contemporaine et dans le système capitaliste qui est le nôtre, l’immobilier et le foncier ne sont plus tenus en dehors du marché. On peut les acheter et les vendre sans obligation d’en faire un bien public. Par exemple, si une forêt de plusieurs millions d’hectares est privatisée, rien n’empêche son propriétaire de la vendre, de la clôturer, voire de la raser. Beaucoup considèrent que le fait que ces biens deviennent des propriétés privées relève de l’évidence même.
C’est contre cette évidence que nous met en garde le livre de Danouta Liberski-Bagnoud. Elle reflète, selon elle, un certain nombre de choix de civilisation, de manières d’organiser la société et de rapports sociaux particuliers et locaux. Les systèmes juridiques d’origine européenne qui sous-tendent cette évidence n’ont rien de naturel ni d’universel.

Une des évidences que déconstruit l’anthropologue est la fin de l’agriculture comme activité majoritaire d’Homo sapiens. Le philosophe Michel Serres y voyait un signe patent d’une évolution positive de l’humanité dont la plus grande partie passerait d’une activité physique somme toute fatigante et peu rentable à d’autres activités intellectuellement plus stimulantes. Grace à la science, nous devenons, selon l’expression de Descartes, « comme maîtres et possesseurs de la nature », et nous pouvons, avec peu de main-d’œuvre, produire de manière intensive et nourrir toute l’humanité.
Danouta Liberski-Bagnoud montre d’abord que cette évolution est loin de concerner l’humanité tout entière (« l’agriculture est encore le premier pourvoyeur d’emplois de la planète, occupant la moitié de la population dans plus de 50 pays, et jusqu’à 75 % dans les pays les plus pauvres »). Se départir de ce constat factuel pour prédire la fin du paysan n’est que généralisation abusive d’un modèle local. Plus intéressant, ce que refusent de voir les chantres de l’agriculture intensive, c’est que cette dernière est solidaire d’une conception capitaliste de la propriété et de l’exploitation de la terre directement responsable du désastre écologique ; de plus, le modèle paysan de l’agriculture est solidaire de conceptions du rapport à la terre et à l’environnement qui sont une alternative possible au modèle délétère que nous vivons et dont il serait illusoire de croire qu’il est le seul possible.
Danouta Liberski-Bagnoud part des systèmes de pensée des groupes voltaïques, dont elle est une spécialiste, pour exposer un de ces paradigmes alternatifs qui organisent autrement le rapport à l’appropriation des biens communs et singulièrement de ce qui, dans ces systèmes de pensée, est le premier d’entre eux, la terre. Dans la pensée économique moderne, la terre n’est considérée ni comme un bien public ni comme un bien commun. Un bien public est un bien qui n’est ni rival ni excluable. C’est le cas, par exemple, de l’air que nous respirons : le fait qu’un individu respire n’influe pas sur la capacité d’un autre individu à le faire. Ce n’est pas non plus un bien excluable : il est impossible de réserver l’air ambiant à une catégorie spécifique de personnes. Les biens communs, quant à eux, sont des biens considérés comme rivaux mais non excluables. Il y a rivalité dans la mesure où la consommation d’un bien commun par un agent empêche sa consommation par un autre. Il demeure non excluable dans la mesure où l’on ne peut en restreindre l’usage. Un bon exemple de bien commun est un arbre fruitier poussant au bord de la route : on ne peut interdire au passant de cueillir ses fruits, mais la cueillette par les uns empêchera les autres d’en bénéficier.
Le travail de Danouta Liberski-Bagnoud montre qu’un projet révolutionnaire ne saurait obtenir l’adhésion des populations et sortir du paradigme néolibéral sans une connaissance profonde de la spécificité du mode d’habiter le monde qui organise la psyché locale.
Le capitalisme s’est longtemps insurgé contre l’existence de biens communs parce que ce statut semblait inéluctablement mener à une destruction des ressources à travers ce que Garrett Hardin a nommé la tragédie des communs – chacun a intérêt à s’approprier une part maximale des ressources communes mais n’a aucune incitation à renouveler un stock dont il ne peut exclure les autres. De ce fait, les biens communs finissent par être dilapidés. La proposition de Hardin a alors été soit la régulation de l’accès aux communs soit leur privatisation. Ainsi, la terre elle-même cesse d’être un bien public et n’est un bien commun que dans de très rares cas. Les sociétés capitalistes organisent la transformation de la terre en bien privé approprié par des acteurs économiques qui en prennent soin. En France, par exemple, 74 % des forêts sont aux mains du privé.
Danouta Liberski-Bagnoud nous montre que, dans les sociétés voltaïques, il y a un renversement de perspective sur cette question. La terre n’est pas vue comme une simple pourvoyeuse de ressources dont il faut définir le mode d’exploitation le plus efficace. La privatiser afin de la préserver n’est pas une solution. C’est même littéralement sacrilège dans des sociétés dont l’interdit le plus fondamental est de vendre la terre. L’anthropologue a l’honnêteté et la prudence de préciser qu’elle n’est spécialiste que des sociétés voltaïques, non de toute l’Afrique. Elle n’en insiste pas moins sur le fait que cette réticence, voire ce tabou, de la vente de la terre est présente dans beaucoup de sociétés traditionnelles africaines et nous apprend quelque chose de profond sur le rapport à l’environnement qui y a cours. Comprendre ce rapport à la terre dans toute son altérité permet, en miroir, de voir d’un œil neuf la solution propriétaire qui a été adoptée par les sociétés occidentales.
Pourquoi ne peut-on vendre la terre dans les civilisations voltaïques ? Est-ce à dire que la terre est un bien commun ou une divinité ? Poser l’hypothèse de la terre comme bien, même commun, revient à réintroduire subrepticement la solution propriétaire. De même, la penser en termes de divinité revient à projeter une métaphysique étrangère sur les croyances, pratiques et pensées voltaïques. Danouta Liberski-Bagnoud insiste pour dire que dans les sociétés voltaïques la terre est non pas une divinité mais une « instance » : « une construction aussi abstraite que l’est pour nous l’État et qui, comme lui, organise toute la vie de la communauté villageoise ». Cette instance existe d’abord dans l’ordre du discours à travers les rites, prières et mythes. Elle existe ensuite en tant que créatrice d’autorité, en ce qu’elle garantit un pouvoir bien circonscrit aux gardiens de la terre dont l’autorité émane et se légitime d’elle et s’impose, en droit, à tous, y compris aux autorités politiques. L’instance existe enfin à travers sa capacité à censurer et à punir les violations de ses règles.
La terre existe et est donc une instance souveraine. Le problème qui se pose aux humains n’est pas celui de l’appropriation de la terre, mais de leur propre existence dans ce cadre qui les précède et de leur coexistence avec cette instance. En d’autres termes, la question fondamentale dans cette perspective est, non celle de la propriété de la terre et de ses ressources ou celle de la création de richesses, mais celle de l’habitabilité de la terre. Comment l’humain doit-il faire pour avoir une place sur la terre ? Comment habiter la terre sans se nuire ou se faire punir par l’instance terre ?

La figure fondamentale pour la résolution d’une telle équation est celle du « gardien de la terre » : c’est lui qui connait les rites, règles et principes qui permettent de rendre habitable ou propre à l’usage agricole un bout de terre. Lui seul est habilité à accomplir ces rites d’humanisation d’un espace. Le principe fondamental, dans un tel cadre, est que, la terre étant une instance souveraine et absolue, elle ne saurait faire l’objet d’une appropriation. Un autre principe important est que tout humain a droit, non pas à la propriété, mais à une place où il peut mener une vie digne et laborieuse. Le rôle du gardien de la terre est donc de veiller à ce que quiconque en a besoin puisse disposer d’un espace domestique où établir sa lignée et d’un espace de travail où mener ses activités professionnelles. Le gardien procède aux rituels qui consacrent un espace humain où la vie humaine florissante et la coexistence pacifique avec les êtres surnaturels sont possibles. Il s’agit « de trouver le juste équilibre dans l’espace de la communauté en gésine. Et cet équilibre passe par l’établissement de lieux à partir desquels les hommes, s’associant au travail commun de gestation du monde, engendrent un territoire-corps commun à l’intérieur des limites duquel chacun peut trouver stabilité et sécurité ».
Une telle vision du monde interdit de s’approprier un territoire dont on n’a pas l’usage parce que l’occupation de la terre obéit à des règles strictes qui ne sont pas celles du marché. Violer ces règles revient à attirer sur soi et sur la société tout entière malheurs et catastrophes. Il y a un certain nombre d’actes qui sont classés par les peuples voltaïques comme des interdits de la terre qui, sauf réparation rituelle, rompent le fragile équilibre rendant la terre habitable et attirent le malheur sur la communauté et/ou sur le perpétrateur. Parmi les interdits de la terre, les plus graves, « pour lesquels nulle réparation n’est possible, pensable et dont la sanction est sans appel, hors de portée de la volonté humaine », sont le fait de vendre de la terre et de délimiter la terre sans y être habilité.
Nul donc ne peut vendre de la terre, ni se l’approprier. Pas même le gardien de la terre. Ce dernier est dépositaire d’une autorité mais cette autorité n’est pas un pouvoir personnel absolu ou arbitraire. Le gardien de la terre est le dépositaire d’une autorité légitime et agissante, en ce sens qu’il est le serviteur de l’instance terre souveraine qui détermine l’existence de certaines règles rituelles et pratiques qu’il a la responsabilité de rappeler et de faire respecter pour le bien de la collectivité. Même quand le gardien de la terre coexiste avec un roi ou une chefferie autoritaire et arbitraire, celle-ci ne pourra pas se mettre en travers de ses responsabilités. Le gardien de la terre est le gardien d’un équilibre cosmique, d’une habitabilité de la terre plus fondamentale que les soubresauts politiques et dont tous les membres de la société reconnaissent que c’est la condition sine qua non de la vie humaine.
En explorant les systèmes de pensée voltaïques, Danouta Liberski-Bagnoud nous permet d’abord d’avoir une compréhension fine des choix de ces sociétés, choix qui ont abouti à l’élaboration d’une métaphysique et d’une économie privilégiant l’humanisation de l’environnement et l’habitabilité de la terre plutôt que son appropriation par des acteurs économiques. Ce faisant, son livre nous montre que le paradigme propriétaire repose sur une construction théorique dont les axiomes sont loin d’être les évidences naturelles qu’ils prétendent être. De plus, il indique un chemin : un véritable projet africain de décolonisation des catégories ne saurait se dispenser d’une réflexion endogène ayant pour point de départ une connaissance approfondie des structures sociales locales. Sur ce dernier point, Liberski-Bagnoud signale au passage que l’une des raisons de l’échec de la révolution de Sankara fut la transposition de l’idéologie révolutionnaire occidentale. Ne percevant pas le caractère structurant et fondamentalement anticapitaliste des structures traditionnelles, le jeune capitaine n’y voyait que féodalités obsolètes à éliminer. Le travail de Danouta Liberski-Bagnoud montre qu’un projet révolutionnaire ne saurait obtenir l’adhésion des populations et sortir du paradigme néolibéral sans une connaissance profonde de la spécificité du mode d’habiter le monde qui organise la psyché locale.
Mouhamadou El Hady Ba est enseignant-chercheur en philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar