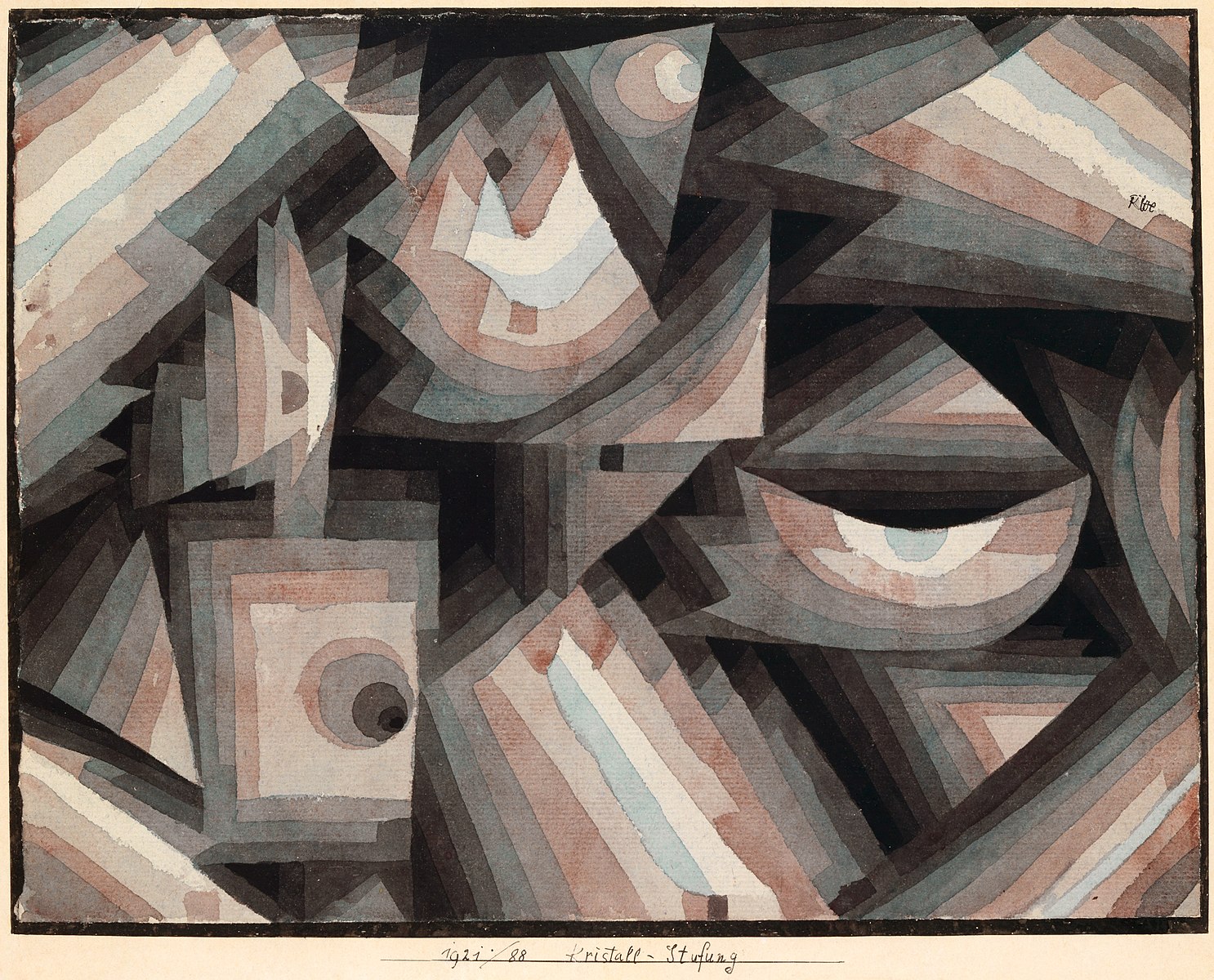« Envie de vivre » : c’est, en français, le titre d’une chanson d’Iggy Pop. Cette expression constitue aussi les derniers mots d’Alain Pacadis. Face B, premier roman de Charles Salles. Le héros en est cette figure très parisienne des années 1970 ayant son entrée permanente au Palace, du temps de Fabrice Emaer, un personnage à tous les sens du mot, et qu’il le devienne d’un roman ne surprendra pas. Un roman sans face A, laquelle serait sa biographie.
On se méfie de cette tendance qui prend des personnes célèbres, stars, peintres ou écrivains, comme héros de roman. Le biopic n’est pas loin, avec ses codes, ses passages obligés, et, disons-le, l’ennui qui va avec. Lagarde et Michard avaient aussi un talent certain pour raconter la vie de Beaumarchais, de Verlaine ou d’Apollinaire. Charles Salles a certes puisé dans les textes écrits par ou sur Pacadis qu’il cite en référence à la fin de son roman, mais d’abord il a construit et écrit.
Le roman est en deux parties dont les titres importent : vivre, survivre. Entre février 1968 et février 1977, Pacadis est dans sa pleine gloire. Si l’on peut dire. Après un « entracte » assuré par le narrateur employant la première personne, le héros décline et sombre. De l’automne 1982 à décembre 1986, il n’est plus qu’une silhouette chancelante, une sorte de vagabond malade, sans abri. Le petit appartement de la rue de Charonne dans lequel il a grandi et vécu a été détruit par un incendie. Des amis l’hébergent, dont le chanteur Hervé Vilard, quand il n’est pas à l’hôpital, après une mauvaise chute, ou en cure de désintoxication.
68-86 : des dates palindromiques. Mais pas seulement : l’espoir, la vitalité d’un temps, les désillusions d’un autre et surtout cette maladie qui atteint les quatre H et qui menace Pacadis : il est homosexuel, il a été héroïnomane ; on croit alors que les hétérosexuels sont préservés et le SIDA n’a pas encore frappé par le sang contaminé. 68, et ses suites, ce sont les manifestations devant la Cinémathèque, pour sauver la direction d’Henri Langlois, ce sont les conflits, querelles, luttes d’influence entre maos, trotskystes et autres militants pas très amusants. C’est la naissance du FHAR, la reconnaissance, ou pas, du combat LGBT, et, pour Alain Pacadis, c’est déjà le temps des provocations et des scandales. 86, outre le SIDA, c’est la fin des nuits au Palace, la peur qui règne dans les clubs gay, mais pas uniquement, c’est aussi la fin des illusions nées en 1981 : le socialisme est passé de mode.
Mais d’abord, Alain Pacadis, qui est-ce ? D’abord un enfant sage catholique bon teint ayant fait sa communion. Il admire Napoléon, tapisse sa chambre de motifs Empire, est un bon élève, étudie à l’École du Louvre. C’est le fils de deux êtres qui n’auraient jamais dû se rencontrer : son père est fils de grecs ayant fui la Turquie d’Atatürk, quand on a « déplacé » les populations de Smyrne et d’ailleurs. Une grande partie de sa famille a été massacrée. Sa mère s’est donné le prénom de Nicole pour oublier celui qu’elle portait pendant la guerre. Elle a échappé de justesse à la rafle du Vél d’Hiv. Elle ne s’est jamais remise de cette époque, même si, blonde comme Ingrid Bergman, elle se rêvait en actrice. Faute de l’être, elle emmenait son fils Alain au cinéma, pour voir Casablanca. Cinéphile, grand lecteur, jeune homme cultivé, il avait pas mal de cartes en main. Il entre dans un maelström, en sortira lessivé.

C’est là le mérite du romancier qui met en lumière l’incroyable désordre d’une époque où tout semble possible avec de l’audace, un art certain pour choquer, et de l’argent (le sien ou celui d’amis). Le prologue du roman montre ce qu’est une soirée au Palace, le royaume de Pacadis. Tout le monde veut y être et Edwige, qui officie à l’entrée, fait le tri. Ce n’est bien sûr jamais une question de célébrité ou d’argent ; c’est avoir le « look » qui convient le jour dit. Le Palace, on le sait, est un lieu d’observation, de drague, et Fabrice, le maitre des lieux, prohibe le sexe trop visible : la séduction suffit. Pacadis, lui, fait ce qu’il veut. Parler d’excès serait adopter un point de vue moral, ou « straight ». C’est le cas cependant et le narrateur n’en cache rien, en des pages qui montrent le dandy souvent revêtu de son cuir et de ses santiags dans son quotidien, ou plutôt son nocturne. Il a de l’allure, sauf quand tout craque et cela arrive très souvent. Pacadis est lié à toute la bande du Palace, il rédige « Nightclubbing », des chroniques qui passent dans Libération, celui des grandes années. Il y travaille comme pigiste, gagne donc peu, se débrouille avec les moyens du bord. Son goût de la provocation ne l’arrête jamais, quitte à prendre des coups. Parfois quand il croise ce qu’on appellerait aujourd’hui des masculinistes, parfois dans d’autres circonstances : la croix gammée qu’il arbore un jour au revers de sa veste lui vaudra une rouste de Pierre Goldman. Qu’importe, il continue.
Sa compagne se prénomme Dinah. C’est un « trav’ », appellation d’époque pour ce que nous appelons transgenre. Leurs rapports sont orageux, Pacadis est jaloux, rarement maitre de ses émotions, et il ne contrôle jamais son désir pour les garçons. Au fil des pages, on croise celles et ceux qui font le premier plan et le fond de l’époque. Certains noms résonnent encore, dont celui de la chanteuse Nico, morte aujourd’hui, et proche de lui comme une sœur, de Lou Reed avec qui Nico a œuvré au sein du Velvet Underground, mais aussi, silhouette déplaisante, Gabriel Matzneff qui montre les photos de ses très jeunes proies lors d’une soirée chez Guy Hocquenghem. Hervé Guibert passe, Barthes et Foucault, bien d’autres. Beaucoup ont disparu.
De là à croire que ce roman est une sorte de documentaire sur deux décennies agitées, il y a un pas que l’on ferait de travers.
Charles Salles pose des jalons, à travers les dates qui donnent leurs titres aux divers chapitres. Si l’on voulait prolonger le jeu proposé par le titre, ces dates seraient les divers morceaux de la face B d’un long vinyle. D’une nuit parmi les hiboux qui rôdent dans Pigalle à ces jours passés aux archives nationales, d’un entretien irréel avec Chantal Goya aux souvenirs d’une enfance fragile, le narrateur présente les différentes facettes du personnage. Si au début on n’a guère envie de côtoyer ce junkie qui ne se lave jamais et vit au crochet des autres – images que laissent les documents visibles sur internet –, on sent bientôt pourquoi l’édifice d’une vie vacille jusqu’à s’effondrer. Vers la fin du roman, Pacadis est invité à la première projection de Shoah. Comme très souvent, il est fasciné par l’homme qui présente son film. Lanzmann n’est plus un jeune homme, Pacadis n’a pas d’exclusive. Ce premier mouvement s’estompe et il découvre le film. En même temps qu’il regarde, il voit sa mère ; elle est omniprésente. Il ne s’est jamais remis de son suicide, censé le libérer du poids qu’elle lui faisait porter. Mais il y a plus. Le mouvement que Charles Salles a imprimé à son roman est le même que celui du film : le lecteur plonge dans l’histoire de Pacadis. Le dandy se défait de ses oripeaux, de son apparence. Les paillettes n’y sont plus ; il est mis à nu. Il l’aura souvent été dans les pages qu’on a lues, mais là, il l’est vraiment. Alain Pacadis. Face B est un roman en forme de spirale. Il nous happe. Il mêle le sordide au tragique, brise des codes, défait des préventions. L’or et la vomissure se confondent, la fête s’achève dans une chambre crasseuse et l’on chante pour soi l’hymne d’Iggy Pop, « Lust for life ».