Chloé Thomas a signé récemment un étonnant Parce que la nuit, rêverie très documentée sur le sommeil et son absence. Comme si résonnaient en elle les échos transatlantiques de Because the night, la voilà qui propose une étude savante d’un poème de Michael Palmer intitulé « Sun ».
Il n’est pas de raison particulière de relire en 2023 « Sun » de Michael Palmer, poème double paru en 1988 dans le recueil du même titre ; nul anniversaire, nulle retraduction n’y invite. Mais tourner autour de ce texte permet de jeter comme un regard de biais sur le soleil et ses métaphores.
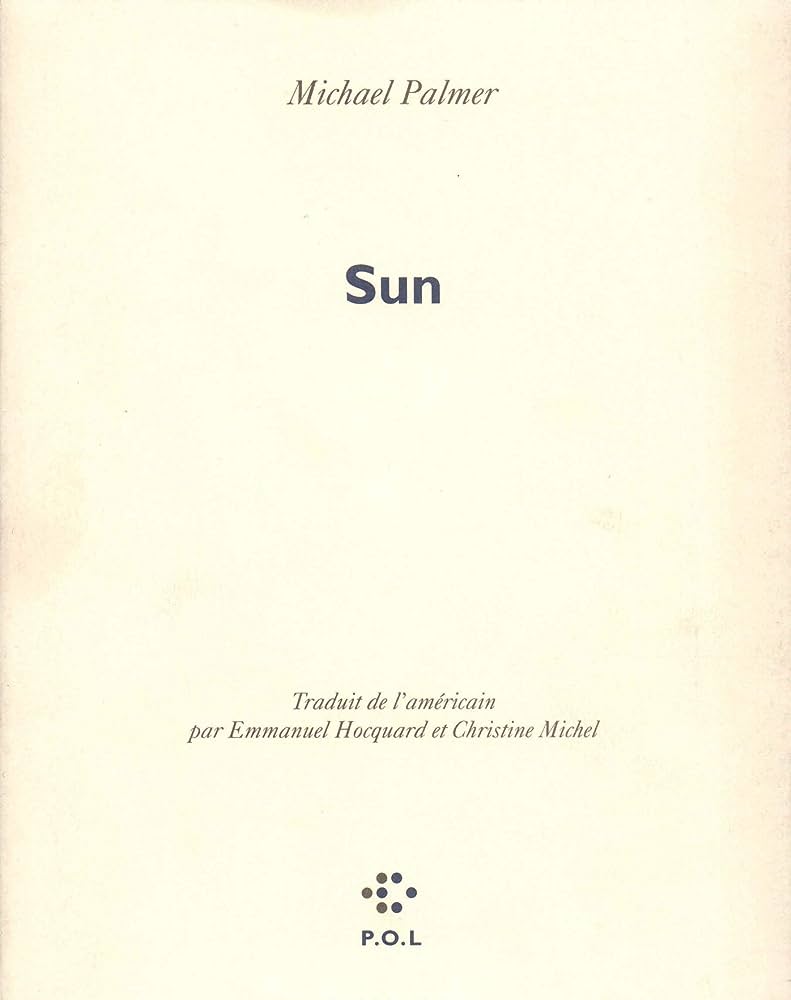
Michael Palmer, né en 1943 et vivant aujourd’hui en Californie, est communément intégré au canon de la language poetry, mouvement ou du moins communauté d’intérêts et d’amitiés constituant l’avant-garde sans doute la plus institutionnalisée du champ poétique américain contemporain. Sans programme fixe, les language poets se rassemblent cependant autour de quelques magazines et petites presses, de quelques traits formels (un art de la parataxe, une méfiance envers le récit), d’un soupçon général mais souvent joueur porté sur la langue et d’une distance réflexive vis-à-vis du « je » lyrique. Palmer n’est peut-être pas le plus connu au sein de ce groupe et demeure l’objet d’une moindre attention académique que Charles Bernstein, Lyn Hejinian ou Ron Silliman, par exemple. La façon dont il a été reçu en France lui donne cependant une centralité étonnante de ce côté-ci de l’Atlantique. Cela tient en grande partie, ainsi que l’a raconté Abigail Lang dans La conversation transatlantique (Presses du réel, 2021), livre consacré au dialogue entre poètes français et américains depuis les années 1960, à l’anthologie 21+1 poètes américains d’aujourd’hui (1986) réunie par Emmanuel Hocquard et Claude Royet-Journoud, qui en proposait un premier canon (avant même qu’une anthologie américaine fixe le sien) en se donnant pour figures primordiales Michael Palmer, Keith Waldrop et Bob Grenier.
Dans ce contexte, « Sun » est traduit précocement et doublement : par Richard Sieburth d’abord, chez Ulysse fin de siècle, en 1990, qui adjoint à son édition bilingue du poème une importante postface, « Soleil acéphale » ; et par Emmanuel Hocquard (en collaboration) ensuite, qui traduisit la « Série Baudelaire », ouverture de Sun, avec Philippe Mikriammos dès 1989 (éditions de Royaumont) puis, avec Christine Michel, l’intégralité du recueil en 1996 (P.O.L). Hocquard répondit aussi à Palmer en 1992 avec un poème propre, Théorie des Tables (P.O.L), que Palmer traduira en retour.
Palmer et Eliot : héliotropisme ambivalent
Cette intense réception française est d’autant plus surprenante que le « Sun » de Palmer se présentait comme une réponse à un texte rarement cité comme référence en France : The Waste Land de T. S. Eliot, paru en 1922. Si le centenaire de cet autre annus mirabilis du modernisme (après 1913) fut un peu célébré en France l’an passé, c’est surtout autour de l’Ulysse de Joyce, qu’on a bien voulu admettre en pendant anglophone à Proust. En revanche, La Terre vaine (suivant la traduction de Pierre Leyris) fut presque complètement oublié. Il faut pourtant mesurer à quel point ce texte, pour tout poète anglophone, est canonique : plus que cela, il incarne l’idée même de canon. Cela tient aussi à l’héritage critique d’Eliot, transmis plus marginalement en France où ce sont d’autres textes (Valéry, Proust) qui servirent la même fonction de mise à distance du biographisme et de l’étiologie, alors qu’il fut absolument fondamental pour les études littéraires anglo-saxonnes dès avant la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’à aujourd’hui.
La position de Palmer vis-à-vis d’Eliot est ambiguë : elle mêle agacement, violence même, et admiration. Les poètes language, s’ils revendiquent une postmodernité qui se veut davantage la continuité d’un certain modernisme plutôt qu’une rupture radicale avec ce qui les précède, se sont choisi comme figures tutélaires plutôt William Carlos Williams, Gertrude Stein et les objectivistes, au détriment d’Eliot. Dans un entretien avec Thomas Gardner publié dans Regions of Unlikeness (Nebraska University Press, 1999), Palmer expliquera qu’à Harvard il avait choisi d’étudier la littérature française précisément pour échapper à un canon qui lui paraissait pédant et biaisé à une époque, le début des années 1960, où Williams, Pound ou Hilda Doolittle étaient complètement absents des bibliographies universitaires alors dominées par Eliot, Auden et Frost.
Pourtant, le contre-canon que les language poets se donnent n’est pas tout à fait construit contre Eliot, lequel, malgré son conservatisme certain, demeure d’une certaine façon profondément respecté, aimé aussi, et donc irrémédiablement principiel. Ainsi Eliot serait-il quelque chose comme le soleil encombrant de la poésie américaine : celui à partir duquel les positions se définissent, mais dont la centralité, malgré toutes les planètes que l’on ajoutera au système, est rarement remise en cause de façon radicale. Le soleil, ici, est donc d’abord cela : cette métaphore pénible du « grand poète » ; et le « Sun » de Palmer semble à la fois en admettre l’évidence et se dresser contre elle.
« Sun » contient exactement, et volontairement, le même nombre de vers que The Waste Land. Palmer décrit son travail comme une tentative d’oblitération : on remplace chaque ligne par une nouvelle ligne, selon l’image d’un violent palimpseste. Mais cette image-là est aussi, en même temps, une répétition très explicite de ce qu’est La Terre vaine, lui-même collection de voix, de fragments, de citations, poème qui s’écrit par la réécriture. La violence de l’effacement est aussi une façon de reconnaître l’importance historique du long poème éliotien. Palmer, dans l’entretien susmentionné, ne dit pas autre chose :
Le nombre de vers est le même que dans La Terre vaine et en tapant à la machine j’avais l’impression d’écrire sur le texte. […] En même temps, il s’agissait évidemment d’un écho et d’un hommage à la possibilité du long poème moderniste. Cela met en jeu une certaine ambivalence. Ma propre ambivalence, certainement, envers la culture moderniste et envers ces grandes figures dont, jusqu’à un certain point, nous sommes issus [1].

Par transparence, « Sun » laisse voir le texte d’Eliot à travers des références, des citations, des personnages. Sieburth, dans la postface à sa traduction, relève par exemple : « Même paysage ravagé dans les deux poèmes, même terre désolée, même dessication, même amas de ruines, même morcellement du moi, mêmes déchets de dialogues, mêmes figures de noyés, même langue (et sexe) en défaillance, même patchwork d’allusions savantes, même Tirésias désemparé », tout en notant que ces correspondances sont autant échos que ratures – la rature elle-même n’étant pas autre chose qu’un écho, comme la terre inculte et brûlée que l’on retrouve en terreau des deux textes.
« Le réécrire pour le transformer en ce soleil froid, neutralisé, que l’on a droit de toucher.»
Un peu plus haut dans le recueil Sun, dans la « Série Baudelaire », on trouve un « frozen sun » emprunté au poète français (« De Profundis Clamavi » : « Or il n’est pas d’horreur au monde qui surpasse / La froide cruauté de ce soleil de glace » [2]). C’est à cette lumière froide que l’on peut comprendre le rapport de Palmer à Eliot : le réécrire pour le transformer en ce soleil froid, neutralisé, que l’on a droit de toucher ; et ce n’est pas tout à fait l’empêcher d’être soleil ni vouloir prendre sa place, mais en faire cet astre mort – et littérairement vivace en même temps par cela qu’il est le mieux à même de dire les catastrophes.
Hocquard et Palmer : vers la nébuleuse
En deçà de ces catastrophes, le travail de traduction puis la réponse poétique d’Emmanuel Hocquard viennent prolonger le palimpseste paradoxal opéré par Palmer et, du même coup, dédoubler les soleils. On a quatre livres : Sun de Palmer (1988) ; Sun traduit par Emmanuel Hocquard et Christine Michel (1996) ; Théorie des Tables de Hocquard (1992) ; et enfin Theory of Tables, traduction de Palmer (1994). Ensemble, ils forment, écrit Abigail Lang, « un carré d’augure, une table de billard sur l’Atlantique ». Un peu comme « Sun » effaçait The Waste Land, Théorie des Tables répond à « Sun » par la négation, remplaçant l’anaphore en « write this », « say this » qui parcourt le poème de Palmer en injonctions inversées, « ne dis pas », « ne pense pas », « n’écris pas ». Mais si l’on peut aisément pointer l’influence qu’a exercée Palmer sur Hocquard, c’est justement contre l’idée d’influence que ce dernier analyse son propre rapport à « Sun », préférant, dans le « Malaise grammatical » qui fait suite à et commente Théorie des Tables, parler d’impression :
Rares sont les livres qui m’ont impressionné. Je ne dis pas influencé. Les influences sont courantes, superficielles et utiles. […] Rares sont les livres qui m’ont impressionné veut dire impressionné comme l’est une plaque photographique: je vois ici dans ce que je n’ai pas écrit quelque chose que je reconnais comme si je l’avais écrit. Qu’est-ce qui m’a impressionné ? De la nature des choses. Ou bien, plus récemment, Sun.
Comme le note très justement Abigail Lang en commentant le « Malaise grammatical », l’influence se rattache à la métaphore stellaire : elle est ce que produit un astre sur les autres ou sur les moindres créatures. En refusant l’influence au profit d’un contact direct, Hocquard déplace le jeu même du canon et de ses lumières écrasantes. Mais l’impression d’un « Sun » sur l’autre va plus loin. Hocquard conserve vis-à-vis de Palmer la même ambivalence que celui-ci vis-à-vis d’Eliot, faisant ressurgir l’idée de l’astre : « J’ai commencé à écrire Théorie des tables comme une “suite” à ma traduction de Série Baudelaire, en Grèce, sous le Soleil de Michael Palmer. » Il la maintient donc mais la neutralise, non en congelant le soleil comme Palmer le faisait, mais en l’insérant dans un ensemble qui le dépasse et l’empêche d’être seul au centre.
Le dialogue entre Hocquard et Palmer et les autres points nodaux autour desquels leur conversation se déploie (les objectivistes, en particulier) pointent en effet vers le modèle de la communauté, voire du poème comme œuvre collective, contre celui d’un système centralisé, convergeant vers un même point. Les individualités ne s’effacent pas complètement et la critique ne cesse de recourir aux mots de nébuleuse ou de constellation – autres métaphores astrales – pour décrire l’assemblée poétique.
Écris. Nous avons brûlé tous leurs villages / Écris. Nous avons brûlé tous les villages et les gens dedans
« Sun » lui-même est aussi une étoile double : il y a deux poèmes du même titre, l’un effaçant l’autre (et les deux traductions françaises, qui conservent le titre anglais, ajoutent d’ailleurs une nouvelle pliure par laquelle une page vient recouvrir celle qui la précède). Le poème, dans sa forme, témoigne ainsi du refus d’un unique soleil, prolongeant l’opposition à l’héritage d’Eliot comme seule tradition possible – et sans le liquider pour autant.
Il met aussi en acte, par ce dédoublement, une césure plus intime. La poésie language, en effet, si elle peut se réclamer d’une exploration autobiographique (ainsi de My Life de Lyn Hejinian ou de la série des « Autobiographies » qui composent The Promises of Glass de Palmer), ne cesse d’interroger le lyrisme et ce qu’il suppose d’un sujet unificateur. Dans toute l’œuvre de Palmer, le brouillement des locuteurs, des voix, des signatures, constitue justement une forme de signature.
Il y a aussi, dans Sun, un écho volontaire du président Schreber, « qui va et vient, commente Palmer dans l’entretien avec Gardner, dans tout le livre et est l’une des figures du soleil, le soleil noir de la schizophrénie, le soleil qui sodomise le juge Schreber dans cette célèbre étude de cas de Freud ». Soleil noir : ce n’est pas la mélancolie, mais bien l’incertitude, l’ambivalence, qui surgissent ici dans l’oxymore. « Ce je est le je qui parle / (signé Scardanelli) », dit un couplet de « Sun », reprenant à son compte l’un des noms que se donnait Hölderlin, autre schizophrène célèbre, pour signer ses derniers poèmes, auxquels il attribuait aussi des dates fantaisistes prises jusqu’au vingtième siècle, comme autant de prophéties.
Dans ce monde où le moi est incertain, où le soleil implacable ne permet de rien voir ni s’il est un ou multiple, un narrateur dit : « J’écris un livre en ce moment, pas dans ma langue maternelle, qui parle de violons, de fumée, de lignes et de points qui sont libres de parler et de se transformer en ces choses que nous disons, des pages qui se redressent, jettent un œil alentour puis rament résolument vers le soleil couchant. » Palmer écrit, dans sa langue natale, le discours d’un « je » qui écrit, « pas dans [sa] langue natale », et est traduit par Hocquard vers sa langue natale, qui ainsi s’approprie un texte pour permettre qu’il l’impressionne plutôt qu’il ne l’influence (et Hocquard dit d’ailleurs : « Je n’ai pas été impressionné par Sun, de Michael Palmer, quand je l’ai lu en américain. En américain, Sun aurait pu m’influencer. Sun m’a impressionné quand j’ai traduit Série Baudelaire en français »). La langue, tirée à soi, imposée aux astres voisins (impressionnée sur eux), ne peut dire que cela : ce mouvement « vers le soleil couchant », sur une terre dévastée.
Rien de nouveau sous le soleil
Terre dévastée : c’est l’une des traductions, à côté de « vaine » ou de « gaste », proposée en français pour The Waste Land (par exemple, récemment, par Benoît Tadié dans Po&sie). À sa parution, en 1922, le long poème d’Eliot fut perçu largement comme une réponse à la dévastation de la Première Guerre mondiale. « Sun », d’une certaine façon (la plus littérale), remplace une guerre par une autre : c’est un poème hanté par le Vietnam. Le deuxième « Sun » s’ouvre ainsi sur l’injonction à préserver, en l’écrivant, ce que la guerre a fait :
Écris. Nous avons brûlé tous leurs villages
Écris. Nous avons brûlé tous les villages et les gens dedans
Écris. Nous avons adopté leurs coutumes, leur façon de s’habiller
L’idée du palimpseste se prête bien, au fond, à cette écriture du désastre : la dévastation oblitère, un texte nouveau peut s’écrire. Mais ce récit optimiste butte sur ce que dit justement The Waste Land, soit, non l’impossibilité du regain, mais son irrémissible corruption : tout ce qui sortira sera pareillement pourri et condamné (« Avril est le plus cruel des mois, il engendre / Des lilas qui jaillissent de la terre morte, il mêle / Souvenance et désir, il réveille / Par ses pluies de printemps les racines inertes », dans la traduction de Pierre Leyris).
Il ne s’agirait pas de ne voir dans « Sun » que le remplacement d’une terre dévastée par une autre. En revanche, on peut, par le rapport même qu’il établit avec The Waste Land, tâcher de le lire comme le poème générique de la terre dévastée. Ce qui s’y joue est un constat implacable et l’appel à le noter (« Écris »). C’est aussi la prophétie d’une éternelle condamnation. Et nous voilà « un jour de printemps en état de siège », prophétie de guerres à venir. Dans le dernier vers, on traverse des villages « qu’on appelle Ces Lettres – humides, sans soleil » : au bout du poème, le soleil de glace a fini par s’effacer complètement ; et « Sun », à cet égard, est un poème clos, qui conclut – et il n’y a qu’un terme possible. « C’est sur leurs murs », finit le vers, sur leurs murs intouchés par le soleil, « que s’écrit la prophétie [3] » : celle d’un désastre, d’une chute de l’astre, recommencée, et du désir – même dé-sidération – qu’il continue, en ultime paradoxe, de darder.
[1] Sauf mention contraire, toutes les traductions sont les miennes.
[2] Je souligne. Écho noté et commenté par Thomas Gardner, Regions of Unlikeness.
[3] « The writing occurs on their walls » est traduit ainsi par Hocquard : « L’écriture apparaît sur leurs murs ». On y perd la référence biblique à la prophétie (« the writing on the wall » dans le livre de Daniel – où la main divine écrit sur le mur l’annonce de la chute du roi Balthasar –, devenu expression tout à fait courante en anglais pour désigner un mauvais augure).
Dernier ouvrage paru : Parce que la nuit, Rivages.












