Isabelle Kalinowski propose avec La mélodie du monde une exploration de textes inédits en français mais dont l’impact sur la pensée musicale reste à la fois immense et plus qu’actuel. Entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle, des penseurs allemands ou états-uniens inventaient en effet une compréhension neuve de la musique, dans laquelle se sont forgées des théories et des pratiques radicales et influentes. L’ampleur intellectuelle et sensible de ce livre important soulève de nombreuses questions, que nous avons préféré soumettre à son autrice.

Vous n’êtes pas musicologue et on peut se demander comment vous en êtes arrivée aux œuvres d’Erich von Hornbostel, Carl Stumpf et Karl Bücher consacrées à la musique. Ce sont des pensées très méconnues en France. Est-ce par le biais de vos recherches antérieures sur Franz Boas ou des intellectuels allemands comme Carl Einstein ?
Cette question musicale m’est venue de l’extérieur, elle a croisé mes recherches de germaniste. J’avais toujours été très attentive à ce que Boas faisait avec la musique et il en était déjà question dans La parole inouïe, coécrit avec Camille Joseph et publié par les éditions Anacharsis en 2022. Boas conçoit les mots et les langues comme des univers sonores. Au-delà de la phonétique, il s’intéresse aux chants : il les retranscrit, souvent avec des partitions. Il avait une formation musicale suffisante pour faire ce genre d’opérations. La manière dont Boas parlait de l’écoute concernait le langage mais était tout à fait transposable à la musique. La question de fond qu’il pose est celle de la pertinence de nos perceptions : peut-on se rendre capable d’entendre les langages que l’on ne connaît pas encore ?
Les éditions de la Philharmonie m’ont proposé un travail d’anthologie sur des textes allemands consacrés à la sociologie et à l’anthropologie de la musique au début du XXe siècle. La rédaction de l’introduction a finalement donné naissance à ce livre, qui précède et prépare la publication de l’anthologie de textes.
Vous ne connaissiez donc pas ces textes avant ce travail de commande ?
J’avais participé en juin 2005 à un colloque à l’IRCAM, organisé par Philippe Despoix, qui m’avait beaucoup marquée ; il portait sur la sociologie de la musique de Weber et ses retombées, sa réception. J’avais rencontré certains musicologues et ethnomusicologues avec qui le dialogue s’était amorcé et cela m’avait captivée. C’est là que j’ai découvert l’œuvre d’Erich von Hornbostel, notamment.
J’ai le sentiment que ces références n’étaient pas non plus très citées par les ethnomusicologues ou musicologues français…
Ce sont des auteurs certainement moins connus que dans d’autres pays, notamment en Allemagne, où assez logiquement on sollicite beaucoup plus ces travaux. Il y a même, ces dernières années, outre-Rhin, des publications assez abondantes autour de Stumpf et Hornbostel. En France, les travaux de ce dernier sont surtout connus pour la question des instruments, à travers son traité d’organologie écrit avec Curt Sachs en 1914 1. C’est un texte important, connu des musicologues qui le considèrent souvent comme un classique. Mais le reste de la production de cette école demeure encore ignoré. Mon éditrice, Sabrina Valy, a noté à quel point certaines études importantes dans le corpus américain, sans doute le corpus de référence aujourd’hui pour les ethnomusicologues, avaient déjà été préfigurées dans ces textes allemands antérieurs d’un demi-siècle.
En lisant La mélodie du monde, j’ai été frappé par la découverte d’une pensée et d’une pratique ethnomusicologique déjà très abouties, alors qu’on est plusieurs décennies avant les travaux d’André Schaeffner ou de Gilbert Rouget ! Les ethnomusicologues français avec qui vous avez échangé ont-ils partagé cet étonnement ?
Absolument !

Les textes que vous citez sont déjà très critiques vis-à-vis de l’ethnocentrisme dans l’approche des musiques extra-occidentales. On a le sentiment que ces textes sur la musique sont pionniers dans cette réflexion critique à l’égard de l’ethnocentrisme savant.
C’est un point délicat : bien entendu, ces auteurs n’échappent pas à tout jugement préconçu. Cependant, leur démarche est intéressante car ils ne partent pas d’une critique de l’ethnocentrisme, mais d’un intérêt pour des musiques qu’ils n’ont jamais entendues. C’est en découvrant ces musiques et leur propre désarroi, leurs difficultés à les analyser, qu’ils sont conduits à remettre en cause leurs catégories d’analyse. Le processus vient d’abord de questionnements centrés sur la musique et les sciences « dures » : ils prennent pour point de départ des problèmes relevant des sciences de la nature, de la physiologie, de la psycho-physique, etc. Ils se focalisent initialement sur la question du son et celle de la perception du son. Ils ne partent pas d’un a priori anti-colonial – même si l’on rencontre chez Boas un impetus politique très fort en faveur des « Premières Nations » – mais ils entament leur réflexion en soulevant un problème scientifique qui les conduit à poser des questions assez radicales. Le renoncement à penser l’harmonie comme le couronnement de toute l’évolution musicale est un grand bouleversement. Il ouvre la voie à la possibilité d’accepter qu’il existe des systèmes qui fonctionnent autrement, et à la reconnaissance de la nécessité de trouver des outils permettant d’accueillir cette forme d’altérité. Leur démarche est d’abord scientifique, technique, et elle possède dans un second temps des retombées éthiques, qui ne sont pas formulées abstraitement.
La mélodie du monde contient des développements très précis sur la matérialité de l’enregistrement : comment enregistrer les sons des autres cultures ? Les auteurs que vous étudiez ont un côté technophile très prononcé et s’intéressent activement au phonogramme, qui est alors un objet très neuf. J’ai tout de suite pensé aux réflexions contemporaines suscitées par l’invention d’Edison, qui avait créé une véritable révolution dans notre rapport au son 2.
C’est un point fondamental. Pour ce groupe de savants, l’apparition du phonographe d’Edison est la condition de l’intérêt qu’ils portent aux musiques extra-européennes : il fonde la possibilité de les étudier scientifiquement. Sans le phonographe, leurs démarches n’auraient pas pu voir le jour ; ils considéraient que ces musiques n’étaient pas analysables sans cet outil. Les transcriptions des voyageurs, y compris de ceux qui possédaient une bonne formation musicale, leur apparaissaient comme une forme d’amateurisme. Ces transcriptions ne faisaient que reconduire les schématismes dans lesquels ces mêmes voyageurs avaient été formés, même s’ils étaient musicologues et savants. On ne parvenait pas à sortir du système dans lequel on était pris.
« Le renoncement à penser l’harmonie comme le couronnement de toute l’évolution musicale est un grand bouleversement. »
Le plus important pour ces auteurs était l’idée que l’analyse nécessitait une répétition, notamment une répétition à l’identique. L’enregistrement la rendait possible. J’avais rencontré Simha Arom dans le colloque de 2005 : il expliquait que, lors de ses premières visites chez les Pygmées Aka, il avait été frappé de constater que lorsqu’il demandait aux musiciens de répéter, ils ne jouaient jamais la même musique 3. Cela lui avait permis de comprendre ce que signifiait la structure selon Lévi-Strauss : pour les Pygmées, répéter était conserver la structure en la faisant varier. Dans ce contexte musical mais aussi dans beaucoup d’autres, il n’est donc concrètement pas possible de demander de répéter en dehors de la présence technique du phonographe. Cette répétition à l’identique était pour les auteurs évoqués dans mon livre la condition sine qua non d’une étude de ces musiques. Elles étaient trop insaisissables pour pouvoir être déchiffrées suffisamment après une seule écoute. Dans La mélodie du monde, il est question des archives qu’ont laissées Stumpf et Hornbostel : ce sont des cylindres de cire [sur lesquels les premiers phonographes enregistraient la musique].
Il y a une modernité radicale dans leur idée que l’oreille humaine est faillible. Les limites de la musique occidentale sont selon eux en partie liées à l’oubli de cette faillibilité, qui les conduit à théoriser un nouveau rapport à la musique en utilisant la psychologie du son, la théorie harmonique, l’anatomie…
Hermann von Helmholtz est placé au commencement de mon livre parce qu’il est parti justement de cette question : l’audition est-elle un fait objectif, universel ? Il postule l’idée que l’audition peut être objectivée, mais ouvre déjà beaucoup de remises en question – comme l’a montré Jacques Bouveresse dans l’une de ses dernières publications.
L’apport de Boas est ensuite très important, ainsi que les approfondissements proposés par ses collègues musicologues. Il formule une idée qui a une immense portée épistémologique : il ne suffit pas d’être animé par une curiosité, une ouverture d’esprit, une envie de découvrir l’altérité, pour avoir accès à cette altérité. À l’échelle de notre perception, de notre langage, qui vont de pair avec des catégories inconscientes, se produisent des phénomènes qui ne peuvent pas être contrôlés par la seule bonne volonté. Il ne suffit pas de s’intéresser éthiquement à d’autres langages ou musiques pour être capable de les entendre. C’est toute la question de la projection. Le point le plus extraordinaire de leur démonstration est de postuler que ce sont en réalité les plus savants qui ont le risque le plus grand de faire des projections sur leur perception des langues et musiques venues d’ailleurs. Je crois que c’est une mise en garde extrêmement précieuse et salutaire, qui reste neuve aujourd’hui bien qu’elle soit ancienne.
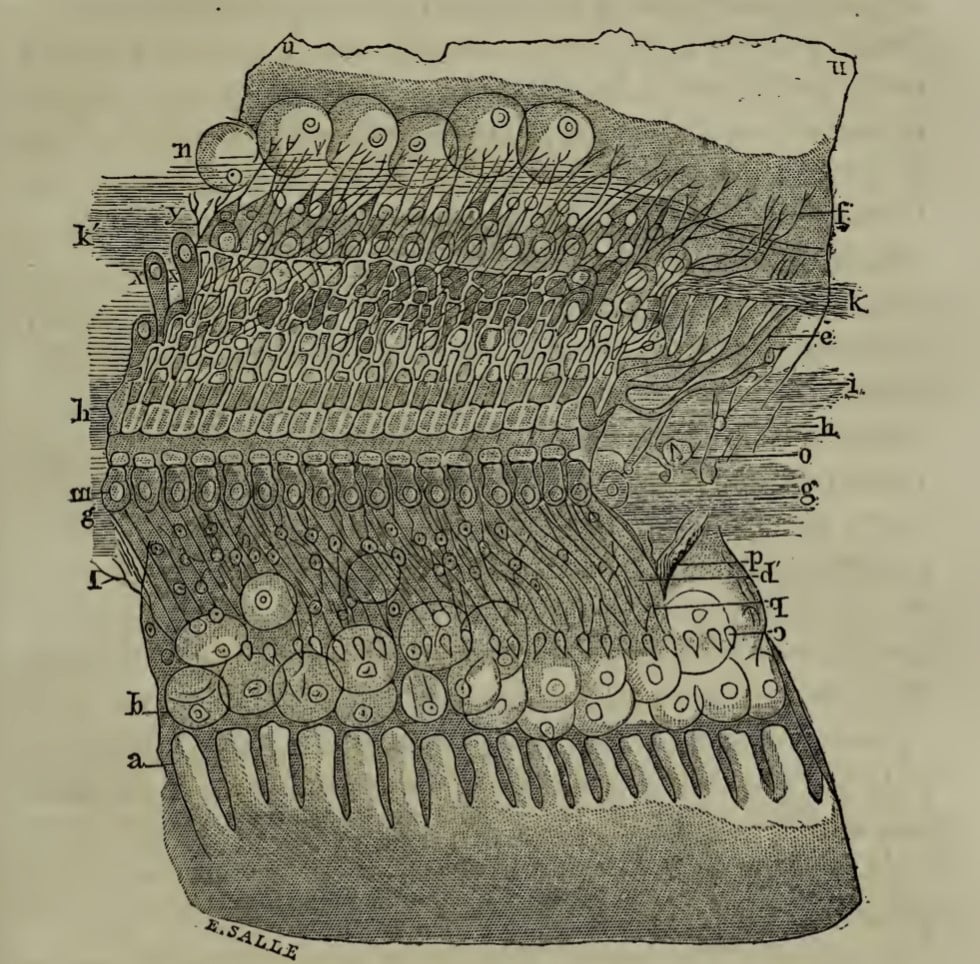
Cette vigilance est d’autant plus frappante que vous étudiez des savants à la culture particulièrement vaste, capables d’intervenir dans de nombreuses disciplines et spécialités. Stumpf, Hornbostel ou Bücher sont-ils des exceptions dans le paysage universitaire germanique de cette période qui va de la fin du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux-guerres ?
Ils n’ont rien d’exceptionnel ! J’avais fait le même constat dans mes travaux sur Max Weber, qui décide de s’intéresser aux religions de l’Inde et assimile en l’espace de quelques mois une multitude de connaissances. À partir de là, il développe des réflexions et des intuitions sur les cultures de l’Inde qui sont encore aujourd’hui considérées par les spécialistes comme n’étant pas dénuées de pertinence : il parvient à saisir des aspects décisifs.
« Il ne suffit pas de s’intéresser éthiquement à d’autres langages ou musiques pour être capable de les entendre. »
Nous avons du mal à nous départir de l’idée qu’il existe une sorte de progrès de la science, et à cesser de penser qu’après une période de dilettantisme apparaît, à la fin du XIXe siècle, une spécialisation des disciplines qui conditionne leur accès à la scientificité. Nous parlons aujourd’hui beaucoup d’interdisciplinarité. Mais, par rapport à notre définition actuelle des rencontres à organiser entre les sciences, les croisements qu’effectuaient les auteurs que j’étudie sont des croisements que nous aurions du mal à réaliser, et qui n’entrent plus dans notre champ de possibles. Ils n’opéraient pas ces jonctions scientifiques en dilettantes, mais avec le niveau le plus haut des connaissances qui pouvait être atteint dans ces disciplines à l’époque. Les manières de s’emparer d’un objet, de le découvrir, de l’approfondir, y compris dans une socialisation avec d’autres spécialistes, ont beaucoup changé, et redécouvrir les associations très inventives opérées au début du XXe siècle peut encore nous inspirer aujourd’hui.
À la même époque, la musicologie française s’organise très différemment, si l’on pense à des figures comme celle de Romain Rolland, ou même à des auteurs passés par la Schola Cantorum. À première vue, les musicologues français semblent bien plus conservateurs. Avez-vous des points de comparaison entre les deux pays ?
Si l’on étudiait la musicologie officielle et classique qui avait cours en Allemagne à la même époque, nul doute qu’on trouverait des formes de nationalisme très exacerbées ! J’ai pu d’ailleurs le constater en observant la manière dont ont été reçus certains écrits, certaines conférences de Hornbostel : les congrès internationaux de musicologie sont ouverts à ses travaux jusqu’aux années 1910, mais la Première Guerre mondiale va entraîner une re-nationalisation de la pratique de la musicologie, qui va avoir pour conséquence des condamnations fortes des idées des premiers ethnomusicologues germaniques. Les chercheurs qui sont au cœur de ce livre ne sont pas des acteurs clé de la musicologie institutionnelle, ils sont en marge, au carrefour de plusieurs disciplines. Je pense qu’on ne peut donc pas les comparer avec la musicologie française de la même époque.
En revanche, je crois qu’il serait judicieux de faire le lien avec la tradition française ethnographique, avec le groupe des durkheimiens, avec les élèves de Marcel Mauss. C’est la tradition dont est issu quelqu’un comme André Schaeffner, qui publie surtout ses travaux dans les années 1930. On voit très bien la jonction qui s’opère : quand Hornbostel et Curt Sachs partent en exil, ils font d’abord halte à Paris avant de se rendre aux États-Unis. Ils sont tout de suite reçus par les gens travaillant au musée de l’Homme, et se lient avec Schaeffner 4. La jonction se fait avec le courant sociologique et ethnographique français plus qu’avec la musicologie officielle.
Votre travail propose une généalogie forte entre le travail de ces auteurs sur l’idée de forme (Gestalt) appliquée à la musique et le structuralisme élaboré par Lévi-Strauss après la Seconde Guerre. Je me suis demandé si vous n’interprétiez pas l’introduction des Mythologiques de Lévi-Strauss, avec cette fameuse forme sonate, comme étant influencée par les auteurs que vous étudiez.
« Qu’est-ce qu’une mélodie ? Qu’est-ce qui fait que tiennent ensemble des éléments dont on se dit qu’ils présentent un début, une fin, et que tout cela marche ensemble ? »
J’en suis assez convaincue, mais cette influence est sans doute en partie indirecte. Il est fascinant de suivre le trajet parcouru par ces idées. Je crois que Boas a joué un rôle fondamental dans cette généalogie. La rencontre entre Boas et Lévi-Strauss se fait à l’extrême limite du parcours du premier, puisqu’elle a lieu juste avant sa mort. En 1942, Lévi-Strauss rencontre à New York d’abord Jakobson, puis Boas – ces deux derniers étaient proches. Leurs échanges concernent d’abord la question du langage, mais Boas avait été préalablement l’un des acteurs déterminants de l’émergence de la question de la Gestalt, notamment à travers ses travaux sur la musique qui ont inspiré Stumpf, Hornbostel, et tous les tenants de la psychologie de la forme.
L’hypothèse serait que, face à ces musiques qu’ils n’arrivaient pas à classer selon les catégories de l’harmonie, ces auteurs ont choisi de se tourner vers la mélodie. Ils ont pensé la mélodie comme Gestalt. Qu’est-ce qu’une mélodie ? Qu’est-ce qui fait que tiennent ensemble des éléments dont on se dit qu’ils présentent un début, une fin, et que tout cela marche ensemble ? C’était à mes yeux une clef déterminante pour concevoir ensuite ce qu’est une structure, qui n’est pas simplement faite d’oppositions quasi géométriques, mais se présente comme une puissance de variation, quelque chose qui va permettre de manière très vivante une production infinie de variantes.
« C’est une des leçons que nous apportent ces auteurs : regarder le monde à travers le prisme de la musique donne une vision radicalement transformée du monde et des peuples autres, par rapport aux schémas évolutionnistes. »
Boas l’avait déjà complètement développé dans ses études sur les légendes indiennes, de façon très précoce : il avait constaté que, pour rendre compte de la production mythologique, il ne fallait pas chercher la légende originale, « authentique », mais plutôt concevoir une structure qui pouvait être renouvelée sans cesse sans perdre sa substance. Toutes les variantes des mythes étaient pour lui aussi légitimes que ce qu’on avait voulu appeler le premier mythe, l’origine, et que lui-même ne tentait plus de retrouver. Boas a tout de suite pensé les choses de manière horizontale, comme production de variantes. Le lien avec la créativité musicale et ce qui se joue dans la Gestalt mélodique me paraît assez fort, et je pense que Lévi-Strauss en est un héritier, qui a très bien saisi l’immense portée de cette manière de conceptualiser les choses.

Malgré tout, dans l’introduction des Mythologiques, Lévi-Strauss donne une inflexion à la musique en tant qu’objet des sciences sociales et humaines, que je ne retrouve pas chez les auteurs que vous analysez. Lévi-Strauss fait de la musique le « suprême mystère des sciences de l’homme » 5. N’y a-t-il pas aussi chez Lévi-Strauss une tension inédite entre la musique comme moyen d’une scientificité renouvelée et comme mystique ?
Peut-être qu’en cherchant on trouverait aussi cette mystique chez Stumpf et Hornbostel. On voit déjà ce genre d’idées chez Helmholtz et je pense que c’est aussi ce qui fait de la musique un objet scientifiquement intéressant, car il va de l’extrême matérialisation – nous évoquions précédemment la dimension technique – jusqu’à l’extrême dématérialisation. Les auteurs que j’ai étudiés sont toujours partagés entre ces deux pôles : une sorte de spiritualisation évanescente, insaisissable, et, d’un autre côté, quelque chose qui se rattache au rythme, aux pieds, à un ancrage dans la physiologie du corps. Cela crée des contradictions sur lesquelles ces penseurs jouent beaucoup.
Au-delà du cliché sur la musique comme art universel par excellence, il est indéniable qu’elle est un objet à la fois mineur et central pour de nombreux travaux. Comment expliquez-vous qu’on retrouve si souvent cette situation de la musique, qui est souvent en marge des études scientifiques et universitaires, où elle ne fait pas figure de « grand sujet », mais qu’on retrouve souvent dans nombre de travaux ?
C’est une des leçons que nous apportent ces auteurs : regarder le monde à travers le prisme de la musique donne une vision radicalement transformée du monde et des peuples autres, par rapport aux schémas évolutionnistes.
[1] Erich M. von Hornbostel et Curt Sachs, Systematik der Musikinstrumente. Ein Versuch. In Zeitschrift für Ethnologie. Band 46, 1914, Heft.
[2] Greg Milner, Perfecting Sound Forever. Une histoire de la musique enregistrée, Le Castor Astral, 2014.
[3] En dehors des enregistrements de Simha Arom, un documentaire lui a récemment été consacré.
Par ailleurs, France Culture a consacré un grand entretien passionnant à son œuvre et sa pensée.
[4] André Schaeffner avait, cela dit, étudié la musique à la Schola Cantorum. Il a publié un traité d’organologie célèbre, influencé par celui de Hornbostel et Curt Sachs. [5] Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit, Plon, 1964, p. 26 : « Mais que la musique soit un langage, par le moyen duquel sont élaborés des messages dont certains au moins sont compris de l’immense majorité alors qu’une infime minorité seulement est capable de les émettre, et qu’entre tous les langages, celui-là seul réunisse les caractères contradictoires d’être tout à la fois intelligible et intraduisible, fait du créateur de musique, un être pareil aux dieux, et de la musique elle-même le suprême mystère des sciences de l’homme, celui contre lequel elles butent, et qui garde la clé de leur progrès. »










