Yoko Tawada, comme le savent bien les éditions Verdier qui publient de façon concomitante une traduction du japonais et une autre de l’allemand, est une écrivaine d’entre les langues. Non seulement parce qu’elle écrit en japonais et en allemand, et qu’elle joue de l’interculturalité, comme en témoignait notamment son Opium pour Ovide, mais parce que la langue sous sa plume se dédouble, se commente.
Yoko Tawada, En éclaireur. Trad. du japonais par Dominique Palmé. Verdier, 160 p., 19 €
Yoko Tawada, L’ange transtibétain. Trad. de l’allemand par Bernard Banoun. Postface de Sven Keromnes. Verdier, 128 p., 18,50 €
Dans leurs rêveries, les personnages relèvent des tournures de phrases, des stéréotypes culturels, essaient ici ou là de possibles traductions, commentent le jeu des idéogrammes et des assonances intralinguistiques. C’est comme si la langue de Yoko Tawada était toujours un peu décalée, plurielle, ou en partance. N’a-t-elle pas déclaré (1) que « lorsqu’on prend la parole à l’étranger c’est comme si la voix planait dans l’air, nue, insituable comme celle d’un oiseau » ? Et l’autrice tirait le fil : inscrire ainsi de l’insituable dans une parole sociale est l’apanage des étrangers au sens national du terme, mais aussi des individus, et des écrivains. Ils forent de petites ouïes dans la langue, par où s’entend, gage d’humanité, une langue d’entre les langues : l’insituable voix des oiseaux. Ailleurs (2), Yoka Tawada transcrivait le mot allemand signifiant « traductions » (« Übersetzungen ») en « Überseezungen » : « au-delà des mers, les langues ». Aussi a-t-on l’impression de ne pouvoir lire Yoko Tawada qu’en traduction, langue originale ou pas.

Yoko Tawada (2011) © Jean-Luc Bertini
Effet d’époque sans doute, et d’inquiétude, face aux catastrophes passées et à venir, les deux derniers romans de Yoko Tawada reprennent cette thématique de l’expérience interculturelle, littéraire et de traduction, mais pour souligner son empêchement ou son affolement dans un monde de plus en plus refermé sur lui-même – ou, ce qui revient au même, dans des mondes de plus en plus disjoints. La drôlerie et la légèreté – toujours présentes chez Yoko Tawada – coexistent alors avec un sentiment très sombre et douloureux de l’avenir.
En éclaireur, bien qu’écrit avant le confinement, est des deux romans le plus explicitement placé sous le signe de l’enfermement. Il se situe dans un Japon dystopique, entièrement contaminé, dont les frontières sont fermées et où les langues étrangères sont interdites. La contamination de la terre empêche toute expérience de « pique-nique à la campagne », le pays, régi par un pouvoir totalitaire et invisible, ouaté, a fermé ses frontières, les mots anglais sont désormais bannis, tout comme les toponymes étrangers. Toute pratique plurilingue est donc interdite. Du reste, le territoire national lui-même s’est morcelé. Des proches ont disparu dans des usines ou dans les plantations, on ne sait pas très bien d’où ils envoient des lettres inconsistantes. Ce n’est pas l’ère d’Edo, comme le vante la propagande, c’est bien pire.

Une forêt près de Fukushima (9 août 2020) © CC4.0/Ka23 13/WikiCommons
Yoshiro, écrivain plus que centenaire, élève seul son arrière-petit-fils surdoué, mais destiné à mourir très jeune. Et la scène où l’enfant, voyant pour la première fois une carte du monde, sent ses membres lui échapper et son corps entrer en convulsion, dit combien sa santé reflète celle du monde. De même, cette juvénile affirmation : « J’ai avalé la terre ». Le renversement dystopique (les vieux, en bonne santé, s’occupent des plus jeunes, vulnérables) s’avère très efficace pour dire la culpabilité écologique et politique à l’égard des générations à venir tout en produisant une espèce d’incongruité parfois drôle. Car le pire chez Yoko Tawada, même sans issue, se pose presque toujours avec légèreté, comme si le lourd et le léger pouvaient échanger leur polarité, comme si un minimum de décalage, toujours, était requis pour qu’une narration puisse trouver, ou imposer, son espace.
Yoshiro, qui va tous les jours courir, compare les différentes vertus des chiens de location ; un peu plus loin, c’est une ode à l’orange pressée qu’il compose en l’honneur de son arrière-petit-fils ; ailleurs, c’est son étonnement devant la façon dont le boulanger a traduit les noms de pains allemands, noms interdits car étrangers, mais dont lui et quelques autres se souviennent. Ailleurs encore, c’est la capacité de l’enfant, de plain-pied dans le monde qui est le sien, à rassurer son arrière-grand-père, ou sa joie, devenu adolescent, à se propulser hors de son fauteuil roulant pour connaitre les délices du vol plané – si possible face à la mer. Un peu de suspension allège alors la pesanteur de ce monde empêché. Et c’est dans de tels moments, dérivants, un peu folâtres, que s’esquisse, au moins un peu, une hypothèse narrative heureuse : telles coïncidences vraiment sans intérêt (hauteur, diamètre, consistances de cire) ne désigneraient-elles pas l’existence d’une société quasi secrète, consciente que des mondes ultra-marins existent encore ? C’est dans le détail des assonances, des ressemblances, des fantaisies linguistiques et narratives, que la pensée circule encore et transmet, mi-medium mi-joueuse, quelques frêles nouvelles de l’avenir.
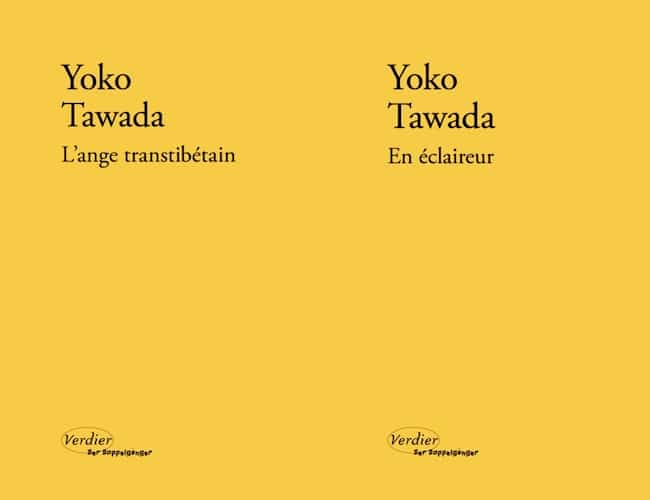
L’ ange transtibétain (traduit par Bernard Banoun et dont le titre, mot à mot, eût pu être « Celan et l’ange chinois ») se passe à Berlin, sous le signe de Paul Celan. Et sans doute, comme l’indique la postface de Sven Keromnes, a-t-il été composé pendant l’année de confinement. (Yoko Tawada devait, en cette année 2020, prononcer une conférence sur Celan, auteur sur lequel elle a déjà beaucoup écrit, commentant notamment les traductions de son œuvre en japonais.)
Au roman : Patrik, d’origine ukrainienne (né dans la même ville, alors roumaine, que Celan), spécialiste du susdit poète, est, quant à lui, trop troublé pour faire de sa spécialité un usage socialement fécond. Il s’appelle lui-même le patient, ne sait s’il dort ou s’il est éveillé, s’il est dehors ou dans son lit. Il aime bien parler de lui à la troisième personne, non par grandiloquence mais pour des raisons de respiration grammaticale et parce que cela lui permet de laisser libre cours au flux de ses lèvres intérieures (verticales et humides) qui aiment bien inventer.
Dans ce trouble, trois passions l’animent. La première consiste à tourner à gauche quand il sort de chez lui. La seconde lui est inspirée par une cantatrice qu’il a la chance d’entendre et d’approcher souvent, soit en regardant des DVD d’opéra, soit dans ses souvenirs plus ou moins inventés, soit dans la rue – et alors il est touché par son allure d’ornithologue. La troisième passion est celle qu’il voue, comme Yoko Tawada, à Paul Celan – en particulier à son dernier recueil, Fadensonnen (« Soleils de fils »), que Celan composa dans une période de grave crise, peu de temps avant de se suicider. Patrik a, du reste, été invité à venir en parler à Paris. Comment fera-t-il, lui qui ne perçoit son corps qu’à travers les mots de Celan ? Lui qui aime parler de littérature, non pour produire du savoir, mais pour « entendre de la musique », qui pense que ce que faisait vraiment Celan, en traduisant, c’était, comme les oiseaux, chanter ? Lui qui se vit chauve-souris, à côté de Kafka – choucas (en hongrois) ? On reconnait bien ici des thèmes chers à Yoko Tawada : mais, quant au personnage de roman, Patrik, osera-t-il déployer ses ailes et sa voix ?

À Berlin © CC BY 2.0/Dr. Matthias Ripp/Flickr
Non – Patrik n’abordera pas aux rives du discours académique (à notre grand regret, compensé toutefois par le fait que Yoko Tawada, elle, y aborde très bien). Ses ailes de chauve-souris et un enroulement du temps sur lui-même l’en empêcheront. Et surtout, Patrik fait la rencontre d’un ange. C’est un ange encourageant, certes, mais un brin psychopompe. Il a pour nom Éric-Léo Fu. D’où vient-il exactement ? On ne sait, et les suppositions que fait Patrik sont toutes plus amusantes les unes que les autres, tant elles jouent avec les clichés que les Occidentaux, manifestement, projettent sur un visage asiatique. Éric-Léo Fu finit par se présenter comme le petit-fils du médecin chinois qui, nous apprend-il, fut un grand interlocuteur de Celan dans ses dernières années à Paris. Parler indéfiniment de Celan avec ou à cet ange médiumnique, attentif et un tantinet complaisant, permet de faire totalement dériver la philologie celanienne, de faire miroiter des lectures à la fois interculturelles et cryptées. C’est alors, dans un premier temps, à la fois suggestif, drôle et déroutant.
« Le méridien », discours que Celan prononça lors de la réception du prix Büchner et qui indiquait la possibilité du poème d’aller vers la rencontre, entre en écho, grâce à une petite planche anatomique fournie par Éric-Léo Fu (et reproduite dans l’ouvrage), avec le méridien de la médecine chinoise. Alors, ce n’est pas seulement de littérature mais bien de souci de soi et de guérison corporelle et psychique qu’il est question – Patrik s’apercevant que son cœur souffre certainement d’avoir été trop métaphorisé par la poésie sentimentale. À peine plus loin, ce méridien de la médecine chinoise associe presque, comme le remarque Patrik, les quatre noms d’organes (tous de quatre lettres !) qui ponctuent le recueil « Soleils de fils » et disent, selon lui, un morcellement du corps.
C’est alors à la fois drôle et déroutant, mais aussi un peu désespéré. La lectrice, d’abord intéressée par ce qui serait une « vraie » lecture de Celan, est peu à peu amenée à se dessaisir de son intérêt premier, à laisser le sens lui filer entre les doigts comme du sable, ou comme la raison de Patrik. Ce vain écoulement du sens ne crée pas d’espace ou du moins pas d’espace habitable : il souligne, au mieux, les contours d’une absence, opaque comme un cube noir. Et malgré la citation répétée du vers celanien, « il y a encore des chants à chanter au-delà de l’humanité », le dialogue interculturel et traduisant n’ouvre pas vraiment sur l’insituable d’un chant, ou bien c’est un chant doublé de silence. La fuite du sens a quelque chose d’imparable et de douloureux. Et c’est peut-être là, dans la reconnaissance d’un silence opaque, plus que dans aucune des interprétations données par les personnages, que se lisent le mieux, de façon oblique, l’hommage à Paul Celan et l’inquiétude du monde.
-
Verwandlungen. Tübinger Poetik Vorlesungen (1998).
-
Überseezungen (2002).












