L’écrivain américain Russell Banks est mort le 7 janvier 2023 à l’âge de 82 ans. Né en 1940 dans le Massachusetts, il avait signé une vingtaine de romans et de recueils de nouvelles depuis Family Life, son premier roman paru en 1975, jusqu’à Oh, Canada (Actes Sud, 2022 ; publié en anglais sous le titre Foregone en 2021). En 2012, nos amis de l’excellente revue La Femelle du Requin s’étaient entretenus avec lui. EaN publie des extraits de cette discussion.

Russell Banks © Jean-Luc Bertini
Les femmes, le divorce, des foyers brisés… L’absence de domicile est un thème récurrent de votre œuvre, comme dans Continents à la dérive où les personnages bougent tout le temps pour trouver un foyer, un lieu auquel ils pourraient appartenir. Nicole Krauss a déclaré que « les écrivains deviennent des écrivains parce qu’ils ne se sentent pas chez eux dans le monde ». Adhérez-vous à cette conception de l’écriture ?
Je participais à la conférence au cours de laquelle elle a déclaré cela, et je n’étais pas vraiment d’accord avec elle. J’ai pensé que c’était peut-être vrai pour elle du fait qu’elle est fille d’immigrés ayant fui l’Ukraine envahie par l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, cela avait sans doute à voir avec sa mythologie familiale. Mais son histoire est très différente de la mienne, et je ne crois pas que ce soit une métaphore très signifiante en ce qui me concerne.
Je crois cependant à la possibilité de voyager et de trouver un endroit où il serait possible de se réinventer. C’est un très beau rêve américain : si l’on peut changer son lieu de vie, on peut changer qui l’on est. Ce fantasme remonte à l’arrivée des Européens, qui ont fait cela quand ils sont partis d’Europe : ils pensaient pouvoir changer qui ils étaient en rejoignant le Nouveau Monde. L’idée même de Nouveau Monde est fascinante. J’ai d’ailleurs écrit un recueil de nouvelles, dans les années 1970, qui s’appelait The New World. C’est un rêve vraiment important pour moi, un rêve que ma famille, qui bougeait sans arrêt quand j’ai grandi, a vécu.
Quant à l’écriture, je la vois comme une discipline et une responsabilité. Elle a créé un ordre dans ma vie et m’a permis de trouver une sorte de santé mentale, éthique et intellectuelle. Non pas comme si j’avais prononcé des vœux monastiques, mais presque. Comme si j’avais accepté, en consacrant ma vie à l’écriture, une certaine discipline et un certain nombre de responsabilités qui la rendraient cohérente. Mais je ne l’ai jamais considérée comme la recherche d’un foyer.
Beaucoup de vos personnages qui sont à la recherche d’un nouveau foyer ne semblent d’ailleurs pas parvenir à en trouver un. Pensez-vous qu’il soit toujours possible de se réinventer aux États-Unis ?
Je crois que c’est possible, mais pas simplement en changeant de lieu. Ça, c’est le rêve américain : « Go West, young man ! » À la fin du premier grand roman américain, Huckleberry Finn, le héros descend la rivière sur son radeau et, finalement, part pour le « Territoire », ce monde indien, à l’Ouest, aux confins de la société. On peut présumer que cela représente son avenir, qu’il va devenir différent du gosse qu’il était au moment de monter sur le radeau, qu’il va devenir libre, au sens existentiel du terme. C’est le rêve de celui qui ne s’arrête jamais de bouger, comme dans Sur la route de Kerouac.
Continents à la dérive était pour moi la première occasion de questionner ce mythe, ce fantasme, pour voir s’il était vrai, comme le croyait ma famille, qu’en déménageant en bas de la rue ou dans la ville d’à côté, sans même changer d’État, on pourrait avoir une vie différente, recommencer avec l’idée que notre mariage irait mieux, qu’on allait gagner plus d’argent et effacer nos dettes… Toutes ces croyances liées au lieu physique font partie de notre imaginaire depuis des siècles. C’est une chose que les Européens n’ont jamais laissé se développer : l’idée qu’en déménageant à Toulouse, tout ira bien, que les choses vont rouler… Les Européens croient que si on va là-bas, les choses seront exactement comme à Paris ! Nous ne pensons pas ainsi.
Est-ce que Miami et l’État de Floride représentent cette idée que le rêve américain peut se réaliser en changeant simplement de lieu ?
Oui, sans aucun doute. Il y a deux lieux où l’on croit pouvoir changer de vie : Los Angeles, la Californie, la côte Ouest, et l’extrême sud de la côte Est, la Floride. Miami est particulièrement intéressante parce que c’est le centre d’un vortex autour duquel tournent les mondes latino, caribéen et africain. Ils se retrouvent tous un peu là : les vieux Juifs new-yorkais à la retraite qui descendent à Miami Beach, les Jamaïcains, les Cubains, les Asiatiques, les Dominicains, les Argentins, les Brésiliens, et les Africains qui arrivent de l’autre côté de l’océan. J’adore le fait que tout cela tourne autour de cet endroit. C’est comme un symbole des États-Unis tout entiers. Dans Continents à la dérive, le sud de la Floride est un lieu essentiel à l’histoire puisque c’est là que se rencontrent, dans une gigantesque collision, Bob Dubois, ce type qui débarque du Nord pour recommencer sa vie, et Vanise, qui débarque du Sud avec la même idée.

Russell Banks © Jean-Luc Bertini
Je vois les deux régions au sujet desquelles j’ai beaucoup écrit, la Nouvelle-Angleterre et le sud de la Floride, comme des lieux de rencontre, de confrontation. La première est l’endroit où je vis six mois de l’année, dans le nord de l’État de New York, en Nouvelle-Angleterre, juste à la frontière canadienne. Et l’autre, où je vis le reste de l’année, est juste à la frontière des Caraïbes. Je crois que je me sens le plus à l’aise aux frontières, aux limites. J’en ai parlé à Jim Harrison, qui vit à côté de frontières lui aussi, au Montana, la frontière canadienne, et au Nouveau-Mexique, la frontière mexicaine. On se dit tous les deux : « Si je dois me tirer du pays, je peux me tirer vite fait ! »
[…]
Vous avez écrit une lettre ouverte à votre petite-fille où vous mentionnez les « textes sacrés » que l’on se doit d’honorer : la Constitution, la Déclaration d’indépendance… En tant qu’écrivain, avez-vous des « textes sacrés » ?
Il existe ce que j’appelle le « texte fantôme » à l’intérieur de ce que j’écris. J’en suis parfois conscient, et parfois non : il pénètre alors le texte, s’y glisse presque inconsciemment. C’est le cas de Huckleberry Finn dans Sous le règne de Bone, par exemple : alors que j’en étais aux trois quarts, je me suis dit : « Qu’est-ce que j’ai là ? Un gosse sans foyer, accro à la drogue, traînant dehors, avec un Black plus vieux que lui, je me souviens d’avoir lu un truc similaire… ». Et puis j’ai pensé : pourquoi ne pas approfondir cela ? Il ne s’agissait pas de réinventer ce qui avait déjà été fait, mais plutôt de rendre hommage à Twain et Huckleberry Finn, en se disant : « Voilà ce que ça fait de prendre un gamin comme Huck et de le faire vivre aux États-Unis cent cinquante ans plus tard. »
Et tandis que j’écrivais Lointain souvenir de la peau, à peu près aux trois quarts, j’ai réalisé que le texte fantôme qui s’insinuait dans mon livre était L’île au trésor de Robert Louis Stevenson. Je me suis dit : « Ah oui, c’est vrai, il y a ce jeune garçon là-dedans qui est innocent, mais pas tout à fait – il est un peu trop intéressé pour être réellement innocent – et il y a ce vieux type qui est légèrement menaçant mais qui agit comme un mentor, un protecteur, un type un peu bizarre physiquement… » J’ai donc commencé à réaliser que le Kid et le Professeur dans Lointain souvenir de la peau étaient comme Long John Silver et Jim Hawkins dans le roman de Stevenson, se baladant à la recherche d’un trésor et fantasmant à son sujet. Je me suis dit alors que je pouvais approfondir cette ressemblance. Après tout, c’est une paire ancienne : le vieux mentor un peu menaçant et le jeune homme qui n’est pas aussi innocent qu’il n’y paraît, ou pas aussi calculateur qu’il n’y paraît. C’est une vieille histoire, qui remonte à Homère.
Finalement, cela arrive tout le temps, inévitablement : on structure nos expériences sur les histoires dont on se souvient vaguement. Parfois, ce sont des histoires littéraires, parfois familiales, parfois elles viennent des films. On nous en raconte de tant de manières différentes…
[…]
Y a-t-il un texte fantôme dans La réserve ?
Oui, La réserve est assez librement fondé sur un roman d’Ernest Hemingway, sans doute le pire qu’il ait jamais écrit, mais très intéressant : En avoir ou pas, qui a été sa seule tentative d’écrire un roman qui se veuille politique. Il a été poussé à l’écrire par John Dos Passos et d’autres écrivains et critiques qui lui reprochaient, dans les années 1930, de ne jamais écrire sur la classe ouvrière. Alors il s’y est mis, ce qui lui était impossible, évidemment. Mais cette tentative m’a toujours beaucoup touché. En fait, presque tous les écrivains de cette époque me touchent. Les écrivains américains de gauche en particulier, qui écrivent au sujet de la classe ouvrière alors qu’eux-mêmes appartiennent souvent à la classe aisée, qui constitue à la fois leur lectorat et leur vie sociale. Hemingway et beaucoup d’écrivains de gauche, dans les années 1930, étaient membres de la « Café Society ». Ils appartenaient à la bourgeoisie, mais écrivaient sur la classe ouvrière, et cela s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui.
Je pourrais me considérer moi-même comme l’une de ces personnes. Je prends la classe ouvrière comme sujet alors que je n’en fais pas partie, de toute évidence. J’en viens, originellement, mais je n’en fais plus partie depuis mes vingt-deux, vingt-trois ans. Et pensez à des écrivains américains comme E. L. Doctorow, Raymond Carver, Grace Paley, Richard Ford ou Jim Harrison, des écrivains dont on croit qu’ils appartiennent à la classe ouvrière mais qui n’en font pas partie et n’en ont peut-être jamais fait partie ! C’est touchant, d’une certaine façon, d’être perçu ainsi. Cela correspond à ce fantasme que, lorsqu’on est un artiste, on peut traverser les classes sans appartenir à aucune. La réserve est une tentative de questionner ce rêve : Jordan Groves est inspiré de Rockwell Kent, un peintre très connu dans les années 1930, qui était d’une gauche radicale, communiste, mais aussi un homme très riche. Il appartenait à ce qu’on appelle aujourd’hui la « gauche caviar » : des socialistes qui ont plein d’argent. Cela m’intrigue.
[…]
À propos de Pourfendeur de nuages, John Brown est un personnage controversé. Avez-vous été accusé d’essayer de susciter la compassion du lecteur à son égard en adoptant le point de vue de son fils ?
Oui, certaines personnes, qui le considèrent comme un terroriste et un cinglé, me l’ont reproché. Beaucoup d’Américains blancs surtout le perçoivent ainsi. Les Afro-Américains le considèrent, eux, presque universellement, comme un héros de premier plan, parmi les grands héros blancs, comme Abraham Lincoln. Tandis que les Américains blancs sont plus divisés à son sujet. Sauf à l’extrême droite et à l’extrême gauche. Mais ce qui est intéressant, c’est que personne ne s’oppose sur les faits. La vie de Brown et ses actions publiques nous sont connues depuis 1859, quand il a été exécuté après son attaque de Harper’s Ferry. Il n’y a jamais eu aucune confusion au sujet des faits. Néanmoins, nous avons des interprétations complètement différentes de ces faits, qui dépendent de la race et de l’orientation politique. C’est pourquoi certaines personnes ont, à l’occasion, critiqué le portrait que j’ai fait de lui. Mais cela vient presque uniquement de ce que mon personnage contredit l’image qu’un certain nombre de personnes se sont faite de lui. Un nombre très limité de gens, en réalité, dont je me fiche complètement. Quand je demandais s’ils avaient lu le livre, ils me répondaient que non, et qu’ils n’allaient pas lire un livre consacré à un terroriste, à un type qui a tué des gens ! Alors il faut laisser tomber. On n’a rien à se dire.
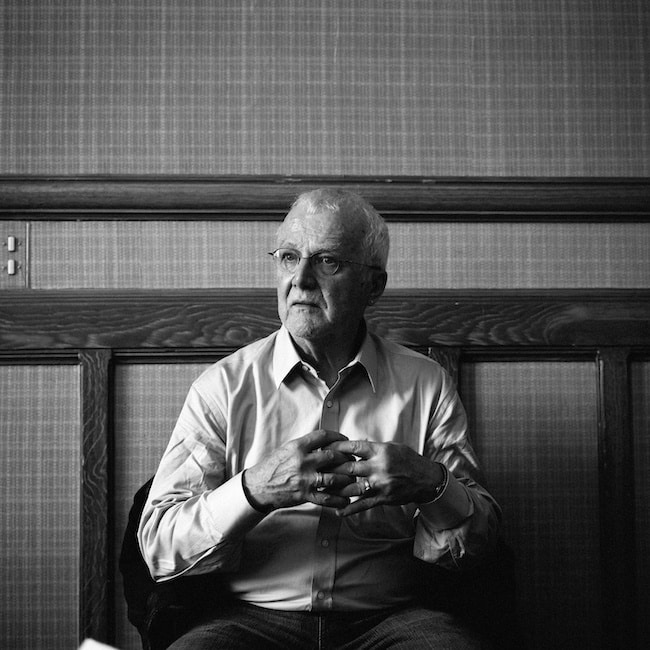
Russell Banks © Jean-Luc Bertini
J’ai eu à faire face à la même réaction avec Lointain souvenir de la peau. Certaines personnes ont pensé que j’écrivais l’histoire d’un criminel, de quelqu’un dont on ne devrait pas faire un portrait un tant soit peu sympathique, et que je m’en prenais aux victimes. J’ai fait une émission de radio à San Francisco, au moment de la sortie du roman aux États-Unis, et quelques personnes qui avaient, enfants, été victimes d’abus sexuels ont appelé, elles étaient très en colère contre moi du fait que j’avais écrit sur un délinquant sexuel en essayant de le comprendre, en faisant preuve d’empathie. Mais, même s’il a été condamné en tant que délinquant sexuel, le personnage n’est pas pédophile. Alors je leur ai demandé s’ils avaient lu le livre, et ils m’ont répondu que non, et qu’ils ne le liraient pas. Quand on en arrive à ça, on ne peut pas vraiment tenir compte de la critique.
Écrire Pourfendeur de nuages, était-ce une façon de rendre justice à John Brown ?
Non, pas vraiment. C’était plus l’occasion d’écrire sur quelqu’un qui s’est tenu à la croisée de la religion, de la violence et de la question de la race, dans l’histoire et l’imaginaire américains. La violence, théorisée, justifiée par la religion, et le conflit racial étaient déjà là, bien avant le 11-Septembre, bien avant qu’on ne parle de terrorisme d’une façon si complexe. Les gens commençaient seulement à y réfléchir alors. Ils n’avaient qu’une vague idée de ce qu’était le terrorisme. Il m’a semblé que c’était là l’occasion d’entrer au cœur du problème, et de le faire en prenant pour sujet quelqu’un qui est perçu par une moitié de la population comme un héros, et par l’autre comme un représentant du Mal, bien que nous soyons tous d’accord sur les faits. John Brown suscite donc des questions politiques, sociales et religieuses, que je voulais traiter.
Pensez-vous que la violence, dans la société, puisse non seulement expliquer, mais surtout justifier l’activisme politique ?
Non. Il y a là une ligne que j’ai refusé de franchir il y a longtemps, dans les années 1960, même si j’ai marché jusqu’à cette ligne avec beaucoup de personnes qui l’ont franchie.
Pour entrer chez les Weathermen ?
Oui, et je ne l’ai pas fait. Je me suis arrêté à cette ligne. Pas par conviction politique, mais par éthique personnelle.
C’est la raison pour laquelle vos personnages, comme Hannah Musgrave dans American Darling, ne sont pas de vrais extrémistes terroristes ?
Je ne crois pas que ma position personnelle sur ces sujets – la violence, la politique, la religion – soit d’un quelconque intérêt. Mes personnages ont leur propre point de vue, leurs propres problèmes. J’essaie de ne pas faire de confusion. Ce ne sont pas des rats de laboratoire qui me permettraient d’expérimenter mes propres idées par le biais de la fiction, de personnages et d’intrigues inventés… Je raconte des histoires qui m’intéressent pour elles-mêmes. Si elles touchent les lecteurs d’autres façons, c’est très bien, mais je n’écris pas pour tester des idées, des théories, des croyances.
[…]
Est-ce important pour un écrivain de faire la lumière sur un personnage pour révéler sa vraie nature ?
Je ne crois pas que ce soit un problème réservé aux écrivains, il concerne l’humanité, nous tous. Que sait-on vraiment de la personne avec laquelle on couche ? de son propre enfant, de ses parents ? de son ami le plus proche ? Dans une certaine mesure, on ne connaît personne. Dans quelle mesure peut-on être connu des autres ? On est confronté à ce mur toute notre vie. On ne veut pas admettre qu’il est là, et on aime jouer à tout un tas de jeux avec soi-même et avec les autres qui nous laissent croire qu’on connaît bien quelqu’un, ou que ce quelqu’un nous connaît bien, mais on sait au fond que ce n’est pas vrai. Que nous ne pouvons nous connaître réellement. C’est une chose difficile à accepter. En particulier quand on tombe amoureux, qu’on partage une intimité, ou avec sa famille, ses amis proches.
C’est difficile à accepter parce que le corollaire, c’est une sorte de solitude dont nous ne voulons pas. Nous mourons seuls. Nous naissons seuls, et nous mourons seuls, et ce n’est pas quelque chose de spécifique à l’écrivain, nous sommes tous confrontés à cela. Je peux finir par le mettre dans un roman, parce que j’essaie de décrire la réalité humaine de la façon la plus précise et exacte possible, mais la plupart des gens vivent sans vraiment y penser. Ils en font l’expérience néanmoins. Nous en faisons tous l’expérience, c’est inévitable. Ma mère est décédée l’année dernière, à quatre-vingt-seize ans, je lui ai tenu la main au moment où elle quittait cette planète, mais elle était seule néanmoins. Elle le savait aussi bien que moi, qu’elle était seule à ce moment-là, on ne peut pas y échapper. Voilà, c’est tout ce qu’il y a à en dire.
Propos recueillis à Vincennes le 23 septembre 2012 par Joachim Arthuys, Sébastien Omont et Cyprien Zitoun.












