À une remarquable cadence, les éditions de L’Olivier poursuivent la publication des œuvres complètes de Roberto Bolaño en français, cette fois-ci avec un volume entièrement occupé par Les détectives sauvages, paru en 1998 et traduit par Robert Amutio en 2006. Pour Florence Olivier, spécialiste de l’œuvre et autrice de Sous le roman la poésie. Le défi de Roberto Bolaño (Hermann, 2016), la première longue narration de l’écrivain chilien disparu en 2003 forme une ironique chanson de geste contemporaine, un roman d’aventures qui retrace une histoire générationnelle si chère et si inoubliable qu’elle ne pouvait être écrite que sous la forme d’un mythe.
Roberto Bolaño, Les détectives sauvages. Œuvres complètes. Volume 5. Trad. de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio. L’Olivier, 768 p., 25 €
Magnanime, Roberto Bolaño saluait naguère l’inépuisable charge explosive que recèlent certains romans brefs de ses aînés latino-américains du Boom, qu’il suffirait de relire pour éprouver la force renouvelée de leur détonation. Sur la survie, la mort ou la métempsychose des auteurs du « canon occidental » du XXe siècle, et de quelques autres, l’écrivain prêtait ailleurs de canularesques prophéties à une poète vagabonde et visionnaire. Et voilà donc James Joyce réincarné dans un enfant chinois en 2124, Giorgio Bassani sortant de sa tombe en 2167, André Breton ressurgissant des miroirs en 2071, Tchekhov se réincarnant en 2003, puis en 2010, puis en 2014 avant de réapparaître une dernière fois en 2081. Rythmique, la liste est longue et on la relira, pris d’un fou rire teinté de jaune, dans Amuleto. Né d’un chapitre des Détectives sauvages, ce bref et souverain roman se trouve dans le tome I des Œuvres complètes de Bolaño en français.

Film consacré à Roberto Bolaño © CC/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Le 4 novembre dernier, la parution du tome V, soit des Détectives sauvages, illustrait à point nommé et l’inusable force explosive de ce titre majeur et la prédisposition de ce roman à une forme de métempsychose. Car, tout juste la veille, hasard miraculeux ou non, La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr, qui doit son titre et son épigraphe aux Détectives sauvages, venait de remporter le prix Goncourt. L’écrivain sénégalais, tout aussi généreux – et aussi drôlement féroce – que Bolaño, ne fait pas mystère de son admiration pour l’œuvre du Chilien. Son roman réussit ce tour de force ou ce coup de génie qu’est l’originalité dans l’appropriation d’une poétique, créant ainsi l’un de ces lignages idéaux, translinguistiques, transcontinentaux, dans lesquels Bolaño aurait rêvé, n’en doutons pas une seconde, de se voir inscrit. L’histoire, bien réelle, est indéniablement bolañesque. Applaudissons-la car, justicière à sa façon, elle dément superbement la péroraison du père Urrutia Lacroix dans Nocturne du Chili. Rappelez-vous : « C’est ainsi que se fait la littérature au Chili, c’est ainsi que se fait la grande littérature d’Occident », clame l’ecclésiastique, poète et critique, justifiant la veule complaisance des écrivains envers le pouvoir de la junte militaire. À quoi son fantomatique accusateur, ce « jeune homme aux cheveux blancs » et alter ego de l’auteur, répond « en articulant un non inaudible ». « Non », redisent avec force Les détectives sauvages et La plus secrète mémoire des hommes, la littérature se fait hors des sentiers battus, loin de tout pouvoir ; la « grande littérature d’Occident », foutaise ! Un Chilien l’écrit en Espagne, un Sénégalais, en France.
Mais revenons à l’explosion initiale des Détectives sauvages, premier vaste roman de Bolaño, publié en 1998 aux éditions Anagrama à Barcelone. Deux ans plus tôt, avaient paru les plus brefs et non moins remarquables La littérature nazie en Amérique et Étoile distante, « frères siamois » au dire de l’auteur car le second est né d’un chapitre du premier. Avec Les détectives sauvages, qui, cette même année, remporte deux des prix littéraires les plus prestigieux du monde hispanophone, le prix Herralde de novela en Espagne, le prix Rómulo Gallegos au Venezuela, commence la véritable course mondiale de l’œuvre du Chilien, au rythme des traductions du roman dans nombre de langues. L’effet de cette enthousiaste réception devait culminer avec la publication des Détectives sauvages aux États-Unis, où l’auteur se voit mythifié en héritier direct de la Beat Generation.
Pourquoi pas ? Mais aussi, pourquoi donc, ou pourquoi seulement ? C’est le propre des œuvres magistrales que d’éveiller les tentations d’appropriations hâtives. Bolaño, pour sa part, déclarait lors de la réception du prix Rómulo Gallegos qu’en quelque sorte tout ce qu’il avait écrit jusque-là était une lettre d’amour ou d’adieu à sa propre génération. Et voici l’une des lectures possibles du roman, qui, n’oubliant pas la fidélité promise à la mémoire des jeunes tombés lors des « guerres fleuries » latino-américaines des années 1960 et 1970, chante la vie plus que la mort et, plus que les ossements des défunts, les combats dérisoires et magnifiques des vivants. Possédé par le jeune poète infra-réaliste qu’il était dans le Mexique du début des années 1970, le romancier Bolaño y exorcise la mort de l’utopie politique et le péril de la naïveté lyrique par la transmutation en roman de l’utopie poétique. De fait, on peut lire Les détectives sauvages comme l’autofiction collective d’un groupe de poètes avant-gardistes et, si l’on y tient, comme une « Légende de Duluoz » à la Kerouac, où Duluoz aurait renoncé à prendre la parole, la laissant à ses compagnons d’aventures. La différence n’est pas mince.
Car, pour dire l’histoire sur vingt années, de 1975 à 1996, des réal-viscéralistes – version fictive des infra-réalistes –, les deux parties du journal intime d’un poète prodige font le grand écart, embrassant les témoignages qui se pressent et tourbillonnent dans la longue partie centrale du roman. Heureux ou fanfaron, Bolaño, encore lui, comparait aux courants du Mississippi l’abondance de voix des Détectives sauvages, assurant que son roman comportait autant de lectures que de voix, qu’il pouvait se lire « comme une agonie » ou « comme un jeu ». Il suffit d’entrer dans le roman, ou dans le jeu, pour se laisser porter par ses courants fantasques ou pour apprendre ses règles tacites afin de (s’y) perdre avec bonheur.
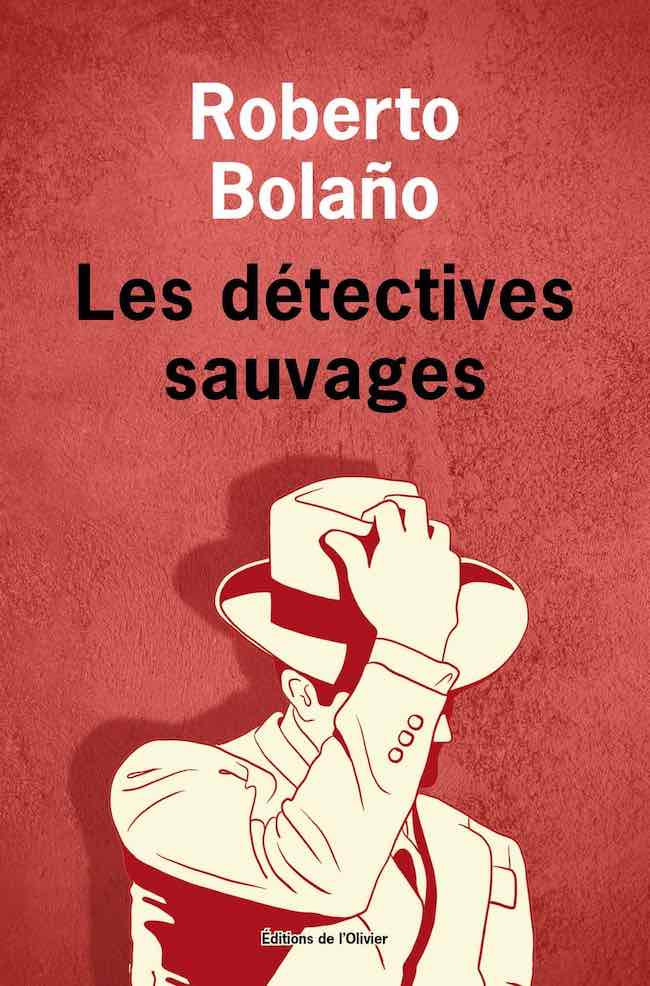
Entrons-y donc innocemment par le début. Juan García Madero, puceau et poète en herbe, sèche ses cours de droit pour assister à un atelier littéraire bientôt troublé par l’irruption d’Arturo Belano et Ulises Lima. Fondateurs du réal-viscéralisme, les deux trublions adoubent sans façon le nouveau venu. L’élasticité elliptique du journal intime rythme le récit de la vertigineuse et drôlissime initiation sexuelle et littéraire du novice réal-viscéraliste : l’ingénu libertin, nouveau Casanova malgré lui, tient à jour les comptes de ses orgasmes et de ses poèmes, choisit avec une infaillible ponctualité l’aventure et les risques du métier. Péripatéticiens, les membres du groupe s’adonnent à la flânerie nocturne ; les rues, les chambres de bonne, les cantinas et les cafés leur tiennent lieu de salon. Ils y improvisent d’espiègles ou d’érudites lectures de poèmes, de bouffonnes versions de la tradition poétique, des prescriptions bibliographiques, y écrivent parfois. Leurs bibliothèques portatives et collectives sont faites de livres volés à la « Librairie Française » ou négociés chez les bouquinistes du centre-ville. Discourir et courir les chemins, faire de la déambulation l’envers ou l’endroit de la parole, voilà bien cette vie poétique à l’intempérie que prescrit ailleurs l’essayiste Bolaño aux poètes trop choyés par l’État. Fièrement marginaux, les réal-viscéralistes inventent un nouvel ordre amoureux, financent leurs revues par la vente de marijuana, prétendent révolutionner la poésie afin d’échapper au double et infâme écueil de la poésie engagée à la Neruda ou de la poésie immaculée à la Octavio Paz.
Roman de Bolaño oblige, leur paradoxale quête d’une origine poétique avant-gardiste joue d’une borgésienne uchronie littéraire et se transmue en récit d’enquête et d’aventure. Car si les réal-viscéralistes s’inspirent des dadaïstes et des surréalistes européens ou des stridentistes mexicains, s’ils traduisent leurs contemporains français du Manifeste électrique aux paupières de jupe, leur modèle se doit d’être plus radical. Rien de moins que le réalisme viscéral des années 1920, branche fictive du stridentisme fondée par la non moins fictive Cesárea Tinajero. Bientôt, Belano, Lima et García Madero partent à la recherche de la poète disparue dans les déserts du Sonora, relevant le défi que lançait Breton dans « Lâchez tout ». Le Nord du Mexique devient terre d’aventure ou vortex, à la façon du Sud borgésien ou du blanc territoire austral de Poe. Dans cet espace déserté par la culture pourrait bien se trouver la poésie en acte ou le « nouveau », que « Le voyage » de Baudelaire entrevoit au fond de l’abîme, au bout du chemin, ou de la vie. L’aventure quichottesque des jeunes poètes vaut pour sa gratuité même. Elle allie les motifs du risque et du danger à l’installation d’une virtualité avant-gardiste dans l’histoire littéraire, mais surtout elle narre – et ne discourt pas sur – l’équivalence entre art et vie, poésie et voyage, poésie et révolution. Or, par un habile suspense, elle n’est racontée par García Madero, sur le mode du roman noir, de la road novel et de l’enquête littéraire, que dans la troisième partie du roman.
Entre les deux pans du journal intime du jeune homme, est décantée l’histoire du groupe réal-viscéraliste, tôt disparu après la dispersion de ses membres fondateurs. Les voix, joviales et désolées, stoïques, sublimes ou ridicules, d’une prodigieuse variété de personnages rapportent de biais ce qu’il advint d’Arturo Belano et d’Ulises Lima entre 1976 et 1996. À toi, lectrice, lecteur, de te perdre à la suite des détectives sauvages entre l’Europe, Israël et l’Afrique ; à toi de t’orienter dans ce dédale de témoignages, pique-toi au jeu et apprends. Par exemple, de ces envois lyriques, qui ponctuent tel ou tel monologue d’un vieux stridentiste devenu écrivain public : « Ce qui revient à dire, jeunes gens, je leur ai dit, que je voyais les efforts et les rêves, tous confondus dans le même échec, et que cet échec s’appelait joie. » Par exemple, de ces hauts faits satiriques qui prennent au piège de leur propre parole des éditeurs en faillite, critiques renommés, professeurs latino-américains, poètes de divers alois, romanciers à succès, révélant leur lâcheté, leur manque de foi dans le métier littéraire, leur vénalité ou leur générosité résignée. Mais apprends aussi de la lecture que font Ulises Lima et Arturo Belano d’un poème visuel de Cesárea Tinajero. Il suffit d’en compléter les traits pour qu’il s’anime. Tu tiens peut-être là ton fil d’Ariane. Car, au-delà d’une maquette à monter ou d’une marelle à la Cortázar, qui invitent à une active lecture, le puzzle des Détectives sauvages invite, plus encore qu’à le compléter, à poursuivre sa lettre. Porté par le désir de l’écriture, il l’insuffle.
Le roman s’achève sur cette dernière devinette, suivie du contour en pointillé d’un rectangle blanc : « Qu’est-ce qu’il y a derrière la fenêtre ? »

Qu’attends-tu ?












