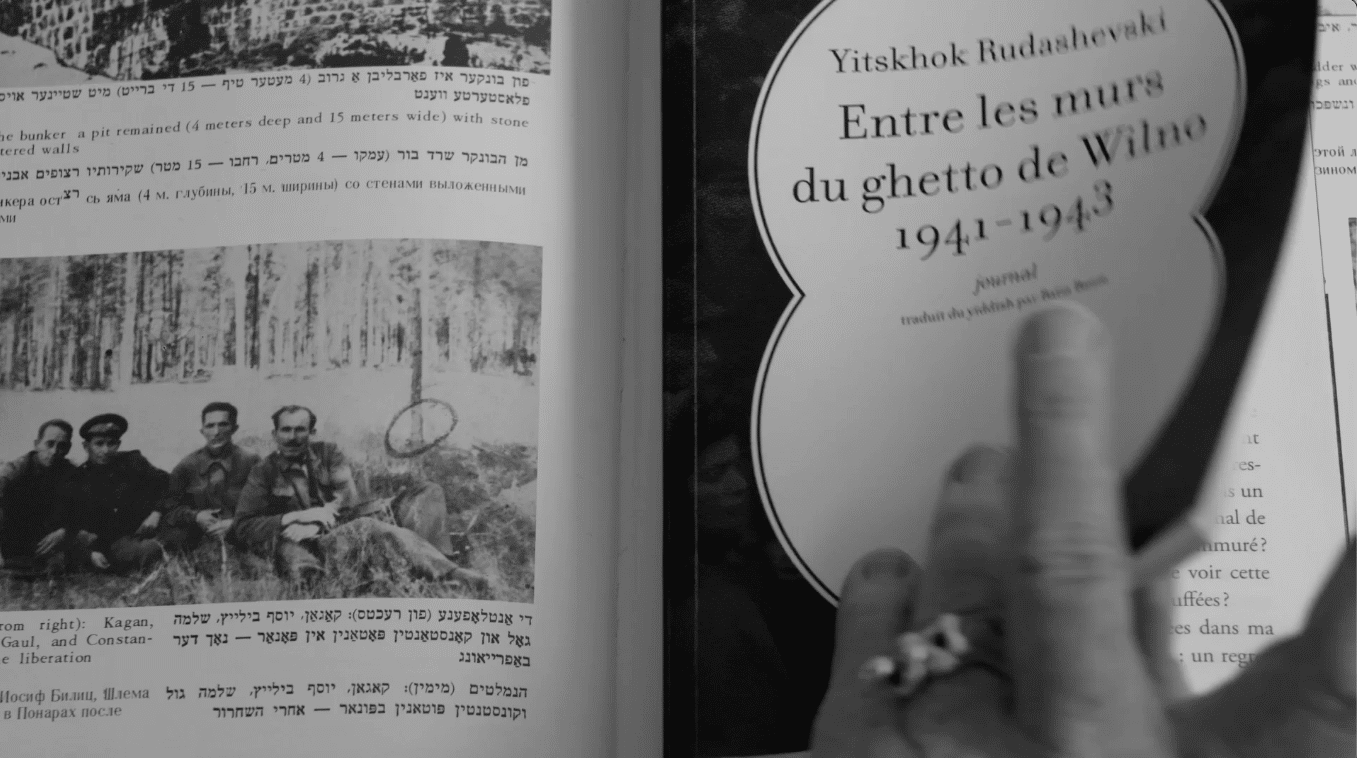Et si, plutôt que de nous extasier du fond de nos canapés sur les séries télé et d’en faire des sujets de philosophie profonds par leur superficialité même, nous revenions aux classiques ? À qui fera-t-on croire qu’il y autant de philosophie dans Friends, Game of Thrones ou Mad Men que dans Wittgenstein ? Mais on sera d’accord pour dire avec les livres de Robert Pippin et de Marc Cerisuelo qu’il y en a presque autant dans les comédies et les westerns hollywoodiens que dans Kant et Hegel.
Robert Pippin, Philosophie politique du Western. Les ambiguïtés du mythe américain. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Mackert et Olivier Tinland. Cerf, 256 p., 24 €
Marc Cerisuelo, Comédie(s) américaine(s). D’Ernst Lubitsch à Blake Edwards. Capricci, 260 p., 25 €
Robert Pippin est un hégélien : il pense que la philosophie a pour tâche de comprendre l’accomplissement de l’Idée dans les formes de l’histoire, de l’art et de la culture. C’est ainsi qu’il s’est consacré, outre à des commentaires sur l’idéalisme allemand, à des analyses sur la littérature (Henry James and Modern Moral Life, Cambridge University Press, 2001), sur le film noir (Fatalism in American Film Noir, University of Virginia Press, 2012), sur Hitchcock (University of Chicago Press, 2017) ou encore sur le western avec ce livre traduit en français cette année. Ces essais sont parmi les plus les originaux et les plus riches de ce qu’on a pu produire en matière de philosophie du cinéma.

John Wayne et James Stewart dans « The Man Who Shot Liberty Valance » de John Ford (1962) © D.R.
Quand on fait de la philosophie du cinéma, il ne suffit pas de plaquer sur les films des concepts philosophiques, comme on a pu le faire pour Rohmer, ou de dire, comme Deleuze, que le cinéma est par lui-même une forme de philosophie. Il faut aussi associer tous les aspects du scénario et de l’écriture cinématographique à une lecture qui use des thèmes et concepts philosophiques. Pippin trouve l’équilibre de tous ces éléments en analysant trois grands westerns : L’homme qui tua Liberty Valance (1962) et La prisonnière du désert (1956) de John Ford, ainsi que La rivière rouge de Howard Hawks (1948). Sa lecture repose sur l’idée qu’ils proposent tous une forme de psychologie politique : « Comment ce type de caractère peut-il conduire à une association politique ? » C’était plus ou moins la question classique de Machiavel, Hobbes, Rousseau et Hegel. Les formes artistiques, mais surtout les romans et le théâtre, expriment la réalité politique et la manière dont les humains la vivent. Les westerns ne font pas exception. On les lit souvent sur le mode rousseauiste ou hobbesien : comment passer de la nature à la civilisation ? Mais Pippin y voit d’autres messages. Il voit Red River comme une fable de l’autorité (qui va gouverner, qui en a le droit), La prisonnière du désert comme une histoire mettant en scène la conscience de soi des personnages et la compréhension de leurs actions.
Tenons-nous-en à The Man Who Shot Liberty Valance, le plus légendaire parmi les westerns légendaires. Tout le monde en connaît l’histoire. Pippin insiste sur la parabole politique du film : l’ordre ancien et sauvage de l’Ouest fait place à une société dans laquelle il n’y a plus de place pour des Liberty Valance ou des Tom Doniphon (le méchant paradigmatique et le bon paradigmatique étant renvoyés dos à dos). L’imposture sur laquelle Stoddard a bâti sa carrière politique et même sa vie personnelle en épousant Hallie n’a pas d’importance au regard du résultat, qui est la modernisation de la société et l’avancée du progrès. Son culte de la vérité, tout comme celui du journaliste Peabody, est peu de chose face à la légende dont a besoin la vie politique (« When the legend becomes fact, print the legend »). En ce sens, who cares who shot Liberty Valance ? du moment que Stoddard va au Congrès. Ces thèmes sont indéniablement ceux du film, et les personnages sont les reflets individuels d’une psychologie politique qui les dépasse. La leçon hégélienne est explicite : les actions humaines individuelles, qu’elles soient des actions authentiques ou des impostures, échappent aux hommes, et ils sont victimes de la ruse de la raison.
Tout en accordant à Pippin sa lecture, on peut se demander si l’on ne peut pas lire le film dans un sens plus kantien qu’hégélien, comme relevant de la moralité subjective plutôt que de la moralité objective. La question de l’identification de l’agent de la mort de Valance est en ce sens cruciale, comme les questions d’imputabilité et de responsabilité et le drame personnel vécu par les personnages. On peut aussi lire le film comme portant sur les limites de l’action : on vise un certain résultat intentionnellement, mais ce qui se produit est différent, et les conséquences nous échappent en grande partie [1]. Stoddard ne manque pas de courage. Il est prêt à affronter Valance même s’il n’a pas l’intention de le tuer, et même si, quand on lui dit qu’il l’a tué, il repousse son acte au point de ne pas vouloir se présenter comme candidat à la Convention. Mais il n’en est pas moins un imposteur si l’on considère sa réputation et l’amour que Hallie lui porte. Il gagne sur toute la ligne, non sans mérite, mais en ne méritant pas ce qu’il obtient. Doniphon, au contraire perd sur toute la ligne : l’amour de Hallie, son honneur et la reconnaissance de ses concitoyens (il est un inconnu quand on l’enterre). Dans la scène du steak, où Stoddard se fait ridiculiser par Valance, le premier déclare à Doniphon : « Je ne laisse à personne le soin de livrer mes combats », mais c’est finalement ce qui arrive à son insu : il n’a pas fait le boulot lui-même.

Pippin, s’il avait lu un peu plus Russell que Hegel, n’aurait pas manqué de rapporter toute l’histoire au titre, L’homme qui tua Liberty Valance. Tout lecteur de On denoting [2] sait que les descriptions définies de la forme « Le F » sont analysables ainsi : « Il y a un individu et un seul qui a telle propriété » (ici, avoir tué Liberty Valance). L’histoire pourtant identifie deux hommes qui ont tué Liberty Valance, le vrai, Doniphon, et le faux, Stoddard, si bien que la description est fausse, elle n’a pas de référence. Mais la théorie des descriptions de Russell nous permet de rétablir la vérité : la description « L’homme qui a tué Liberty Valance » désigne aussi celui qui, en réalité, a tué Liberty Valance, et non pas l’homme, quel qu’il soit, qui a tué Liberty Valance. C’est la rumeur, la fausseté véhiculée par la société, et non la réalité, qui choisit le référent, mais le référent réel reste là, dans la gloire qu’un autre a usurpée. On peut y voir la victoire de l’Esprit Objectif, mais je suis pour ma part bien plus sensible à la morale qui se dégage de l’histoire : on n’obtient jamais les fruits de son travail et de sa peine, qui sont recueillis par d’autres, et l’ingratitude est la seule récompense, mais on n’est pas pour autant simplement victime de la ruse de la raison (ou le jouet de la providence ou du destin), car ce qui vous arrive est aussi en grande partie votre faute.
La comédie exprime tout autant la réalité sociale que le western, plus clairement encore (ce n’est pas un hasard si Hawks est passé souvent de l’un à l’autre). Marc Cerisuelo divise l’histoire de la comédie américaine en quatre périodes : l’invention du genre chez Cecil B. DeMille et Chaplin (The Woman of Paris), son affirmation chez le premier Lubitsch puis dans les comédies dites de remariage, la maturité chez le second Lubitsch, Sturges et Wilder, puis la « seconde comédie », à partir des années 1940, qui devient plus satirique et grinçante, avec la maturité de Wilder, Minnelli et Sturges, puis Blake Edwards, où la comédie se mêle de musicals.
Cerisuelo a une connaissance encyclopédique du genre, et son livre risque bien de devenir à ce dernier ce que L’écran démoniaque de Lotte Eisner (1952) fut à l’expressionnisme. Il commente dans le détail, avec l’humour requis par son sujet et une science filmique hors pair, les variations dont les Bringing up Baby, His Girl Friday, The Awful Truth, Sullivan’s Travels, Ninotchka, Gentlemen Prefer Blondes et The Party sont les paradigmes, et nous fait découvrir l’ampleur du genre et ses recoins. On ne lui reprochera pas de ne pas trop s’attarder sur les Marx, Mae West ou W. C. Fields, dont les metteurs en scène se bornent à lâcher la bride à ces fauves comiques, et de préférer les plus subtils Capra et surtout Sturges (auquel Cerisuelo a consacré un livre magistral, Preston Sturges ou le génie de l’Amérique, PUF, 2002).

Rosalind Russell et Cary Grant dans « His Girl Friday » de Howard Hawks (1940) © D.R.
À la différence de Pippin, Cerisuelo ne cherche pas à tirer des leçons philosophiques profondes de l’art hollywoodien de la comédie. What’s the big idea ? demande quelque part Jean Arthur, et il semble qu’il n’y ait pas de big idea, à part le fait que les héros de ces films ont envie d’être heureux, que leurs mésaventures nous apprennent « à repérer un mensonge, une fausse promesse, une mauvaise excuse, ou au contraire un cœur simple et une sincérité vraie par-delà même le conformisme social le plus borné ou la mondanité la plus affichée ». On peut, comme l’a fait Stanley Cavell dans son livre sur les comédies de remariage (1981), y voir l’apothéose du banal, sur fond de crise sceptique. On a, je trouve, un peu trop tiré sur cette ficelle.
Deux des remarques de Cerisuelo me paraissent aller plus loin que les appels éculés à l’ordinaire, qu’on peut en effet réitérer à l’envi avec les séries télé et toutes les formes d’art populaire. La première est qu’il y a quelque chose de cruel dans ce théâtre hollywoodien si léger : on s’en tire, mais au détriment d’autrui, en se débarrassant du rival. Le rire se produit au prix de l’humiliation et de l’intimidation. C’est la vieille théorie du rire comme expression de la supériorité. La seconde remarque est que ces comédies sont souvent atmosphériques, surtout dans les extraordinaires réparties de Katharine Hepburn à Cary Grant, comme dans Philadelphia Story (1940), où l’on comprend un trait seulement quelques secondes, voire quelques minutes, plus tard. Il y a là, comme le dit Cerisuelo, du stendhalisme, et du SFCDT (se foutre carrément de tout), qu’on retrouvera plus tard chez les héritiers contemporains du genre : les frères Coen et Wes Anderson, qui citent Lubitsch et Sturges.
Si j’étais hégélien comme Pippin, il me semble que je dirais aussi qu’il en va de ces comédies comme du théâtre de Marivaux commenté, comme on sait, par l’auteur de la Phénoménologie de l’esprit : ce sont des histoires d’apprentissage et de mise à l’épreuve, où l’on essaie de savoir qui est qui et qui on est soi-même [3]. Cerisuelo fait au début de son livre une remarque éclairante : pourquoi ce genre, si social, est-il en fait si abstrait ? Si le western est une géométrie dans l’espace, les comédies américaines sont un exercice de combinatoire : qui va séduire, cesser d’aimer, épouser, divorcer de, rivaliser avec, qui ? Mais cette question ne reçoit aucune réponse méthodique : elle se règle au contraire dans un joyeux désordre. Que l’on parle de la comédie « sophistiquée » à la Lubitsch, ou de la « screwball comedy » (délirante ou déjantée) où des personnages plus ou moins dingues se retrouvent dans des situations invraisemblables dont ils ne parviennent à se dépêtrer qu’in extremis, il est question du monde social, mais aussi d’autre chose, qu’on pourrait appeler, en suivant encore Kant plutôt que Hegel, le caractère formel et trans-catégorial du risible. L’abstraction des comédies hollywoodiennes et leur ressort est qu’elles mettent à l’épreuve les catégories du sens commun et notre capacité à juger : le rire nait du fait qu’à la fois tout est à sa place, mais pas tout à fait à sa place, et perd sa place (on pense ici à The Party). C’est, disait Kant, la recette du sublime, et il y a du sublime comique, comme il y en a du tragique.
-
Donald Davidson, Actions et événements, traduit par Pascal Engel (PUF, 1993).
-
Bertrand Russell, Écrits de logique philosophique, traduit par Jean-Michel Roy (PUF, 1989).
-
Voir Jacques D’Hondt, « Hegel et Marivaux », in De Hegel à Marx (PUF, 1972).