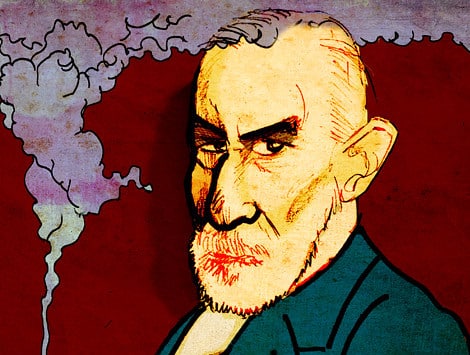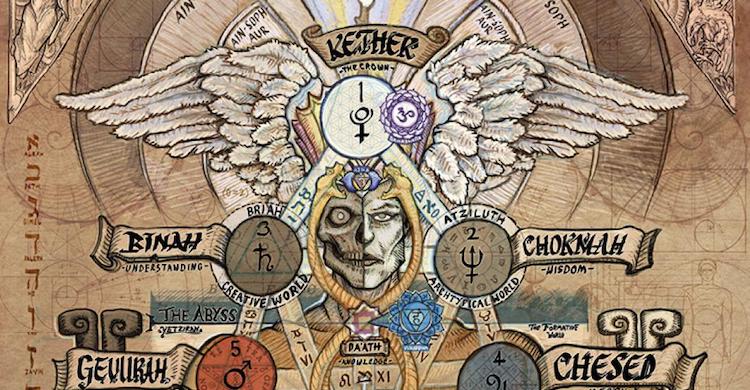Qu’est-ce qui a poussé Benoît Peeters, qui n’est pas psychanalyste, à écrire sur Sándor Ferenczi, au risque des psychanalystes ? En quelle langue d’écriture a-t-il écrit ce livre qui, dit-il, n’est « ni un traité savant, ni une véritable biographie… c’est l’histoire d’une amitié peut-être impossible et d’un amour qui ne le fut pas moins » ?
Benoît Peeters, Sándor Ferenczi. L’enfant terrible de la psychanalyse. Flammarion, 384 p., 23,90 €
D’emblée, Peeters situe son ouvrage du côté du roman « vrai », de l’histoire d’amour, et puisqu’il s’agit de psychanalyse, des affres de la relation de « transfert » entre deux hommes – Ferenczi et Freud – dont l’un fut le patient (mais aussi l’élève, l’ami et le collègue) de l’autre. Le livre, nous dit l’auteur, ne s’adresse pas aux psychanalystes, mais à un public plus large. Qui est ce public, comment va-t-il entendre cette histoire si complexe, indissociable des passions théoriques et cliniques qui ont animé ses protagonistes, c’est la question que peut se poser un psychanalyste à la lecture de ce livre. En cela, il est particulièrement difficile d’en faire une recension sans tomber dans une forme de « confusion des langues ». Tentons néanmoins !
Mais d’abord, qu’est-ce que cette confusion des langues ? C’est sur cette question que Peeters démarre son livre, avec la scène terrible du conflit avec Freud suscité par l’article, peut-être le plus connu de Ferenczi, écrit en 1932, « Confusion des langues entre les adultes et l’enfant ».
Sandor Ferenczi. L’enfant terrible de la psychanalyse apparaît d’abord comme un récit clinique : clinique non seulement de la relation entre Ferenczi et Freud, relation ambivalente, transférentielle, traversant toute la gamme des émois de l’amour et des déceptions infantiles et adolescentes ; mais aussi clinique de la naissance et de l’enfance de la psychanalyse, avec son extraordinaire créativité, ses réussites et ses déceptions, ses mélanges et ses confusions, ses drames, ses rivalités, ses tragédies. Un nouveau continent, celui de l’inconscient, s’offrait alors à l’exploration des pionniers sans qu’on pût encore lui donner forme, identifier ses dangers et ses écueils et proposer des règles sûres de navigation. Analyse et vie quotidienne se mêlaient alors, les frontières entre patient et ami ou collègue, analyste et amant, analyste et père (ou mère), n’étaient pas aussi tranchées qu’elles le sont devenues aujourd’hui.
Parmi ces explorateurs, Ferenczi fut l’une des figures les plus intrépides et attachantes, peut-être parce qu’il était le plus authentique d’entre eux, le plus sincère, à la fois dans son admiration sans bornes pour la découverte freudienne, son désir de la faire vivre, et dans sa rébellion face à la domination du « maître » tant aimé. Ainsi Ferenczi a-t-il été tout à la fois le « fils spirituel », le patient, le collègue, l’ami de Freud et leur correspondance (traduite par l’équipe de la revue Le Coq Héron , sous la direction de Judith Dupont), publiée assez tardivement, dans les années 90 (Peeters raconte l’histoire de cette publication à la fin du livre) est d’une richesse exceptionnelle. C’est elle, principalement, qui a servi de base documentaire à cet ouvrage qui raconte de façon captivante ce chapitre passionnant du « roman familial » de la psychanalyse.

Sándor Ferenczi
Commençons par un détail qui n’en est pas un, souligné par Peeters : toute sa vie, à quelques exceptions près, Ferenczi s’est adressé dans ses lettres à « M. Le Professeur » tandis que Freud lui répondait avec un « cher ami ». Pourquoi avoir maintenu coûte que coûte cette dissymétrie que Freud pourtant ne lui demandait pas ?
Dès le premier chapitre, le lecteur est convié à assister à une scène de rupture entre les deux psychanalystes. Le « roman » commence par la fin, et la suite se présente comme un long flashback : comment en est-on arrivé là ? Telle est la question à laquelle va tenter de répondre Peeters tout au long du livre. Son regard de non-analyste est en cela précieux, car on peut se dire que c’est sans a priori théorique qu’il va explorer l’histoire de ces deux hommes que le partage d’une passion, la psychanalyse, a pu parfois entraîner dans les plus grandes confusions, de rôles et de sentiments. Freud craint de répéter avec Ferenczi ce qui s’est passé avec Fliess, ce « rêve de complicité fusionnelle et de fraternité absolue, suivi d’une terrible déception ». Mais si tout cela a un air de déjà vu pour Freud, Ferenczi, lui, vit sa première passion.
Pour tenter de comprendre ce qui s’est passé entre les deux hommes dont le désaccord théorique semble recouvrir un enjeu plus profond pour l’un comme pour l’autre, Peeters reprend les choses du début en se centrant sur quelques épisodes clé de leur relation ; il accorde une grande place à ce qu’on a appelé l’« imbroglio » amoureux de Ferenczi, tiraillé dans un choix impossible entre sa maîtresse, Gizella Palos (qui porte le même prénom que sa sœur et que le premier amour adolescent de Freud), et la fille de celle-ci, Elma, qu’il a prise en analyse. Le triangle est en fait un carré, car Ferenczi entraîne Freud dans sa propre confusion, et, d’ailleurs, c’est clairement à lui que les tergiversations de Ferenczi s’adressent. « La confusion des rôles est à son comble », écrit Peeters, soulignant ainsi l’impact de cet épisode sur l’écriture de l’article « Confusion des langues entre les adultes et l’enfant ».
Impossible d’entrer ici dans la complexité des enjeux fondamentaux que soulève le texte de Ferenczi, qui théorise l’abus sexuel entre l’adulte et l’enfant comme une confusion entre le « langage de la tendresse » demandée par l’enfant et le « langage de la passion » de l’adulte abuseur. En apparence, si le texte de Ferenczi est insupportable pour Freud, c’est qu’il remettrait sur le devant de la scène la première « théorie de la séduction » selon laquelle l’hystérie serait causée par un abus sexuel précoce, scène de séduction externe que Freud s’était efforcé de ramener sur la scène interne du fantasme. Mais cette vision est beaucoup trop simpliste. Ce que va tenter de montrer Peeters, c’est que les sources de la réaction violente de Freud sont bien plus complexes. Freud comprend qu’il s’agit aussi de la scène analytique, et que derrière cet abuseur d’enfants il y a l’analyste, et que le reproche de Ferenczi lui est adressé.
À un autre niveau de lecture, Freud a peur pour l’œuvre de sa vie, pour la psychanalyse, il voit sans doute dans ce qui a lieu avec Ferenczi une répétition de ce qui s’est passé avec Jung : une mise à l’écart défensive du sexuel infantile et de sa force passionnelle, ici mise sur le compte de l’adulte agresseur. Pourtant, c’est un reproche qu’on peut difficilement faire à Ferenczi, à qui Freud écrivait en 1929 : « Votre essai, dans le nouveau Mouvement psychanalytique, m’a rappelé que vous êtes le premier et jusqu’à présent le seul qui sache expliquer pourquoi le petit homme veut coïter. Ce n’est pas une mince énigme ! » Mais, malgré la part de malentendu dans leur désaccord, les divergences sont néanmoins profondes et liées à des conceptions bien différentes de l’éthique analytique, ce que Peeters explique clairement.
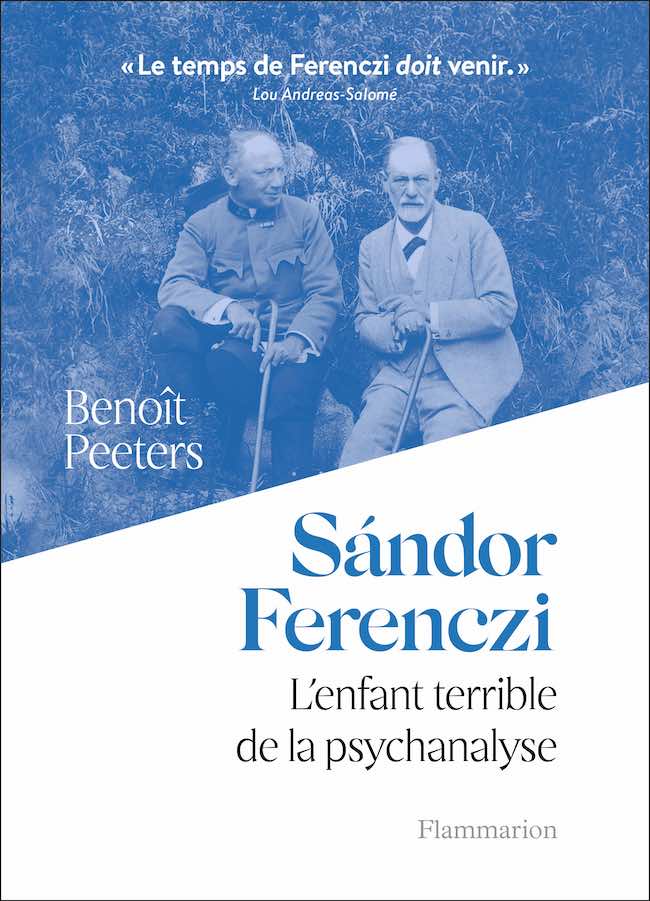
Deux Ferenczi apparaissent ainsi en lisant ce livre : d’un côté, Ferenczi « l’enfant » (terrible, blessé, dépendant mais aussi génial) dans son rapport à Freud, à Gizella, à Elma ; de l’autre, Ferenczi l’adulte dans son rapport à lui-même, son courage thérapeutique, son sens de la responsabilité à l’égard de ses patients, son investissement total dans le mouvement psychanalytique et son devenir. « Il y avait en Ferenczi, écrivait Kosztolányi cité par Peeters, une inquiétude perpétuelle, une sorte de curiosité enfantine, d’intérêt avide […] Il jouait à des jeux de société, il s’intéressait à la linguistique, au théâtre, aux boutades, aux ragots, à tout ce qui est humain. […] S’il était “spécialiste”, c’était de la vie qu’il l’était ».
Ferenczi l’adulte a (entre autres) joué un rôle important dans la création d’institutions psychanalytiques : il fonda en 1913 l’Association psychanalytique hongroise avec István Hollós (voir Le Coq Héron n° 100) et fut à l’origine de la création de l’Association psychanalytique internationale, dont il refusa pourtant la présidence à la fin de sa vie ; son apport à la réflexion sur la formation des analystes, fruit de son travail d’exploration du contre-transfert (qui a donné lieu à des expérimentations par la suite abandonnées comme « l’analyse mutuelle »), est également très important. Ferenczi est en effet celui qui le premier a formulé la « deuxième règle fondamentale » (la première étant celle de l’association libre), à savoir la nécessité pour les analystes d’avoir été eux-mêmes analysés.
Si l’apport théorique de Ferenczi a longtemps été négligé, il est aujourd’hui largement reconnu, même si l’étiquette d’ « enfant terrible de la psychanalyse » contribue malgré tout à le maintenir dans l’ombre de Freud « le père ». Mais lorsqu’on a affaire à un patient (adulte ou enfant) « difficile », c’est du côté de Ferenczi et de son Journal clinique que l’on se tourne, pour lui emprunter son oreille si sensible à l’infantile, aux motions les plus primitives de la psyché. Son approche de la technique analytique avec les adultes (« Analyse d’enfants avec des adultes ») a fait dire à Anna Freud qu’il employait les mêmes techniques avec ses patients que celles qu’elle utilisait avec les enfants. Cette approche de l’enfant dans l’adulte, on la retrouvera chez Winnicott, sans doute par le biais indirect de Melanie Klein (dont il a lui-même été « l’élève rebelle »), qui a été analysée par Ferenczi. Ce serait en revanche un contresens de rattacher à Ferenczi les courants intersubjectif et relationnel de la psychanalyse américaine qui rejettent la théorie freudienne des pulsions.
La naissance de la psychanalyse, comme toute naissance, est une énigme ; nous en cherchons toujours une « scène primitive », à jamais insatisfaisante et qui en cache toujours une autre. Celle de la relation entre Ferenczi et Freud est certainement énigmatique, et la lecture de ce livre ne peut qu’inciter le lecteur à « aller y voir » par lui-même dans cette correspondance foisonnante, à plonger à son tour dans l’intimité de leurs échanges.