Dans Voir de ses propres yeux, Hélène Giannecchini écrit depuis les confins du deuil ce qui s’apparente plus à un essai, voire une étude, qu’à un roman. À rebours de l’aveuglement collectif face à la mort qui va jusqu’au déni avec l’interdiction actuelle des rites funéraires, ce premier roman dit le désir d’être-là dans cet invisible qui se dérobe et se révèle par à-coups. Pour l’appréhender, l’autrice se crée un regard résolument autre, résolument sien, à l’image de son écriture qui conjugue « mourir » au présent. Avec une sobre intégrité, Hélène Giannecchini s’empare de l’insaisissable et écrit la mort comme peu osent le faire : sans discontinuer.
Hélène Giannecchini, Voir de ses propres yeux. Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 224 p., 19 €
Comme à l’orée de notre monde, Voir de ses propres yeux est vide de personnages, de visages, de noms. Les morts sont circonscrits par des pronoms – un « tu », des « vous » – qui les distinguent des vivants réduits eux-mêmes à des silhouettes ou des ombres : une « femme en vert », « la personne que j’aimais ». Ces présences absentes nous situent dans une altérité où voir ne consiste plus en un simple face-à-face. En s’adressant à « ses » morts, disparus coup sur coup, la narratrice se rend à l’évidence : « j’ai voulu voir et je sais maintenant qu’il faut vous chercher ailleurs ou autrement ».
Son deuil, loin d’être « sommation à l’oubli », se veut quête obsessionnelle, en aveugle, de ce que pourrait être l’après-eux de ces êtres adorés. Les chapitres de Voir de ses propres yeux égrènent une même carte du deuil et de la formation d’un regard. À Paris, Bâle, Lausanne, Rome, Florence, Naples, la narratrice erre solitaire parmi les vivants, dans l’attente que la vision opère. À défaut, sa recherche dans le vide s’appuie sur des livres, objets, images, touchant de près ou de loin à la mort. Les points d’ancrage de ce texte déployé en réseau sont des figures savantes ou artistiques, dont l’œuvre et parfois la vie sont évoquées : des anatomistes, du XVIe siècle comme André Vésale, du XVIIIe siècle avec Clemente Susini, la photographe contemporaine Sally Mann, les écrivains et penseurs Lispector, Barthes, Roubaud, Butler, Foucault…

Hélène Giannecchini © Astrid di Crollalanza
Cette étude de la mort s’apparente à une autopsie (du grec, « voir de ses propres yeux »). Y sont décrits des cadavres et leur envers, dessinés, sculptés, réels ou représentés, récents, anciens, connus, inconnus. Hélène Giannecchini rêve de la façon dont la mort décore les parois internes de nos corps d’une « matière de coquillages, des anfractuosités de roches marines ».
Carnets et images s’accumulent selon leurs résonances électives, car c’est dans la relation « que se loge ce que je veux dire ». Au fil de l’écriture et du hasard de ses recherches, une vision diffractée de la mort coagule, et cet objet intérieur s’accomplit au contact de supports extérieurs. À l’inverse d’une mémoire proustienne, involontaire, la narratrice effectue un détour conscient du côté d’une représentation des mains de Vésale pour que surgissent « les vôtres me touchant, tenant mon visage d’enfant ». Plus loin, elle « voit » l’instant de la mort de ses proches dans le saut affolé d’un cheval par-dessus la rambarde d’un pont parisien. Ce regard lui permet d’emplir le réel de ses morts, de leur donner corps en fondant leur « essence volatile » dans la « matière solide » d’un lieu, d’un paysage, d’un objet. Untel sera définitivement associé à « un escalier qui descend vers la mer ».
En pénétrant à l’intérieur de ces cadavres, on franchit le seuil d’une écriture des limites. Une tension étonnante se dégage de l’obstination concentrée avec laquelle Hélène Giannecchini ne lâche pas son sujet, pourtant si fuyant. Son écriture tient sur une lisière, là où « notre vie bat plus fort au contact de la vôtre arrêtée ». Depuis ce point de bascule, il est aisé de dévaler la pente d’un côté ou de l’autre. Dans la première moitié du texte, le monde est renversé, les morts sont comme vivants. L’écriture est dépouillée, la proximité de la mort confère justesse et capacité à dire l’essentiel : ainsi de la subtilité avec laquelle est évoquée la relation lesbienne de la narratrice, à travers un simple accord grammatical.
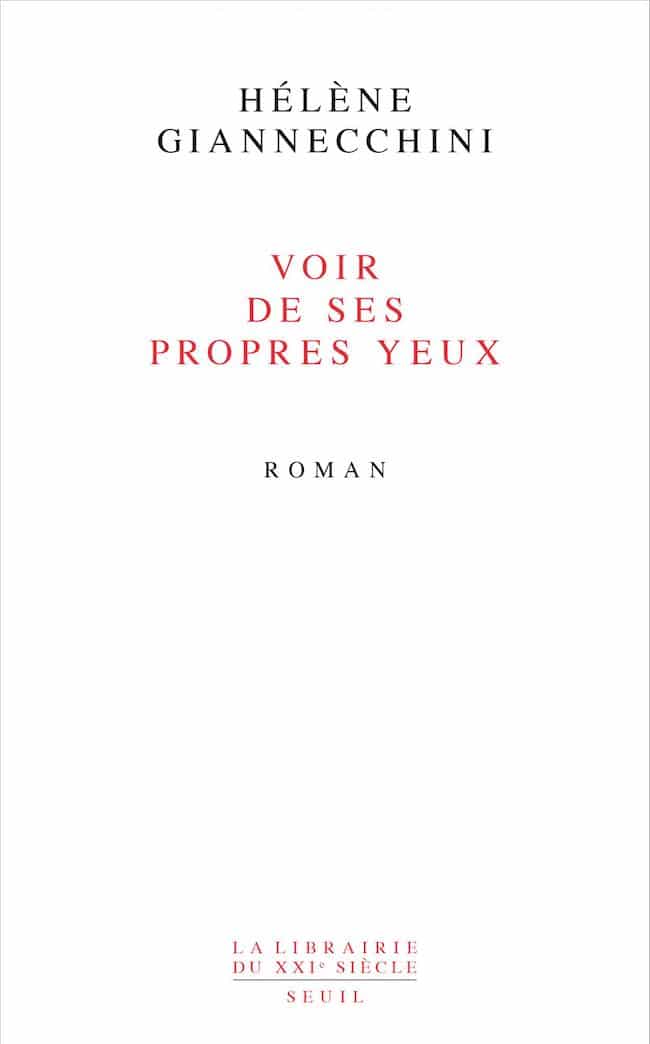
Mais cette voix propre s’érode dans la deuxième moitié du livre, où le monde extérieur qui avait été mis en suspens regagne du terrain. Des anecdotes – de l’histoire de la cire à celle de la découverte de l’Homme de Tollund –, des moments narratifs, autant de connexions artificielles, façon encyclopédie de la mort, affaiblissent l’écriture. Hélène Giannecchini est rattrapée au dernier moment par la nécessité d’inscrire son livre dans une lignée qui serait féministe. Son écriture s’efface alors derrière des discours plaqués, qui détonnent par rapport au reste du texte avec leur allure de passage obligé : ainsi, tout d’une traite, elle suggère une association maladroite entre le corps de la femme et la mort (toutes deux opaques au regard de l’homme), se rend compte qu’elle aurait contribué à invisibiliser les femmes en évoquant des morts mais aucune « morte », et retrace une brève histoire du clitoris… Pourtant, les mots du début du livre, quand l’autrice voyait de ses propres yeux, désamorçaient efficacement ces rouages à travers une écriture qui préfigure un ailleurs exempt d’inégalités, où le genre se dissout dans la mort. Où celle-ci devient, le temps d’un livre, un outil pour penser une autre manière d’être ensemble dans l’existence.
Cette évolution dans l’écriture épouse la progression parallèle du deuil. À mesure que l’on s’éloigne de la mort, s’estompe la vision singulière dont elle nous avait fait don, tandis que l’on retrouve inévitablement un regard collectif. Celui-ci, plus aveuglant sans doute, demeure le seul qui nous permette de vivre parmi les vivantes et les vivants. C’est cette trajectoire qui a donné naissance à Voir de ses propres yeux. Plus qu’un regard, les défunts d’Hélène Giannecchini ont su lui « destiner des lieux » à elle, où elle puisse écrire.












