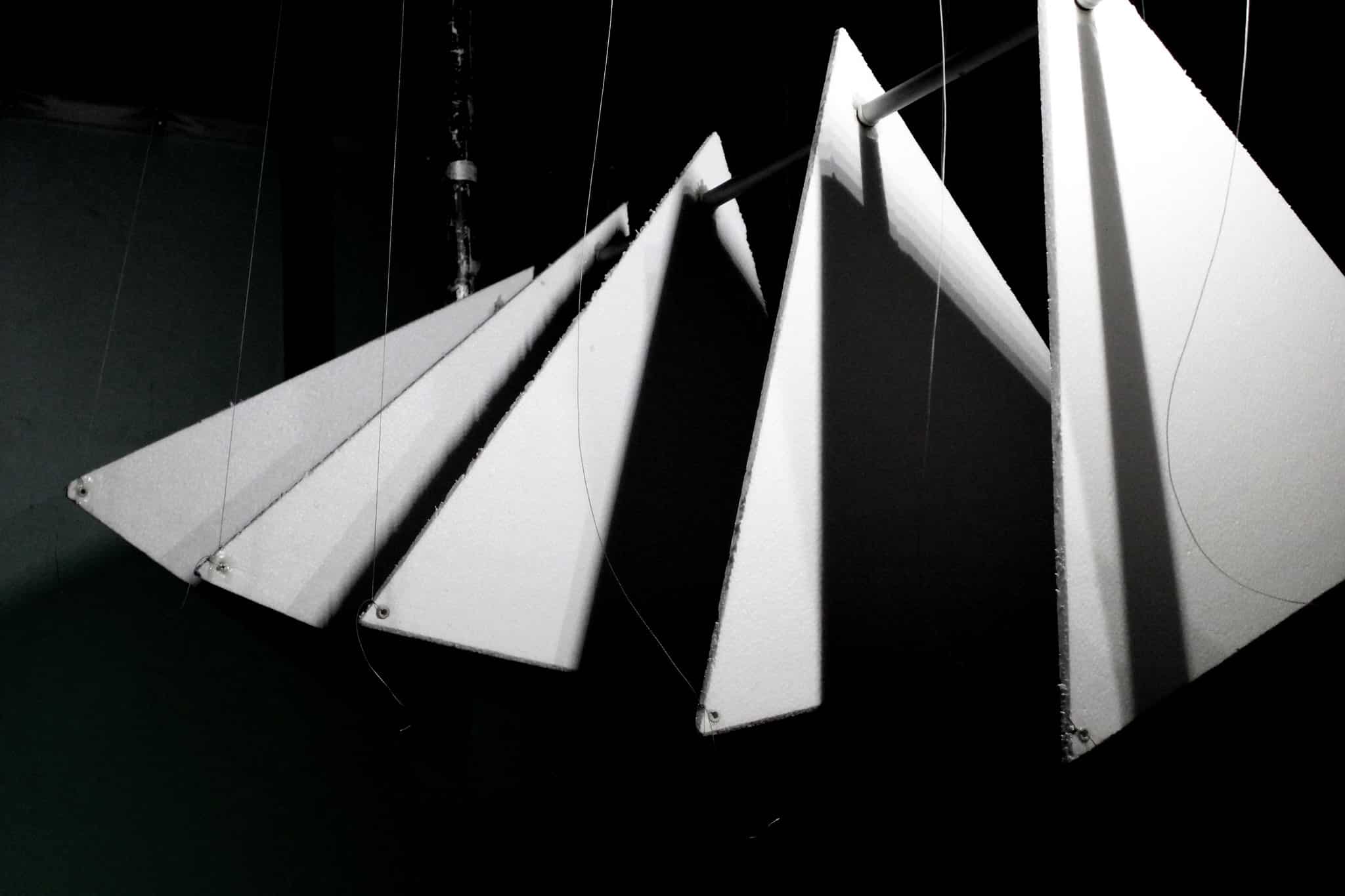À l’occasion du Salon de la revue, qui a lieu du 11 au 13 octobre à Paris, En attendant Nadeau parcourt quelques publications de l’été et de l’automne, en compagnie de Walter Siti, Jean Prévost, Claudie Hunzinger, Germaine Tillion, Benjamin Péret, de la revue Textuel, de l’expression « Qui ne dit mot consent » et du phénomène du passing.
Une anthologie pour Textuel
 La revue Textuel est née dans l’effervescence intellectuelle des années 1970, plus exactement en 1976, au cœur de l’université Paris VII. La France était giscardienne, d’ultimes rubans libertaires flottaient dans l’air et essaimaient. La revue fut lancée avec enthousiasme, dans des conditions matérielles précaires et avec un nom cryptique : 34/44, une curieuse appellation qui faisait référence à deux tours de Jussieu. (Le sous-titre était plus explicite : « Cahiers de recherche de sciences des textes et documents ».) Le nom changera pour devenir Textuel, mais, dès le début, la revue bénéficia du soutien de libraires indépendants et bienveillants et de la participation des abeilles de la ruche de la pensée critique de ces années-là. Julia Kristeva se vit ainsi confier la direction de la publication du premier numéro. C’était il y a plus de quarante ans…
La revue Textuel est née dans l’effervescence intellectuelle des années 1970, plus exactement en 1976, au cœur de l’université Paris VII. La France était giscardienne, d’ultimes rubans libertaires flottaient dans l’air et essaimaient. La revue fut lancée avec enthousiasme, dans des conditions matérielles précaires et avec un nom cryptique : 34/44, une curieuse appellation qui faisait référence à deux tours de Jussieu. (Le sous-titre était plus explicite : « Cahiers de recherche de sciences des textes et documents ».) Le nom changera pour devenir Textuel, mais, dès le début, la revue bénéficia du soutien de libraires indépendants et bienveillants et de la participation des abeilles de la ruche de la pensée critique de ces années-là. Julia Kristeva se vit ainsi confier la direction de la publication du premier numéro. C’était il y a plus de quarante ans…
Les années 2000 sont-elles moins porteuses, moins critiques et moins aventureuses intellectuellement ? La réponse mériterait d’être nuancée, mais le XXIe siècle a fragilisé la revue, jusqu’en 2014, quand elle a été reprise par les éditions Hermann. Cinq ans plus tard, sous la direction avisée de Yannick Séité et Sylvie Patron, celles-ci ont décidé de célébrer la richesse de l’histoire de Textuel et de proposer une anthologie d’écrits parus dans la revue en privilégiant les premiers numéros et en soulignant la variété des genres.
Ami, lecteur, curieux, tu auras donc la surprise de découvrir un entretien de Pierre Pachet, un des pionniers d’En attendant Nadeau, qui fut de la partie Textuel et rappelle le contexte foutraque et chaleureux des commencements. Plus loin, tu tomberas peut-être des nues en croisant Frédéric Berthet, l’auteur de Daimler s’en va, qui suivit le séminaire de Julia Kristeva et participa à l’aventure en 1977, quand Textuel publiait encore des écrits de création. Goûte ces « Cinq petits écrits » de Berthet : ils sont irrévérencieux, désopilants d’intelligence, et doux et acides, comme un sorbet au citron.
En tout, ce sont 27 textes de natures variées qui sont rassemblés dans les trois cents pages de ce numéro spécial de Textuel. Ils sont signés Daniel Arasse, Francis Marmande, Philippe Lejeune (auteur d’un malicieux pastiche nommé « Roland Barthes sans peine »), Jacques Réda (qui nous offre quelques pages lumineuses sur Rimbaud)… et il est bon qu’ils aient une seconde vie sur papier, hors ligne et entre nos mains. C. D.
Textuel, une anthologie, 1976-2016. Textes réunis par Yannick Séité et Sylvie Patron. Été 2019, n°4. Hermann, 313 p., 25 €
Critique n° 867-868
 En Italie vit aujourd’hui un très grand écrivain : Walter Siti. Il a soixante-douze ans, c’est un modèle pour les jeunes écrivains italiens contemporains, hélas il est peu connu en France. Son œuvre y est pourtant largement publiée (essentiellement aux éditions Verdier), grâce à deux personnes, sa traductrice, Martine Segonds-Bauer, et son ami et critique, Martin Rueff, maître d’œuvre de ce numéro de Critique.
En Italie vit aujourd’hui un très grand écrivain : Walter Siti. Il a soixante-douze ans, c’est un modèle pour les jeunes écrivains italiens contemporains, hélas il est peu connu en France. Son œuvre y est pourtant largement publiée (essentiellement aux éditions Verdier), grâce à deux personnes, sa traductrice, Martine Segonds-Bauer, et son ami et critique, Martin Rueff, maître d’œuvre de ce numéro de Critique.
J’évoquerai un souvenir à la première personne pour rapporter ma découverte de cet écrivain, un de mes grands chocs littéraires de ces dix dernières années. C’était il y a sept ans. Une journaliste littéraire ayant pignon sur rue me proposait de piger sur la littérature étrangère pour un grand quotidien. Elle mentionna un roman qu’elle avait essayé de pénétrer, en vain, au cours de son été de bourgeoise cultivée, accomplie et professionnelle. On lui avait annoncé un écrivain qui sentait le soufre, difficile à comparer à d’autres et peu soluble dans l’eau tiède. Je sentais qu’elle me refilait un bébé, un cadeau empoisonné. J’étais piquée au vif et j’avais raison de l’être. Car c’était un cadeau, une œuvre intitulée Leçons de nu, et il distillait le délicieux poison du beau allié à l’intelligence et au mal.
Leçons de nu est un roman qui mêle plusieurs plans narratifs, si bien que j’y découvris à la fois un homme qui portait son homosexualité sur des fonts baptismaux aussi incandescents que ceux d’un Genet ou d’un Pasolini, un critique et professeur plongeant dans l’œuvre de Leopardi, et un romancier mettant en scène une Italie corrompue et vénale. Rares sont les fictions aussi hardies, aussi denses et aussi extrémistes. Il fallait donc au moins un numéro de revue pour présenter et analyser l’œuvre de Walter Siti.
Non, c’est un écrivain qui ne se laisse pas traduire ni approcher comme un produit. Lui-même le sait et l’analyse avec une lucidité et une exigence étonnantes dans un texte inédit, intitulé « Le temps de la becquée, » confié à ce numéro de Critique. Très calmement, il s’insurge contre une conception pâle de la littérature qui voudrait qu’elle soit thérapeutique et webbable. On complétera sa douce charge avec l’entretien qu’il accorde à Martin Rueff, avec un extrait de son prochain roman, Le chant du diable (à paraître en 2020), et avec plusieurs analyses universitaires qui tentent de circonscrire cet amoureux des lettres et des corps de culturistes. C. D.
« Walter Siti. L’Italie à rebrousse-poil », août-septembre 2019, 160 p., 13 €. Critique est disponible en librairie et sur abonnement
Les moments littéraires, n° 42
 La romancière-artiste Claudie Hunzinger (Les grands cerfs, Grasset, 2019) est à la une du dernier numéro des Moments Littéraires, la « revue de l’écrit intime » qui paraît deux fois l’an. Elle consacre aussi son cahier central aux portraits d’Isabelle Mège. On peut commencer par faire le tour de la propriétaire avec une présentation sensible de l’œuvre signée Pierre Schoentjes, à moins que l’on ne décide de plonger tête la première dans le passionnant entretien accordé au directeur, Gilbert Moreau. Claudie Hunzinger y revient notamment sur l’expérience Bambois et le livre éponyme, nous parle de sa géographie personnelle : la vie sauvage, les animaux, les plantes, le soleil… Des extraits d’un texte d’Emma Pitoizet-Schmitt, la mère de l’écrivaine, écrit au temps de l’annexion de l’Alsace par le IIIe Reich, complètent opportunément ce dossier : « Qu’est-ce que c’est, Claudie, une fleur ? » Avec décision, tandis qu’elle trace les lignes du corps et les boutons du costume : « Oui, c’est une fleur-dame. »
La romancière-artiste Claudie Hunzinger (Les grands cerfs, Grasset, 2019) est à la une du dernier numéro des Moments Littéraires, la « revue de l’écrit intime » qui paraît deux fois l’an. Elle consacre aussi son cahier central aux portraits d’Isabelle Mège. On peut commencer par faire le tour de la propriétaire avec une présentation sensible de l’œuvre signée Pierre Schoentjes, à moins que l’on ne décide de plonger tête la première dans le passionnant entretien accordé au directeur, Gilbert Moreau. Claudie Hunzinger y revient notamment sur l’expérience Bambois et le livre éponyme, nous parle de sa géographie personnelle : la vie sauvage, les animaux, les plantes, le soleil… Des extraits d’un texte d’Emma Pitoizet-Schmitt, la mère de l’écrivaine, écrit au temps de l’annexion de l’Alsace par le IIIe Reich, complètent opportunément ce dossier : « Qu’est-ce que c’est, Claudie, une fleur ? » Avec décision, tandis qu’elle trace les lignes du corps et les boutons du costume : « Oui, c’est une fleur-dame. »
Isabelle Mège, elle, ne se prend pas pour une fleur… encore que. Pendant 22 ans, elle a proposé à des photographes de renom de la photographier, on ne dira pas sous toutes les coutures, mais plutôt de toutes les façons, et d’abord nue, la plupart du temps. Il y a l’art contemplatif de Jean-François Bauret, la manière simple de Willy Ronis, celle douce d’Édouard Boubat, celle double de Despatin et Gobeli, mais ça n’est que la moitié du portrait : « Ensemble est le maître mot de ce projet […] Chaque portrait est le résultat d’une alchimie miraculeuse. La personnalité de chaque photographe s’inscrit dans mon regard ; nous nous modelons l’un l’autre ». Un numéro à lire et à voir, donc. R.-Y. R.
Les Moments Littéraires, n°42, 144 p., 12 €. Plus d’informations sur la diffusion de la revue en suivant ce lien.
Papier Machine, n° 8 et demi
 Papier Machine, fondée à Bruxelles il y a cinq ans, a une devise, qu’on lira sur la page de couverture des différents numéros et sur son site : « Qui ne dit mot consent ». Alors, pour ne pas consentir sans savoir à quoi, deux fois par an, la revue élit un mot, et une trentaine de contributeurs, poètes, critiques, linguistes, graphistes s’en emparent, le font jouer, le critiquent, s’en inspirent. L’ensemble est plein de trouvailles, d’incongruité et, parce qu’on peut être happé par la lecture de tel ou tel article, on comprend soudain que le format papier, juste aux bonnes dimensions, n’est pas seulement décoratif, qu’il permettra de fermer et de rouvrir un numéro, de l’emporter avec soi, de le montrer à des amis, de l’archiver – et c’est précieux.
Papier Machine, fondée à Bruxelles il y a cinq ans, a une devise, qu’on lira sur la page de couverture des différents numéros et sur son site : « Qui ne dit mot consent ». Alors, pour ne pas consentir sans savoir à quoi, deux fois par an, la revue élit un mot, et une trentaine de contributeurs, poètes, critiques, linguistes, graphistes s’en emparent, le font jouer, le critiquent, s’en inspirent. L’ensemble est plein de trouvailles, d’incongruité et, parce qu’on peut être happé par la lecture de tel ou tel article, on comprend soudain que le format papier, juste aux bonnes dimensions, n’est pas seulement décoratif, qu’il permettra de fermer et de rouvrir un numéro, de l’emporter avec soi, de le montrer à des amis, de l’archiver – et c’est précieux.
Ce numéro 8 et demi fait un pas de côté et donne carte blanche à des universitaires et à des collectifs d’artistes à partir d’une question un peu vague sur les mots choisis ou subis. Les textes des contributeurs, presque jamais généraux, très engagés dans une approche et une pratique spécifique, sont passionnants. Outre les thèmes – la francophonie et la grammaire française normative, le « chiac » acadien et son statut politico-social, les protocoles langagiers des centres d’appels téléphoniques et leur répercussions sur les opératrices et opérateurs, la réforme de l’orthographe, les recherches linguistiques et politiques des « autriX » queer de RER Q et leur dénonciation des assignations identitaires et de la poésie à papa – c’est bien sûr l’éventail des écritures ici présentées qui est saisissant. Gardons en mémoire, entre autres, les noms de Rebecca Chaillon et de Tarek Lakhrissi. C. P.
« Qui ne dit mot consent », 112 p., 18 €. Plus d’informations sur le site de la revue.
Le Genre humain, n° 59
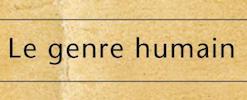 Verfügbar aux enfers, « opérette-revue en 3 actes », élaborée clandestinement comme geste de résistance dans le camp de femmes de Ravensbrück, a fait l’objet d’une recherche sous tous ses aspects de la revue Le Genre humain, dirigée par Maurice Olender. Plusieurs fois mise en scène, notamment au Théâtre du Châtelet à Paris en 2007, elle fut l’œuvre de l’ethnologue et résistante Germaine Tillion, aidée par ses compagnes de détention qui mobilisèrent leurs mémoires musicale et littéraire, détournant des airs d’opéras connus, recourant à des rengaines publicitaires pour dépasser par le rire leur statut d’esclaves : « verfügbar », cela veut dire « taillable et corvéable à merci ». À l’issue de la formation des commandos de travail, celles qui n’en faisaient pas partie étaient alors utilisées pour les tâches les plus répugnantes, les plus avilissantes.
Verfügbar aux enfers, « opérette-revue en 3 actes », élaborée clandestinement comme geste de résistance dans le camp de femmes de Ravensbrück, a fait l’objet d’une recherche sous tous ses aspects de la revue Le Genre humain, dirigée par Maurice Olender. Plusieurs fois mise en scène, notamment au Théâtre du Châtelet à Paris en 2007, elle fut l’œuvre de l’ethnologue et résistante Germaine Tillion, aidée par ses compagnes de détention qui mobilisèrent leurs mémoires musicale et littéraire, détournant des airs d’opéras connus, recourant à des rengaines publicitaires pour dépasser par le rire leur statut d’esclaves : « verfügbar », cela veut dire « taillable et corvéable à merci ». À l’issue de la formation des commandos de travail, celles qui n’en faisaient pas partie étaient alors utilisées pour les tâches les plus répugnantes, les plus avilissantes.
Le recours à l’« air des lampions », rappelle Esteban Buch dans sa présentation, que Flaubert avait évoqué dans son récit des événements de 1848, et qui chez Offenbach (Orphée aux Enfers, œuvre parodiant déjà Orphée et Eurydice de Gluck) travestissait la révolte des dieux contre leur maître, ancre l’opérette de Ravensbrück dans une généalogie républicaine. Le parcours de Germaine Tillion, résistante dès la première heure dans le réseau du Musée de l’homme sous l’occupation nazie, puis aux côtés des Algériens contre la torture lors de la « sale guerre », atteste son engagement dans toutes les justes causes.
Ce numéro de la revue répertorie et analyse toutes les modalités et stratégies de survie dans l’univers concentrationnaire, parmi lesquelles le rire et le chant fredonné, chants connus de toutes, qu’il s’agisse d’airs d’opéras comme des chants populaires qui exerçaient une fonction fédératrice entre ces résistantes aux origines sociales et politiques diverses.
À côté d’articles savants sur le camp de Ravensbrück, camp de femmes qui a suscité bien moins de recherches que son équivalent masculin, le camp de Buchenwald, on trouve un entretien inédit de Germaine Tillion accordé en 2002, soit six ans avant sa mort. Cette opérette-œuvre de résistance, dont la genèse est ici relatée, était restée soixante ans sous le boisseau. Elle fut publiée en 2005 aux éditions La Martinière et présentée par Tzvetan Todorov et Claire Andrieu. Il semble qu’il n’y ait eu qu’une seule lecture publique par celles qui la composèrent, le 8 avril 1949, pour une assemblée des anciennes de Ravensbrück (on en trouve trace dans le fonds d’archives de l’ADIR, Association des déportées et internées de la Résistance). Elle fut enfin jouée sur le lieu même de sa création lors de la 65e commémoration de la libération du camp par l’armée soviétique. S. C.
« Chanter, rire et résister à Ravensbrück, autour de Germaine Tillion et du Verfügbar aux Enfers », 250 p., 16 €. Plus d’informations sur la diffusion de la revue en suivant ce lien.
Europe, n° 1082-1083-1084
 La revue Europe a consacré une bonne partie de sa livraison d’été à deux acteurs majeurs de la vie littéraire française de l’entre-deux-guerres, Jacques Rivière (1886-1925) et Jean Prévost (1901-1944). Les différentes contributions sont enrichies par un retour sur le traité de Versailles à la lumière des derniers travaux impulsés par le centenaire de la Grande Guerre, et par une réflexion sur la mémoire que la France et l’Allemagne ont gardée des soldats, de leur sacrifice et de leurs souffrances.
La revue Europe a consacré une bonne partie de sa livraison d’été à deux acteurs majeurs de la vie littéraire française de l’entre-deux-guerres, Jacques Rivière (1886-1925) et Jean Prévost (1901-1944). Les différentes contributions sont enrichies par un retour sur le traité de Versailles à la lumière des derniers travaux impulsés par le centenaire de la Grande Guerre, et par une réflexion sur la mémoire que la France et l’Allemagne ont gardée des soldats, de leur sacrifice et de leurs souffrances.
Jacques Rivière d’abord, qui participa activement aux débats de son temps et entretint avec nombre de grands esprits une vaste correspondance. Critique exceptionnel, héraut infatigable de l’intelligence, de l’honnêteté intellectuelle et de la sincérité, il tint d’une main ferme la barre de la NRF de 1919 jusqu’à sa mort. Il en fit le grand espace d’expression que l’on sait. Observateur averti de la littérature qui émergeait alors que le symbolisme touchait à sa fin, et des nouvelles directions explorées par les écrivains et les artistes, Jacques Rivière impulsait et accompagnait le mouvement. Voir en Rimbaud ou Dostoïevski des exemples à suivre ne l’empêcha pas de reconnaître au premier regard le génie de Marcel Proust. Mais il comprit aussi la révolution qui s’opérait en musique (avec Debussy, puis Stravinski) et en peinture : une vaste controverse sur le cubisme naissant l’opposa alors à Guillaume Apollinaire. Certes, Jacques Rivière a pu se tromper, mais rien ne peut altérer ce rôle éminent de passeur et de découvreur de talents qu’il joua sans faille jusqu’à sa mort, parfois aux dépens de son œuvre personnelle.
La question qui continue de diviser est celle de son retour au catholicisme : on sait le rôle joué par Isabelle Rivière et par d’autres après sa mort. On apprécie d’autant mieux le mot d’Alix Tubman-Mary à la fin de sa contribution : « c’est Rivière lui-même qui allait devenir le premier enjeu d’un récit légendaire, celui d’une NRF entre Dieu et le Diable ».
Jean Prévost, c’est l’intelligence claire d’un brillant normalien tôt engagé dans la littérature et les combats intellectuels, qui publia dès mars 1924 dans la NRF où l’accueillit un Jacques Rivière immédiatement sensible à sa fougue et à sa vivacité d’esprit. Car, comme l’écrit Hélène Baty-Delalande : « il incarne pleinement, à sa manière parfois irritante, cette “revendication de l’intelligence’’ que Rivière appelait de ses vœux dans l’éditorial de la première NRF d’après-guerre, en juin 1919 ». Auteur d’une trentaine d’ouvrages et de très nombreux articles publiés dans des revues littéraires ou dans la presse, Jean Prévost appliqua ses compétences et son savoir à tous les domaines, comme critique, romancier ou traducteur – et comme adepte fervent du sport.
Alain, son professeur au lycée Henri-IV, d’autres philosophes comme Spinoza, furent ses guides, stimulant une pensée qu’il n’imaginait pas coupée de l’action. Vivre de plain-pied avec son temps, observer et commenter l’actualité, se mêler aux controverses des intellectuels, ne l’empêchait pas de se tourner vers le passé, de lire par exemple avec passion Stendhal (auquel il consacra une thèse) et Baudelaire : Jean Prévost savait mener des hommes au combat, mais sa plume n’était jamais bien loin, et au plus fort de l’action, quelques heures avant sa mort encore, son carnet s’enrichissait de notes nouvelles.
Pourtant, une cinquantaine d’années plus tard, l’œuvre de Jean Prévost menaçait de sombrer dans l’oubli quand parut le désormais célèbre Pour Jean Prévost de Jérôme Garcin (Gallimard, 1994) : est-ce justement parce qu’il défendait, toujours selon Hélène Baty-Delalande, « une certaine vision de la littérature, plutôt classique, sinon antimoderne, comme art du langage tourné vers le monde » ? J.-L. T.
« Jacques Rivière, Jean Prévost, 1919 : le traité de Versailles », 378 p., 20 € La revue Europe est facilement disponible en librairie ou sur abonnement.
Genèses, n° 114
 La revue Genèses, publication de sciences sociales, présente un numéro sur un phénomène mal connu en France, le « passing ». Celui-ci, né dans le contexte de la ségrégation raciale, consiste à ce qu’une personne d’une « race » se fasse passer pour une personne d’une autre « race ». Ce franchissement des frontières se fait secrètement, et le plus généralement dans le sens noir-blanc. Le sujet, peu étudié chez nous, l’est assez aux États-Unis, mais pas du point de vue des sciences sociales.
La revue Genèses, publication de sciences sociales, présente un numéro sur un phénomène mal connu en France, le « passing ». Celui-ci, né dans le contexte de la ségrégation raciale, consiste à ce qu’une personne d’une « race » se fasse passer pour une personne d’une autre « race ». Ce franchissement des frontières se fait secrètement, et le plus généralement dans le sens noir-blanc. Le sujet, peu étudié chez nous, l’est assez aux États-Unis, mais pas du point de vue des sciences sociales.
Une première série d’articles et de mises au point concernent donc cette vision, disons « première », du « passing ». Ensuite d’autres contributions l’étendent à des phénomènes différents, le franchissement des frontières de genre, de classe et d’âge, en prenant parfois appui sur des histoires récemment très médiatisées comme celle de Bruce Jenner, de la famille Kardashian, devenu Caitlyn Jenner, ou celle de Rachel Dolezal, pour en revenir au domaine des « races », qui, activiste et présidente d’un comité NAACP (association noire), se disait de couleur alors qu’elle ne l’était pas, et qui s’est donc vue, une fois sa « vraie » identité dévoilée, déconsidérée et accusée de « fraud » et de « cultural appropriation ».
Les articles se montrent sensibles aux particularités des types de « passage » et à celles des « passeurs » (ce dernier terme semblant assez mal choisi pour parler de personnes qui franchissent des frontières et non qui les font franchir à d’autres). Certaines approches cherchent à dépasser la spécificité du « passage » dont elles parlent et à l’inscrire dans un questionnement historique et sociétal vaste. Pour autant, c’est parfois le côté descriptif qui passionne avant tout, comme dans l’étude de James M. O’Toole, « La famille Healy en Amérique ».
Les mises en perspective du sujet, par la recension d’Abdellali Hajjat et les contributions du coordinateur du numéro, Benoît Trépied, sont éclairantes. Elles sont sensibles aux difficultés qu’il y a à définir le « passing » et à réunir sous le même terme des événements et pratiques divers, aux buts et conséquences variés. Elles n’éludent pas les problèmes que pose l’approche du « passing » en sciences sociales. Comment, en effet, étudier un phénomène marginal et souvent secret – totalement pour la race, et partiellement pour les autres « passages » ?
Dans le cas du « passage » noir-blanc, Trépied signale qu’il a été un sujet de fascination pour la littérature américaine, et ce jusqu’à aujourd’hui (comme par exemple dans la version ironique qu’en a fait Philip Roth avec La tache). Et alors, le lecteur moyen se dit que c’est précisément la dimension fantasmatique du « passing » qui en fait un objet idéal pour les productions imaginaires, captivées par la transgression des limites et le bouleversement des catégories, et qu’il pourrait être mieux servi par elles que par les sciences sociales. Mais la revue Genèses est heureusement là pour se montrer en désaccord et fournir de quoi poser le débat, cerner les questions et considérer leur évolution historique. C. G.
« Passing », 175 p., 25 €. La revue Genèses est disponible sur abonnement.
Cahiers Benjamin Péret, n° 8
 Le Salon de la revue est le salon des lecteurs de revues vivantes. Viennent ici, pendant ces trois jours, les éditeurs, animateurs et collaborateurs de ces « petites revues », confidentielles malgré elles, venues présenter leur dernier numéro. C’est le cas des très nombreuses revues publiées dans des conditions financières héroïques par des « associations d’amis » venus présenter leur dernier numéro, souvent un numéro annuel, financé par les cotisations de leurs quelques dizaines d’adhérents.
Le Salon de la revue est le salon des lecteurs de revues vivantes. Viennent ici, pendant ces trois jours, les éditeurs, animateurs et collaborateurs de ces « petites revues », confidentielles malgré elles, venues présenter leur dernier numéro. C’est le cas des très nombreuses revues publiées dans des conditions financières héroïques par des « associations d’amis » venus présenter leur dernier numéro, souvent un numéro annuel, financé par les cotisations de leurs quelques dizaines d’adhérents.
Parmi elles, ce huitième Cahier Benjamin Péret, publié depuis 2012 par l’Association des amis de Benjamin Péret, fondée en 1961 à l’initiative d’André Breton quelques années après la mort de son ami en 1959, dans le but de publier ses œuvres, devenues introuvables, et de répondre aux attaques de quelques-uns de ses ennemis. Le premier président en fut Robert Lebel, à qui succédèrent Jean-Louis Bédouin, puis Claude Courtot, aujourd’hui Gérard Roche. L’Introduction à la lecture de Benjamin Péret, de Claude Courtot, prélude à ses Œuvres complètes, fut publié en 1965 par Eric Losfeld. 30 ans après, en 1995, le septième et dernier volume fut publié par les éditions José Corti. Les œuvres complètes, par définition, ne sont jamais complètes. Pour rester dans l’actualité, l’association décida pour rendre compte de la découverte de nombreux inédits, de correspondances , d’études et de témoignages, de publier de beaux Cahiers Benjamin Péret.
Le numéro 8, que l’on découvrira au Salon de la revue, ne déroge pas à la règle, avec un sommaire très riche, un bel hommage à son ancien président, Claude Courtot, décédé il y a un an et des études sur Jean-Claude Biraben, E. L. T. Mesens, des lettres de Jacques B. Brunius à André Breton, Benjamin Péret et Jean-Louis Bédouin, de Leonora Carrington à André Breton, d’Octavio Paz à Remedios Varo, et, cerise sur le gâteau, la lettre splendide écrite par Jacques Prévert le 15 juin 1963 pour témoigner devant le tribunal en quelle estime il tenait Benjamin Péret , insulté après sa mort par le triste Georges Hugnet :
« J’ai très bien connu Benjamin Péret, autrefois nous avons habité sous le même toit. Je connais aussi Georges Hugnet.
Benjamin Péret, c’était un poète entier qui n’écrivait jamais les choses à moitié.
Il tenait à ses idées, ses amitiés, ses rêves.
Benjamin Péret c’était et c’est toujours Benjamin Péret. Georges Hugnet, c’est seulement Georges Hugnet et c’est sans doute pour cela qu’il lui a pris, un jour, d’écrire sur Benjamin Péret, contre Benjamin Péret, un article d’une affligeante médiocrité et d’une très grande bassesse littéraire.
On n’écrit pas dans le dos d’un mort qu’on rencontrait fréquemment de son vivant, des choses qu’on aurait pu lui dire, en face de vive voix. Benjamin Péret ne pouvait plus user du droit de réponse. Indignés à juste titre, trois de ses amis l’ont fait à sa place, mais à leur manière qui sans doute n’était ni la plus efficace ni la plus raisonnable. » D. R.