Alors, c’est quoi le problème ? Qu’est-ce qui ne va pas au juste ? Disparition de la littérature, des poètes, du livre, du lectorat, de la critique… Ce n’est certes pas d’aujourd’hui qu’Antoine Compagnon a prononcé sa leçon inaugurale « La littérature, pour quoi faire ? » au Collège de France, mais l’année éditoriale 2017-2018 a été particulièrement fournie en ouvrages auscultant les angoisses et les difficultés des écrivains face à la chute des ventes ou aux discours contre les textes « romantiquement » attardés, c’est-à-dire se réclamant de la « littérature » et persistant à poser la question du réel dans l’art.
Cyrille Martinez, La bibliothèque noire. Buchet-Chastel, coll. « Qui vive », 192 p., 14 €
Le poète insupportable et autres anecdotes. Questions théoriques, coll. « Forbidden Beach », 144 p., 8 €
Simple coup de blues ou mutation profonde du paradigme littéraire ? Comme on l’avait déjà indiqué ici, il y aurait un dossier à faire sur ce malaise partagé par nombre d’écrivains, où entreraient le récit de Noémi Lefebvre Poétique de l’emploi, celui de Frédéric Ciriez sur la critique, Bettie Book, les deux tomes d’Histoire de la littérature récente d’Olivier Cadiot (2016 et 2017) et, à titre de diagnostic, l’essai Réparer le monde d’Alexandre Gefen. À cette liste s’ajoutent désormais deux livres de Cyrille Martinez, l’un paru en décembre dernier, Le poète insupportable et autres anecdotes, et l’autre, un récit, La bibliothèque noire, au printemps. Les deux sont étroitement liés, comme les versants ésotérique et exotérique d’un même problème, traitant, le premier de l’écriture, et le second de la lecture.
Le poète insupportable est un peu plus théorique, s’inscrivant avec bonheur dans un genre, l’anecdote, dont Christophe Hanna rappelle en préface qu’il a pour « intérêt épistémique principal […] de nous révéler des formes d’interactions sociales, des complicités, connivences institutionnelles relativement inédites ». La bibliothèque noire, conte fantastique et drolatique imaginant l’avenir (incertain) du livre, vaut quant à lui autant par sa sociologie du public des bibliothèques ou son historique cruel de la BnF François-Mitterrand que par sa réflexion sur le rapport à la lecture à l’heure de la révolution numérique.
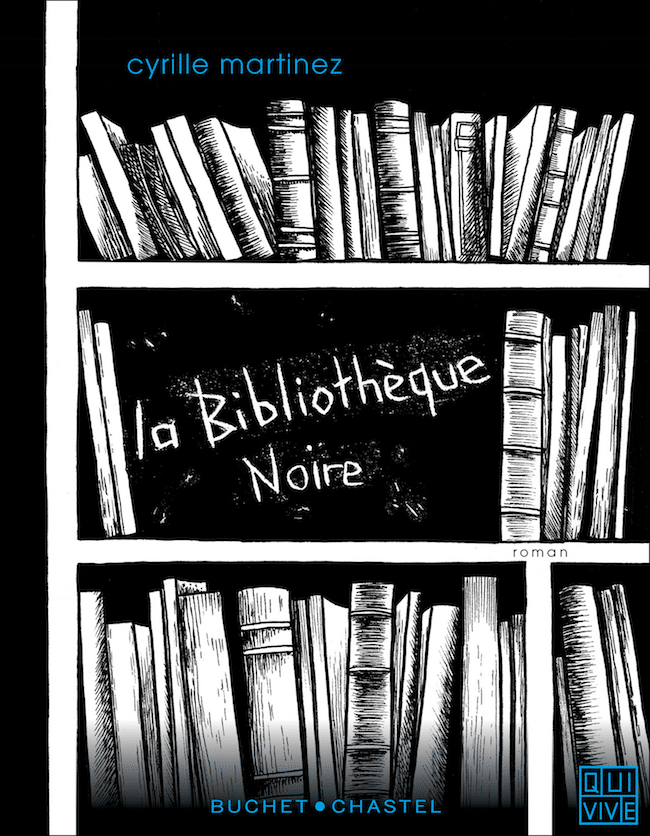
Cyrille Martinez, La bibliothèque noire.
Dans ce dernier ouvrage, Martinez, qui est lui-même bibliothécaire, met en scène un Jeune livre en colère (c’est son titre) qui ne trouve pas de lecteur. Il n’est ni meilleur ni pire que les livres qui en ont, des lecteurs, mais il est victime de ce qu’on appelle depuis longtemps la « rotation rapide ». Il y a un entretien de Deleuze à ce sujet, intitulé « Les intercesseurs » (1985), dans Pourparlers : si la chaîne du livre devient « un marché de l’attendu », réglé comme un hit-parade, « les Beckett ou les Kafka de l’avenir, qui ne ressemblent justement ni à Beckett ni à Kafka, note le philosophe, risquent de ne pas trouver d’éditeur, sans que personne s’en aperçoive par définition ». Notre jeune livre en colère pense de même : à force de croire que les romans les plus lus sont forcément les meilleurs, on risque de reléguer « les jeunes livres […] loin de leurs lecteurs potentiels ». Car il est faux de dire que le marché est une libre concurrence d’où émerge le meilleur. La logique de ses zélateurs est au contraire sadienne : puisque le libre-échange détruit des marchandises et en porte d’autres au sommet, argumentent-ils, aidons-le en exposant plus ce qui se vend déjà beaucoup et en taisant ce qui se vend moins. Rien de moins libre que ce libéralisme-là.
L’autre adversaire du jeune livre en colère, c’est le digital. L’idée de finir numérisé comme tous ses collègues de bibliothèque le terrorise. Non pas qu’il n’aime pas les tablettes ou les liseuses, mais il croit que « les manières de lire varient en fonction des supports. C’est pourquoi il est nécessaire que les différents supports coexistent, et pas qu’ils soient en concurrence ». Martinez fait décrire avec humour à son héros la numérisation des lecteurs de bibliothèques eux-mêmes, qu’on décide d’appeler bientôt « usagers » puis « séjourneurs » : de fait, ils n’empruntent plus de livres et seule leur importe la qualité de la connexion wifi. Dans la troisième partie du récit, ça va même encore moins bien, puisqu’on a ôté la mention « bibliothèque » sur les bâtiments « au prétexte que ça pouvait être intimidant et discriminatoire » : « la lecture est considérée comme une chose honteuse, un truc pénible dont on aimerait bien se débarrasser au profit de contenus qui demanderaient moins d’efforts ».
À ce point, Cyrille Martinez rejoint le diagnostic d’Alexandre Gefen sur un nouveau paradigme « thérapeutique » de la littérature, mais il diffère sur le pronostic de la maladie : « nous voulons une bibliothèque qui nous offre la possibilité à la fois d’augmenter nos capacités intellectuelles et notre pouvoir de séduction, de nous mobiliser pour des causes nobles, d’accéder à la richesse, d’agrandir notre pénis et d’avoir du matériel informatique performant et pas cher ». La suite fait écho à ce que Ciriez a vu des nouveaux rapports intellectuels au monde : « Nous nous rêvons écrivains, rédacteurs, animateurs, modérateurs, critiques d’art, meilleurs copains de milliers d’individus. Nous avons besoin d’une bibliothèque qui nous fournisse les outils nécessaires pour prendre notre vie en main. »

Cyrille Martinez © Marc Melki
Bien sûr, tout ceci est exact, et faux à la fois. Certes, on ne lit plus trop de papier et l’on préfère surfer sur les réseaux sociaux. Mais le lecteur qui occupe un siège de bibliothèque sans emprunter d’ouvrages n’est pas tout neuf (relire La belle Hortense de Jacques Roubaud). Certes, il y a une demande pour des livres édifiants, bienveillants, sans danger, qui consolent, mais en quoi est-ce une nouveauté ? Si l’on délirait complètement, on dirait que la demande majoritaire est désormais aux lectures (ré)confortantes ; que le « régime esthétique » de la littérature était trop sec et qu’on se forçait à lire Claude Simon par masochisme pur alors qu’on préférait en réalité Guy des Cars. Il y a bien des musicologues qui argumentent qu’on ne peut rien attendre dans Schoenberg et donc n’avoir aucun plaisir. Sauf que, comme dit Freud, même le pire névrosé doit bien trouver son compte dans sa souffrance, sinon il arrêterait (version Lyotard : le plaisir moderne est un plaisir qui fait un peu de mal). On a toujours lu ou écouté de la musique pour avoir du plaisir ou une consolation, il y a toujours eu un usage thérapeutique de l’art : mais il n’était jugé légitime que dans la mesure où il résultait d’une élaboration. Ce qui est nouveau peut-être, c’est que les médias et l’Université, en adoubant le corpus des « livres à Grand Succès », comme dit Martinez, en tant que représentatifs de la posthistoire littéraire, légitiment un plaisir obtenu sans épreuve de soi apparente. Mais un jour, le « jeune livre en colère » tombe entre les mains d’un néo-lecteur et, l’arrachant au « temps productif » auquel il est condamné, lui redonne le goût de la « lecture heureuse » et le dégoût du « Livre Qui Fait du Bien ».
Il faut bien l’avouer pourtant, ce plaisir obtenu sans épreuve et ce décervelage bisounours à l’horizon de l’humanité semblent tout de même eux aussi ressortir à la fable. Dans Le poète insupportable, Martinez finit par démasquer cette fiction décliniste et catastrophiste. Mais auparavant, « jeune poète marseillais » et « performeur », il raconte les ravages humains de l’économie du livre à travers une série d’anecdotes horrifiques. Il est question de poésie, mais on pourrait remplacer au choix par littérature « difficile », « exigeante », « fragile » ou « non rentable ». Puisqu’il n’y a plus de lecteurs, s’alignent donc : une lecture sans aucun public (l’unique auditrice, hôte de la Biennale des Poètes, a dû quitter la salle à cause d’une fuite dans le bâtiment), des gens qui vous commandent des textes sans vous payer, d’autres qui vous publient mais vous demandent d’acheter vous-même la revue où vous figurez… « C’est une règle à connaître, pour comprendre la poésie contemporaine : la plupart des lecteurs de poésie sont poètes eux-mêmes. Une autre chose à savoir est que les poètes sont souvent éditeurs, revuistes, programmateurs. » On croise donc dans ce vase clos des poètes qui au mieux s’ignorent, se volent des idées en général et s’assassinent au pire, mais aussi celui qui vient faire sa promo à l’enterrement d’une collègue, celui qui ne jure « que par la poésie expérimentale », celui qui a « un puissant sentiment d’échec » et plus généralement ceux qui ont décidé d’arrêter d’écrire. Là encore, est-on tenté de penser, nihil novi sub sole depuis « À une heure du matin » de Baudelaire.

Martinez décrit la trajectoire exemplaire d’une de ces poètes qui ont lâché l’affaire. « Elle tirait presque un Smic des lectures de poésie, qu’elle avait régulières, et bien payées. Même s’il était compliqué de s’en sortir avec si peu d’argent dans une ville comme Paris, elle faisait partie des poètes les mieux rémunérées. » La jeune femme est cependant toujours inquiète, croyant qu’on ne la publie que par obligation sociale et non pour l’intérêt de son travail. En quoi l’anecdote est, comme dit Hanna, toujours affaire de « positions institutionnelles ». De fait, ce n’est pas sur les ventes qu’elle doit compter pour la reconnaissance : il n’y a pas de bestseller en poésie. Le narrateur tente de la raisonner, lui dit que, même cooptée, c’est qu’elle est au minimum jugée digne d’intérêt. Un jour, elle quitte Paris et disparaît. Il lui écrit et demande des nouvelles : « Au bout de trois jours, elle envoya sa réponse : J’ai cessé toute activité artistique et par là même mis fin au réseau relationnel qui y était lié, je souhaite une bonne continuation à toi et à ta famille. »
Cette absence apparente et décourageante de lecteurs est évidemment plutôt une mutation du lectorat. Bien sûr, on vend de moins en moins de journaux et de livres (et encore moins de livres de poésie), mais on n’a peut-être jamais autant lu : de tweets, de posts et de stories sur les réseaux sociaux. Mieux : sans doute n’a-t-on jamais autant écrit et créé d’images en dehors de toute autorisation, c’est-à-dire de tout statut d’auteur, que sous l’ère numérique. Aucune inégalité n’a probablement été résorbée par ce moyen et la démocratie ne s’est pas améliorée. Mais on ne peut pas dire que l’écriture ni la lecture soient mortes. Lorsque Martinez dit « Nous nous rêvons écrivains, rédacteurs, animateurs, modérateurs, critiques d’art », c’est vrai. Et même : nous le sommes. Le corollaire, c’est que nous ne visons plus à l’universalité et au global mais seulement à être « meilleurs copains de milliers d’individus », c’est-à-dire de la communauté de nos followers. De là, on pourrait aussi inférer qu’Alexandre Gefen a tort en tirant un paradigme « thérapeutique » de ce qui est en réalité une « niche », certes plus volumineuse que celle des amateurs de Schoenberg, mais une niche tout de même dans ce que Martinez nomme la « biodiversité » des pratiques de lecture.
On pourrait dire encore : la poétesse qui ne veut plus écrire a tort, parce qu’elle ne sait rien des followers qu’elle pourrait avoir et des publics qui pourraient s’agréger et se défaire temporairement autour de ses textes (à défaut de son œuvre). Le jeune livre en colère a tort de croire que la bibliothèque est noire, et Cyrille Martinez a raison de citer dans Le poète insupportable l’exemple de ces heureux poètes qui vivent entre eux dans un village : « Ils ignoraient les recensions critiques venant de la presse nationale. Ils ne se souciaient pas des chiffres de ventes. Leur importait seulement le fait d’être lus par leur famille, leurs amis, leurs voisins, leurs copains, leurs collègues. Tout le reste était dénué de sens. Ils se foutaient royalement des signes de reconnaissance symbolique ou financière. Ils n’y pensaient même pas. Et, conclut la femme devant cinq écrivains parisiens en recherche de succès et de gloire : Figurez-vous qu’ils étaient très heureux comme ça. » Ces écrivains-là pourraient être l’avenir. Car la prochaine « lecture heureuse », numérique ou imprimée, ne sera plus seulement celle des « chefs-d’œuvre » de la « littérature », mais une pratique locale et située, ou ne sera pas.












