Il y a les poètes qui pleurent sur la mort de la poésie, entonnant dangereusement le refrain de ceux qui s’en désintéressent et la méprisent, et il y a les poètes qui combattent avec énergie pour la faire mieux connaître et aimer. Jean-Pierre Siméon est de ces derniers.
Jean-Pierre Siméon, Lettre à la femme aimée au sujet de la mort. Poésie/Gallimard, 222 p., 6,30 €
Avec Lettre à la femme aimée au sujet de la mort, Jean-Pierre Siméon entre chez Gallimard en tant qu’auteur ; et par ailleurs, requis par Antoine Gallimard pour succéder à André Velter, il s’apprête à diriger la collection Poésie/Gallimard.
Sa trajectoire est exemplaire d’allant, de diversité et d’impétuosité, car cet homme, qui paraît doux et calme, est en réalité un combattant animé par la passion. Son activité d’écrivain (de poésie mais aussi d’essais, de romans et de nombreuses pièces de théâtre) n’est pas, chez lui, une activité solitaire. Elle trouve tout naturellement ses prolongements dans des institutions pédagogiques ou culturelles à travers lesquelles il peut défendre une certaine idée de la poésie, une certaine manière de sauver le monde du conformisme du sens, voire de l’absence de sens.
Dans son essai La poésie sauvera le monde (Le Passeur, 2015), il déploie un grand art de la polémique pour fustiger et pour valoriser. Fustiger ce qui à ses yeux équivaut à une mort intellectuelle et sensible, et présenter, valoriser, exalter ce qui garantit notre intégrité. La poésie, écrit-il, permet de « lutter contre une langue de signification minimale et consensuelle qui clôt le sens, qui assigne le réel à sa perception immédiate et ainsi s’en débarrasse je veux dire se débarrasse de ce qui dépasse, sa part d’incertitude, d’imprévisible, d’inconnu ».
La poésie (mais est-ce seulement d’elle qu’il s’agit, ne pourrait-on lui associer les autres arts, la science, tous les domaines de l’activité humaine qui repoussent les limites, qui transgressent les frontières de la norme), la poésie, donc, est « une leçon d’inquiétude ».
Il va sans dire que ces convictions s’emparent aussi du champ politique. Puisque « la poésie n’a jamais cessé de contester l’illusion de l’identité stable », Jean-Pierre Siméon en vient par exemple à vilipender l’invention moderne de la carte d’identité qui « assigne à résidence dans une identité close… visiblement réductrice » et qui ne serait, au fond, que l’expression de la peur viscérale de l’inconnu et donc de l’étranger, de l’autre.
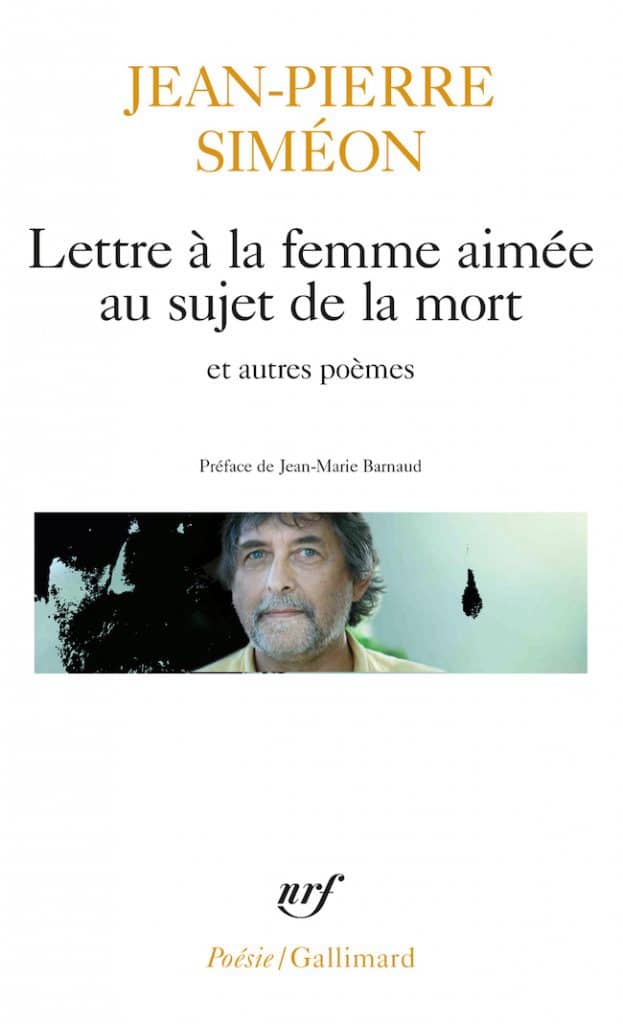
Rares sont les auteurs de poésie en France qui entretiennent aujourd’hui une relation aussi forte, aussi continue avec le monde extérieur, avec la société dans laquelle ils vivent, avec la politique. Enseignant à l’IUFM d’Auvergne (il est agrégé de lettres modernes), critique littéraire et dramatique à L’Humanité dans les années 1990, directeur du Printemps des Poètes de 2001 à 2017, actuellement poète associé au TNP de Villeurbanne aux côtés de Christian Schiaretti, Siméon fait en sorte, depuis ses premières armes, de se trouver dans des situations, des postes qui lui permettent de défendre et d’illustrer les valeurs dans lesquelles il croit et que concentre, à son avis, la poésie. Laquelle permet, en toute chose, de chercher « sa profondeur de champ » ; de ne pas rester à la surface d’un réel que l’information à tout instant prétend décrire avec exactitude, l’information qui « noie le poisson du sens », hausse toujours davantage les faits à des hauteurs évènementielles telles que nos facultés d’étonnement et de raisonnement en sont détruites. « Les preuves fatiguent la vérité », disait Braque.
Au contraire, le poète ne quitte jamais son environnement humain, il sent « monter les fleurs au jardin / en laçant son soulier » ; il se situe « au cœur des choses de la ville » et a la conviction que la guerre à mener sera toujours inachevée, la guerre à mener contre la guerre, omniprésente dans les poèmes de ce volume (dans les pièces de théâtre aussi, Stabat Mater Furiosa, Électre, Philoctète, pour ne citer que celles que je connais). Les villes y ont des noms de femmes, Djerba, Goma, Jaffa, Blida, des femmes qui, de parturientes, deviennent des pleureuses et dans le chant desquelles on entend « l’autorité de la souffrance et la persistance de la soif » – la soif étant le seul vertige de l’espérance, écrit le poète.
Il y a dans ces poèmes l’ample mouvement de la déploration, engendré par la répétition : « Mais cette guerre en nous toujours inachevée… cette guerre comme un torrent charriant ses pierres… cette guerre qui nous laisse / mendiants à notre tour… cette guerre pourtant / comme un poing dans la gorge »; il y a l’apostrophe, la question sans réponse ; et il y a le contrepoint d’ « une joie petite », qui « lève sa rumeur parmi les pierres scellées / du doute » ; « dans l’air cette saveur d’enfance », dont la douceur pourtant ne laisse pas oublier l’inquiétude ; et il y a aussi « la seule liberté qui vaille », celle « d’habiter la nuit entière / pour d’inséparables baisers ».
C’est à peine si j’ose, s’exclame le poète devant l’abîme et la douleur de la guerre, proposer l’eau gelée de mon chant, croire au songe d’un temps où les « enfants […] prendront le tram / vers les banlieues fleuries », et parler de l’amour.
Mais l’amour aussi est une guerre, faite à ceux qui l’empêchent et qui le musèlent, l’amour grâce auquel « les amants font omission du monde », ce qui est nécessaire, même s’ils n’oublient rien du dehors et des ombres qui accompagnent leur sommeil. Comme ces « amants féroces, tendres vivants », les poèmes sont impudiques, ils osent s’écrire et se dire, « ils font au jour des saluts d’oiseau », ils donnent des signes de vie, en rappelant que le jour peut être beau « et que les raisons de mourir sont plus heureuses sur les routes ».
Difficile de ne pas entendre dans ces vers les grands accents aragoniens.












