À l’occasion de la publication de son nouveau roman, Retourner dans l’obscure vallée, Santiago Gamboa s’est entretenu avec EaN. Il parle de ses livres, de son rapport à la littérature, mais aussi de la situation de la Colombie, du terrorisme et d’une paix toujours précaire.
Santiago Gamboa, Retourner dans l’obscure vallée. Trad. de l’espagnol (Colombie) par François Gaudry. Métailié, 448 p., 21 €
Il y a la jeune Manuela, sauvée par la littérature, et par la chance, après une enfance massacrée. L’Argentin Tertuliano, autoproclamé « fils du Pape », violent, trouble, il pourrait bien être complètement dingue, mais il a aussi des éclairs de génie philosophique, du courage et un certain sens de la justice, ou peut-être de la vengeance. Araceli, poétesse riche et mondaine, mais pas totalement dénuée de qualités humaines. Ferdinand Palacios, un prêtre qui a frayé avec les paramilitaires et s’est repenti. Juana, une femme surgie du passé. Le consul, narrateur et double de l’auteur qui a lui-même été diplomate et journaliste. Et encore quelques personnages un peu marginaux qui essaient de trouver une place dans le monde. À un moment, le récit cristallise : un petit groupe d’exilés se retrouve à Madrid, ils ont quitté leur pays depuis longtemps et veulent rentrer en Colombie. Chacun a des comptes à régler, familiaux, politiques ou philosophiques.
Retourner dans l’obscure vallée est un thriller tendu et parfois très violent. Le Colombien Santiago Gamboa nous y parle de voyages et de solitude, de justice et de cruauté, de poésie et de pardon. Il y a aussi, très présente, l’ombre de Rimbaud. On lit des observations géopolitiques et sociologiques très justes et parfois très drôles. On croise des gens très riches et très ouverts : « S’il n’était pas aussi gros, je lirais le livre de Piketty, Le capital au XXIe siècle, mais bien sûr que je l’ai acheté. D’après ce qu’on m’a dit, il explique que le problème, c’est juste l’inégalité ».
L’auteur nous décrit une Europe en crise économique et politique : chômage de masse en Italie, attentat du Bataclan, prise d’otages par Boko Haram à Madrid. De l’autre côté de l’Atlantique, en Colombie, après cinquante ans de guérilla entre FARC, narcos, paramilitaires et forces gouvernementales, la paix s’est installée. L’éthique du pardon a remplacé le darwinisme social, le pays est emporté dans un vertige de bonté, de tolérance et de branchitude. Les journaux du monde entier, y compris le Kompas de Djakarta, ont envoyé des correspondants, les Russes et les Japonais installent des entreprises, Le Clézio achète une maison face au Pacifique et Sean Penn une propriété à Cartagena de Indias. Oliver Stone projette de tourner un film sur le guérillero Tirofijo et Frank Gehry construit le Musée de la Mémoire et de la Réconciliation de Bogota. Réalité et fiction se mêlent, le lecteur ne sait plus où il en est et il en éprouve un immense plaisir. Mais Retourner dans l’obscure vallée est aussi un livre sur l’exil et le temps, il nous interroge : où revient-on quand on revient quelque part ?

Santiago Gamboa © Jean-Luc Bertini
Quel est le sujet de votre livre ?
Je pense que c’est le retour, l’idée du retour. Depuis plusieurs livres, je travaille sur le voyage et le voyageur, que celui-ci soit un vagabond, un migrant ou un personnage en fuite. En exergue de mon roman, il y a une phrase de William Blake : « L’homme devrait travailler et s’attrister, apprendre, oublier et retourner dans l’obscure vallée d’où il est venu pour reprendre sa tâche. » C’est une image très forte, très liée à ma vie, moi qui n’ai fait que voyager d’un pays à l’autre. Dans cette phrase, on peut voir les migrants, ces Ulysse contemporains qui vont chercher du travail, s’attristent à cause de ce qu’ils laissent derrière eux, apprennent dans un endroit nouveau, oublient parce qu’on ne peut l’éviter quand on part. Et puis ils reviennent, ce qui m’intéresse le plus ici. Depuis l’Odyssée, le retour est un sujet littéraire.
Votre regard de Colombien est intéressant : il nous montre ces Latino-Américains qui étaient venus en Europe pour fuir une crise à la fois économique et politique, et voilà que l’Europe devient à son tour un endroit à fuir.
Quand j’ai quitté la Colombie, en 1985, pour faire des études en Espagne, c’était un pays hyperviolent, et qui l’est resté pendant quinze ans. À l’époque, je voyais l’Europe comme un futur désiré vers lequel on devait aller. Aujourd’hui, c’est un peu le contraire, comme si nous avions découvert que nous-mêmes étions le futur de l’Europe. On voit maintenant en France [l’entretien a eu lieu en juillet, avant les attentats de Catalogne] des attaques terroristes qui ressemblent à ce qu’on voyait en Colombie à la fin des années 1980. Avec des choses encore plus violentes : en Colombie, celui qui commettait un attentat ne voulait pas mourir.
Il y a donc la crise économique. En Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce, la grande majorité des Latino-Américains, et des Colombiens en particulier, qui avaient émigré dans les années 1980 pour trouver une vie meilleure, sont maintenant rentrés ou envisagent de le faire. C’est étrange parce que, malgré la crise et le terrorisme, l’Europe continue à avoir un niveau de vie, d’égalité et d’opportunités bien supérieur à celui de l’Amérique latine. Pourtant, l’idée de retourner dans une Colombie nouvelle, pacifiée, est une espèce de rêve : allez, on rentre et on essaie. Mais, d’une certaine façon, ce retour est aussi un exil.
Un émigré qui rentre chez lui au bout de trente ans a énormément de mal à reprendre sa vie d’avant. Surtout un émigré qui rentre comme un perdant : il n’a pas l’aura de celui qui est parti, qui s’est battu et qui a gagné. Il a perdu sa maison en Espagne parce qu’il l’avait achetée à crédit dans les années 1990 et qu’il ne pouvait plus payer les mensualités. Il n’a plus de travail, il laisse ses enfants adolescents en Espagne parce qu’ils sont à l’université. Après trente ans d’absence, il rentre les mains vides, c’est tout sauf un héros. Et puis, il ne se retrouve pas dans l’endroit qu’il a quitté. Il ne retrouve ni son quotidien ni le pays de sa jeunesse. Il traverse une crise psychologique très forte et même une crise d’identité. Quand je suis moi-même rentré, en 2015, je me suis dit que j’avais perdu une partie de mon identité. Quand je vivais en Italie, j’étais le Colombien. En Colombie, ils ont tous colombiens. Ça commençait mal…
Il est aussi question de vengeance et de violence. Une violence montrée avec une extrême crudité.
Je pense que la violence, même la plus extrême, fait partie de la culture. La culture à laquelle j’appartiens, la culture occidentale, commence par une guerre. Le récit fondateur de notre culture, l’Iliade, raconte une guerre, la guerre de Troie. On y trouve déjà des gens qui coupent des têtes avec une épée. L’autre récit fondateur, l’Odyssée, c’est le retour. Dès le début de notre culture, il y a la guerre et le retour. Pendant 2 000 ans, la littérature, la poésie et la philosophie ont tourné autour de ces deux sujets. La guerre est la forme collective de la violence, mais il y a aussi une forme individuelle. Dans le récit littéraire, on voit la violence individuelle. Elle fait partie du même mouvement culturel, on ne tue pas de la même façon en Palestine et au Liberia. Moi, j’ai un traitement cru, parce que je n’aime pas le lyrisme, pas plus dans l’érotisme que dans la violence, si on peut dire qu’il y a un lyrisme dans la violence. Je montre les choses comme je les vois.
Votre roman montre la Colombie comme un pays en paix.
Je fais là un petit exercice d’anticipation. J’ai écrit ce roman en 2015, bien avant le référendum sur le processus de paix. L’époque où il se situe correspond plus ou moins à l’an prochain, à 2018. Il décrit un pays où la paix est établie, mais où persistent des choses un peu obscures. La lutte continue entre ceux qui veulent définitivement la paix et ceux qui ne la veulent pas. Ils veulent une poursuite de la guerre civile parce qu’ils n’arrivent pas à avaler ce qu’ils appellent l’impunité. Je parle là de l’extrême droite colombienne. Juan Manuel Santos est un président de centre droit, mais la Colombie est un pays tellement conservateur que l’extrême droite dit que les gens de centre droit sont des communistes. L’extrême droite ne veut pas le processus de paix pour des raisons économiques. Elle est essentiellement composée de grands propriétaires terriens qui possèdent 21 millions d’hectares sur lesquels ils font de l’élevage, une activité qui enrichit 40 000 personnes et utilise très peu de main-d’œuvre. Or, dans le processus de paix, il y a une attention très grande envers les paysans. Le paysan colombien est pauvre, parce qu’il y a seulement 6 millions d’hectares pour l’agriculture, alors que c’est l’activité de 25 millions de personnes.
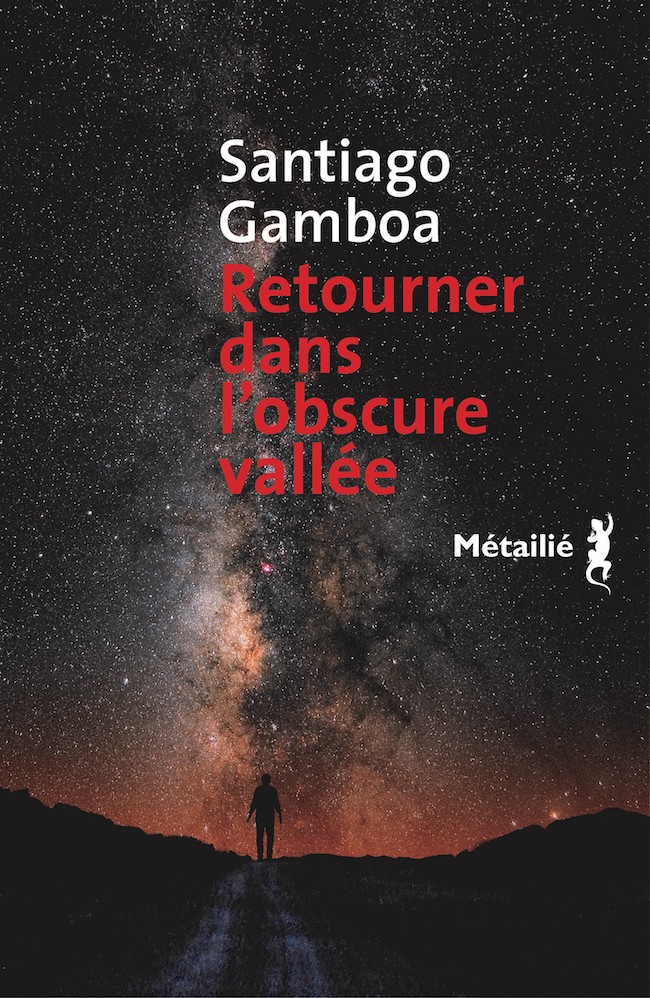
Pourquoi les grands propriétaires sont-ils d’extrême droite ? Avec ce que vous venez d’expliquer, ils pourraient se contenter d’être de droite.
Le problème c’est que cette guérilla de près de cinquante ans a fait que les gens sont devenus extrêmes. Ceux qui ont beaucoup de terres et en veulent encore plus ont créé les paramilitaires pour se protéger et pour prendre de la terre aux petits paysans qui en avaient un peu. Parce qu’une partie des terres qui appartiennent aujourd’hui aux grands propriétaires n’a pas toujours été à eux. Ils ont fait fuir les petits paysans avec l’aide des paramilitaires et se sont approprié leurs terres. Avec un pistolet sur la tempe, le petit paysan a dû vendre à un prix dix fois inférieur. Et après, à qui se plaindre ? Les propriétaires sont d’extrême droite dans le sens où plusieurs d’entre eux se sont alliés avec les narcotrafiquants, ou le sont eux-mêmes devenus. Ils avaient tellement de terres qu’ils pouvaient ouvrir des passages sécurisés pour le trafic de drogue, ce que les narcotrafiquants ont vite compris. Certains des narcos sont eux-mêmes devenus latifondistes, et c’était encore pire, parce que, sur leurs terres, il n’y avait même pas d’élevage : ces gigantesques étendues de terres merveilleuses pour l’agriculture étaient inutilisables.
Aujourd’hui, une des décisions du gouvernement est de rendre les terres aux vrais propriétaires. Le processus de paix dit que chaque famille a droit à au moins un hectare. Cela veut dire que, tôt ou tard, il faudra prendre de la terre aux propriétaires féodaux pour la redonner aux paysans. Les latifondistes ne veulent pas, mais la guérilla est apparue à cause du problème de la propriété de la terre. Si on ne le règle pas, la guérilla reprendra. L’autre problème, c’est ce que les latifondistes appellent « l’impunité » et que j’appelle moi la logique d’un processus de paix. Personne n’accepte d’entrer dans un processus de paix pour aller en prison. Quand on gagne la guerre, on peut faire ce qu’on veut avec le perdant, on peut le fusiller, l’envoyer en prison, on peut même lui pardonner. Mais un processus de paix ne donne à personne le statut de gagnant. Même pas à l’État. Et ça, l’extrême droite ne l’accepte pas.
Vous écrivez que la Colombie est devenue la « république de la bonté », tout le monde veut être la victime qui pardonne…
Les victimes sont devenues très importantes en Colombie parce qu’elles ont été prises en compte dans le processus de paix. Dans un pays où le paradigme absolu c’est la réconciliation et le pardon, les victimes deviennent des personnages importants. Qui est-ce qui peut pardonner ? La victime à son bourreau. Avant, la victime était en bas de la société, parce qu’il n’y avait pas de structure qui reconnaisse sa douleur. Aujourd’hui, ça a changé. Quand le président Santos est allé à Oslo recevoir le prix Nobel de la paix, il a emmené avec lui des représentants des victimes. De même, à la Havane [où se sont déroulés une partie des pourparlers de paix], il y avait une représentation permanente des victimes. En plus, ils ont très vite compris que, dans une guerre, la femme est doublement victime. Elle subit les mêmes violences que l’homme, plus la violence sexuelle. Pareil pour les homosexuels. Ils ont donc aussi envoyé à la Havane des représentants de la communauté LGBTI. Ç’a été quelque chose de très moderne… Mais c’est là que les églises évangéliques ont frappé : elles ont appelé à voter non au processus de paix. Elles ont réuni 1,5 million de votes en disant que, à cause du processus de paix, la Colombie allait devenir une république homosexuelle.
Vous-même, quel rôle avez-vous joué dans ce processus de paix ?
Quand je suis rentré en Colombie, j’ai pensé que c’était important, en tant qu’intellectuel et citoyen, de participer à ce processus. Tout avait commencé un an plus tôt, en 2014, alors que je vivais toujours en Italie. Invité en Espagne à une conférence sur la Colombie, j’ai décidé de parler de la paix. Dans l’assistance, il y avait Juan Manuel Santos, le président colombien. À la fin de mon intervention, Santos m’a pris dans ses bras et m’a dit : « Donne-moi le texte, je veux le lire dans l’avion ». Ensuite, il m’a appelé et m’a demandé s’il pouvait en faire 1 000 copies pour distribuer aux gens des FARC et à ceux de la commission de négociation du gouvernement. Je me suis dit : si ça peut servir à ça, alors, je vais faire un livre. J’ai rassemblé toute ma documentation et j’ai écrit un livre de 300 pages que j’ai intitulé Guerre et paix. Il a été très lu en Colombie, étudié dans les universités, il y a eu sept éditions et Santos en a parlé sur son compte Twitter présidentiel. C’est un livre 100 % militant pour la paix. Je suis parti de l’idée, très française, que les intellectuels doivent s’engager dans le débat politique. Mon idée était de donner des arguments aux gens qui pensaient comme moi. On n’est pas lu par ceux qui pensent différemment, mais par ceux qui pensent comme vous. La seule chose qu’on puisse faire, c’est de leur donner des arguments.
Vous parlez des villes colombiennes : Bogota, Cali, Medellín… II y a quelques années, Medellín était vue comme la ville des cartels, on dirait que les cartels ont disparu…
Medellín, c’est un peu la Barcelone de la Colombie. Elle est plus riche que la capitale, elle a un rôle culturel important. Ses habitants veulent plus ou moins couper avec le reste du pays, comme les Catalans. Ce qui s’est passé avec le trafic de drogue, c’est une histoire typiquement capitaliste : l’intermédiaire – le Mexique – est devenu le propriétaire du business. Les Mexicains sont très forts : ils avaient déjà tous les réseaux de distribution aux États-Unis. Ils ont ensuite mis la main sur les moyens et la matière première. Ils sont bien meilleurs capitalistes que les Colombiens ! Quand le trafic de drogue était aux mains des Colombiens, c’était un business de 7 milliards de dollars. Aujourd’hui, il atteint 30 ou 35 milliards, et une énorme partie de la cocaïne présente en Colombie est d’origine mexicaine. Tous ces cartels mexicains ont en Colombie des correspondants qui travaillent pour eux. Sauf que les cartels colombiens ne sont pas violents. Ils essaient de faire profil bas parce qu’ils savent que la Colombie a une armée faite pour la lutte contre la guérilla et avec laquelle il ne faut pas rigoler.

Comment Rimbaud s’est-il retrouvé dans votre roman ?
Je disais au début que le retour était une question littéraire. Une question littéraire doit avoir une réponse littéraire : peut-être que le seul endroit où l’on puisse vraiment retourner, c’est la littérature. Par ailleurs, cela fait plus de trente ans que je m’intéresse à Rimbaud. Pour moi, il est l’archétype de tous ces voyageurs solitaires qui sont à la recherche de quelque chose. En cela, il donne la ligne de force du roman. Rimbaud était à la recherche de son père, de l’ombre de son père. En même temps, je pense qu’il est le premier des voyageurs écrivant en français. Avant, on voyageait comme Flaubert, qui est allé dans le monde arabe pour confirmer ce qu’il considérait être sa supériorité culturelle. Dans son Voyage en Orient, il voyage avec sa richesse et son pouvoir d’Européen. Ce n’est pas du tout ce que fait Rimbaud : pour lui, le voyage est une expérience de déclassement. Se déclasser pour perdre, comme disait Pessoa. Pour Rimbaud, il s’agit de perdre tout ce qu’il avait acquis comme Européen et de recommencer quelque chose de nouveau. Jusqu’à 19 ans, il a écrit de la poésie ; ensuite, jusqu’à sa mort, il a vécu poétiquement.
En lui, je vois la beauté, l’Ulysse contemporain, l’archétype de cet homme qui ne croit plus au projet civilisateur de l’Occident et qui cherche un monde nouveau. Quand Rimbaud est parti, après la guerre de 1870 et la Commune de Paris, tout un continent était en crise, à la recherche d’un nouveau visage. Exactement comme aujourd’hui. Rimbaud m’a accompagné et montré le chemin. Comme il l’a peut-être montré à Pablo Neruda. Quand celui-ci a reçu le prix Nobel, il a cité cet extraordinaire vers de Rimbaud : « … nous entrerons aux splendides villes ». Pendant tout le XXe siècle, la littérature est entrée dans les villes pour chercher de nouveaux et mystérieux personnages, comme l’Ulysse de Joyce. Je suis sûr que dans la tête de Joyce résonnaient les vers de Rimbaud.
Propos recueillis par Natalie Levisalles












